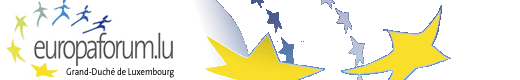Traités et Affaires institutionnelles
Un traité de Lisbonne en mal de ratification a été discuté pendant deux jours par des experts universitaires d’une quinzaine de pays européens
11-11-2008
 Du 7 au 8 novembre 2008, le Programme d’études sur la Gouvernance européenne de l’Université du Luxembourg en collaboration avec l’Institut d'études européennes de l'Université Catholique de Louvain, ont organisé une conférence internationale "Du traité constitutionnel européen au Traité de Lisbonne" dans les locaux de l’Abbaye Neumünster. Le colloque a mis en lumière les enjeux nationaux du processus de réforme institutionnelle dans laquelle l’Union européenne se retrouve depuis l’échec du Traité constitutionnel européen en 2005. Cette conférence a été permise grâce à l’appui financier, logistique et moral du Ministère d’Etat, de la Fondation européenne des sciences politiques, du Fonds national de la recherche scientifique du Luxembourg et de l'Institut Pierre Werner.
Du 7 au 8 novembre 2008, le Programme d’études sur la Gouvernance européenne de l’Université du Luxembourg en collaboration avec l’Institut d'études européennes de l'Université Catholique de Louvain, ont organisé une conférence internationale "Du traité constitutionnel européen au Traité de Lisbonne" dans les locaux de l’Abbaye Neumünster. Le colloque a mis en lumière les enjeux nationaux du processus de réforme institutionnelle dans laquelle l’Union européenne se retrouve depuis l’échec du Traité constitutionnel européen en 2005. Cette conférence a été permise grâce à l’appui financier, logistique et moral du Ministère d’Etat, de la Fondation européenne des sciences politiques, du Fonds national de la recherche scientifique du Luxembourg et de l'Institut Pierre Werner.
Ce colloque clôt la trilogie qui a été initiée en février 2005 avec la conférence sur le Traité constitutionnel européen et dont les actes seront publiés chez Academia Bruylant sous la direction de Christian Franck, président de l’Institut d'études européennes de l'Université Catholique de Louvain et Philippe Poirier (co-coordinateur du Programme d’études sur la Gouvernance européenne de l’Université du Luxembourg.
René Leboutte : Le moteur de l’Union européenne est la tension entre enjeux nationaux et communautaires
 Dans son exposé introductif, René Leboutte, professeur d'histoire européenne contemporaine à l'Université du Luxembourg, a expliqué que l’histoire de l’intégration européenne a été marquée, depuis ses débuts, par des péripéties et des soubresauts qui sont apparus, à chaque fois, qu’il y a eu des efforts en faveur d’une fédération européenne. Ces conflits qui traduisent selon l’historien, "la tension entre des intérêts nationaux et les enjeux supranationaux" représentent le moteur de la construction européenne. Les exemples qui ont été cités par René Leboutte étaient multiples. En 1954, par exemple l’échec de la Communauté européenne de défense (CED), suite au refus de l’Assemblée nationale française de ratifier le traité, va conduire en 1955 à la conférence de Messine et le traité de Rome. En 1962, la crise de la chaise vide éclate et aboutira au compromis de Luxembourg. Cette sortie de crise qualifiée "de fondamentale pour l’histoire européenne" par René Leboutte a engendré en 1966 "une Europe à géométrie variable". En 1972, le rapport Tindemans qui plaide pour une consolidation des institutions existantes et pour un développement des politiques communes, sera écarté au sommet de la Haye. Il précède le véritable changement qui va, selon Leboutte, venir en 1979 avec l’élection du Parlement européen.
Dans son exposé introductif, René Leboutte, professeur d'histoire européenne contemporaine à l'Université du Luxembourg, a expliqué que l’histoire de l’intégration européenne a été marquée, depuis ses débuts, par des péripéties et des soubresauts qui sont apparus, à chaque fois, qu’il y a eu des efforts en faveur d’une fédération européenne. Ces conflits qui traduisent selon l’historien, "la tension entre des intérêts nationaux et les enjeux supranationaux" représentent le moteur de la construction européenne. Les exemples qui ont été cités par René Leboutte étaient multiples. En 1954, par exemple l’échec de la Communauté européenne de défense (CED), suite au refus de l’Assemblée nationale française de ratifier le traité, va conduire en 1955 à la conférence de Messine et le traité de Rome. En 1962, la crise de la chaise vide éclate et aboutira au compromis de Luxembourg. Cette sortie de crise qualifiée "de fondamentale pour l’histoire européenne" par René Leboutte a engendré en 1966 "une Europe à géométrie variable". En 1972, le rapport Tindemans qui plaide pour une consolidation des institutions existantes et pour un développement des politiques communes, sera écarté au sommet de la Haye. Il précède le véritable changement qui va, selon Leboutte, venir en 1979 avec l’élection du Parlement européen.
Christian Franck : Du traité Constitutionnel au traité de Lisbonne
 Selon Christian Franck, de l’Université catholique de Louvain, nous vivons aujourd’hui dans une triple temporalité marquée à la fois par les rejets français et néerlandais au projet de traité constitutionnel et le Non irlandais au traité de Lisbonne. En jetant son regard en arrière sur la construction européenne, Christian Franck a pu constater que le rejet des traités européens a poussé l’Union européenne à adopter des stratégies différentes.
Selon Christian Franck, de l’Université catholique de Louvain, nous vivons aujourd’hui dans une triple temporalité marquée à la fois par les rejets français et néerlandais au projet de traité constitutionnel et le Non irlandais au traité de Lisbonne. En jetant son regard en arrière sur la construction européenne, Christian Franck a pu constater que le rejet des traités européens a poussé l’Union européenne à adopter des stratégies différentes.
En 1954, par exemple, le rejet du traité de la Communauté européenne de défense (CED) par l’Assemblée nationale française a signé la mort de celui-ci. En 1991, lorsque la population danoise a rejeté le traité de Maastricht, l’UE a opté pour un autre choix : la procédure d’Edimbourg. Elle consiste à poursuivre le processus de ratification au niveau politique et de contraindre le Danemark à revoter sur le texte après avoir obtenu quelques concessions.
En 2005, la France et les Pays-Bas ont rejeté le traité constitutionnel. La procédure de faire revoter ne pouvait être utilisée parce que la classe politique française, et notamment le candidat à la présidence Nicolas Sarkozy, avait promis « que le peuple français ne pas revoter là-dessus ». Les nouveaux dirigeants français ont lancé en 2007 l’idée "d’un traité simplifié". Nouveau coup de tonnerre, en juin 2008 : le traité de Lisbonne est rejeté par les Irlandais. Cette fois-ci, les chefs d’Etat et de Gouvernement réunis en Conseil à Bruxelles appellent à une période de réflexion et somment Dublin de trouver une solution à la crise. Un deuxième refus, signera, selon Christian Franck, la mort du traité de Lisbonne. Il s’interroge alors sur la meilleure manière de sortir de cette impasse.
Le traité de Lisbonne prévoit, par exemple, de plafonner le nombre de commissaires européens à 2/3 du nombre des Etats membres, une mesure qui était très impopulaire auprès des électeurs irlandais. La solution pourrait, selon Franck, venir d’une disposition du traité de Lisbonne qui permet au Conseil de modifier à l’unanimité le nombre des commissaires europée Comme l’a rappelé Joachim Schild, l’Allemagne n’a en effet envisagé une renégociation qu’en février 2006, suite à la proposition de Nicolas Sarkozy de négocier un "mini-traité", pour s’engager alors dans une stratégie visant à sauvegarder la substance du Traité Constitutionnel. La Présidence allemande de l’Union Européenne en 2007 a, dans cette perspective, permis de préparer le terrain en vue de la Présidence portugaise sous laquelle a été signé le Traité de Lisbonne.
Comme l’a rappelé Joachim Schild, l’Allemagne n’a en effet envisagé une renégociation qu’en février 2006, suite à la proposition de Nicolas Sarkozy de négocier un "mini-traité", pour s’engager alors dans une stratégie visant à sauvegarder la substance du Traité Constitutionnel. La Présidence allemande de l’Union Européenne en 2007 a, dans cette perspective, permis de préparer le terrain en vue de la Présidence portugaise sous laquelle a été signé le Traité de Lisbonne.
Autre piste envisagée par Christian Franck pour sortir de la crise : augmenter la pression politique en demandant aux Irlandais de se prononcer sur une double question : s’ils sont en faveur du traité de Lisbonne et s’ils veulent rester membre de l’UE.
Joachim Schild : Le rôle de l’Allemagne pour relancer un traité institutionnel
 Joachim Schild, de l’Université de Trèves, a analysé le rôle proactif qui a été joué par le Gouvernement fédéral allemand en faveur du traité constitutionnel après Nice. Il a notamment cité le discours sur la finalité européenne du ministre des Affaires étrangères allemand de l’époque, Joschka Fischer, à l’Université de Humboldt en 2000, et le rôle des Länder allemands dans le cadre la Convention intergouvernementale et de l’élaboration du projet de Constitution européenne.
Joachim Schild, de l’Université de Trèves, a analysé le rôle proactif qui a été joué par le Gouvernement fédéral allemand en faveur du traité constitutionnel après Nice. Il a notamment cité le discours sur la finalité européenne du ministre des Affaires étrangères allemand de l’époque, Joschka Fischer, à l’Université de Humboldt en 2000, et le rôle des Länder allemands dans le cadre la Convention intergouvernementale et de l’élaboration du projet de Constitution européenne.
Quelle était l’attitude adopté par le gouvernent allemand après les rejets français et néerlandais ? Selon Schild, Berlin a plaidé pour une poursuite du processus de ratification en "insistant sur la préservation des éléments essentiels et en exerçant une forte pression sur la Pologne". Joachim Schild a ensuite rappelé que l’Allemagne n’a envisagé une renégociation du traité constitutionnel que très tard, suite à la proposition de Nicolas Sarkozy de négocier un "mini-traité", pour s’engager alors dans une stratégie visant à sauvegarder la substance du traité constitutionnel. La Présidence allemande de l’Union Européenne en 2007 a, dans cette perspective, permis de préparer le terrain en vue de la Présidence portugaise sous laquelle a été signé le traité de Lisbonne.
La stratégie sera maintenue par Berlin après le Non irlandais. Au niveau de l’opinion publique, le soutien à l’UE est tombé en dessous de la moyenne européenne. Schild constate également que les Länder adoptent un discours défensif en ce qui concerne le principe de subsidiarité, le droit de regard des Parlements nationaux sur les politiques européennes et le droit de saisine de la CJCE.
L’ensemble de ces facteurs fait selon Schild qu’il a y eu en Allemagne peu d’enthousiasme en faveur d’un changement de stratégie, peu de débat sur la meilleure manière de sortir l’UE de l’impasse et peu de menaces d’exclusion vis-à-vis de l’Irlande.
Le débat en France : de la campagne présidentielle au traité de Lisbonne
Christophe Piar, de l’Université de Paris I Sorbonne, a analysé le débat en France : de la campagne présidentielle au traité de Lisbonne. Différentes statistiques lui ont permis de montrer que l’intégration européenne a joué un rôle très marginal dans la campagne présidentielle de 2007. En tête des problèmes qui étaient considérés comme le plus important, par les électeurs français figuraient le thème du chômage avec 49 %, suivi des inégalités sociales avec 23 %. La construction européenne arrive seulement en 12e position avec 5 %.
En ce qui concerne les candidats à la présidence, Christophe Piar observe le même phénomène. Les eurosceptiques, Schivardi et De Villiers, ont mobilisé beaucoup le thème européen ( 45 % respectivement 40 %). Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, par contre, l’ont très peu mobilisé (5,5 %). Ces chiffres montrent selon Piar que l’enjeu européen était considéré "non seulement comme pas rentable mais également risqué" car "en centrant sa campagne sur l’enjeu européen, Nicolas Sarkozy se serait privé d’une partie de l’électorat de droite et du Front national". En l’absence de connaissances approfondies des citoyens sur les sujets européens, il semble selon Christophe Piar que les choix des électeurs ont surtout été influencés par le contexte national.
Jacques Thomassen: Après le référendum, l’Europe est-elle encore un enjeu aux Pays-Bas ?
 Jacques Thomassen, de l’Université Twente, a analysé le cas néerlandais. Selon lui, le rejet du traité constitutionnel aux Pays-Bas a constitué une surprise parce qu’il s’agit d’un pays qui est traditionnellement très pro-européen et où le sentiment d’appartenance à l’UE se situait au-dessous de la moyenne européenne. Il a estimé que le résultat de la consultation par voie référendaire était très "malheureux" parce que la tenue d’un référendum était considérée comme facultative par le parlement néerlandais. Selon Jacques Thomassen, le résultat a mis en lumière l’écart qui existe entre l’opinion publique et l’élite politique.
Jacques Thomassen, de l’Université Twente, a analysé le cas néerlandais. Selon lui, le rejet du traité constitutionnel aux Pays-Bas a constitué une surprise parce qu’il s’agit d’un pays qui est traditionnellement très pro-européen et où le sentiment d’appartenance à l’UE se situait au-dessous de la moyenne européenne. Il a estimé que le résultat de la consultation par voie référendaire était très "malheureux" parce que la tenue d’un référendum était considérée comme facultative par le parlement néerlandais. Selon Jacques Thomassen, le résultat a mis en lumière l’écart qui existe entre l’opinion publique et l’élite politique.
Le résultat de l’initiative parlementaire ? Aux Pays-Bas, les partis politiques qui étaient en faveur du traité se sont désengagés du débat en estimant "qu’il appartient désormais au Parlement de résoudre un problème qu’il avait lui-même créé". Il s’ensuivait une campagne référendaire déséquilibrée qui était surtout dominée par les tenants du Non. Ils ont orchestré des thèmes très controversés aux Pays-Bas tels que l’introduction de l’euro, l’élargissement et l’adhésion de la Turquie. Les Néerlandais qui ont pu s’exprimer pour la première fois dans l’histoire via référendum sur l’Union européenne ont selon Jacques Thomassen utilisé cette opportunité pour exprimer leur désaccord.
Jacques Thomassen a finalement estimé que le référendum a politisé les enjeux de la construction européenne. Et cette politisation a conduit à une mobilisation des eurosceptiques. Quel enseignement a-t-on tiré de cet épisode aux Pays-Bas ? "De ne plus jamais avoir un référendum sur un tel sujet", a répondu Jacques Thomassen.
Michele Comelli ou les prémices d’une désillusion européenne liée au désenchantement de la politique
 Le succès de livres comme "Gomorra" de Roberto Saviano sur la mafia napolitaine et "The caste" sur la corruption en Italie ainsi que l’apparition du blog de Beppe Grillo, témoignent selon Michele Comelli, de l’Institut des affaires internationales, d’une certaine désillusion vis-à-vis de la politique italienne.
Le succès de livres comme "Gomorra" de Roberto Saviano sur la mafia napolitaine et "The caste" sur la corruption en Italie ainsi que l’apparition du blog de Beppe Grillo, témoignent selon Michele Comelli, de l’Institut des affaires internationales, d’une certaine désillusion vis-à-vis de la politique italienne.
Même si les Italiens ont regretté la disparition de la lire italienne, cela ne s’est pourtant pas traduit par un mécontentement général vis-à-vis de la politique européenne, la plupart des Italiens (39 %) étant en faveur de la construction européenne. Autre observation dressée par Michele Comelli : "Les Italiens ont moins de confiance dans les institutions européennes que par le passé. Mais leur confiance est supérieure à celle qu’ils ont dans les institutions au niveau national". Lors du vote sur le traité de Lisbonne, le Gouvernement italien a voulu envoyer un signal politique fort et a exercé une pression importante pour obtenir un vote positif au traité. L'Italie est ainsi devenue le 24e pays de l'Union européenne à ratifier le traité de Lisbonne. Le 31 juillet 2008, les députés italiens ont approuvé à l'unanimité, par 551 voix, la ratification du traité de Lisbonne.
S’il n’y a pas eu de référendum en Italie, c’est, comme l’a rappelé Michele Comelli, que le cadre législatif italien ne le permet pas dans le cas d’un traité international. Un référendum consultatif aurait été possible, mais très difficile à organiser pour des raisons législatives ; de plus, sur le plan politique, la question d’un référendum n’a pas été considérée comme une nécessité, et l’opinion publique n’en a pas exprimé la demande.
Pour expliquer la place importante de ces questions dans les débats, il a souligné l’importance du rôle de l’actuel Président de la République et de son prédécesseur, mais aussi le poids croissant des lobbies ou encore la position pro-européenne des diplomates et des militaires.
Quant aux rapports entretenus par le gouvernement actuel et celui qui l’a précédé avec les questions européennes, Michele Comelli estime qu’ils ont tous deux une attitude pro-européenne et favorable à l’élargissement (bien que la Lega Nord soit opposée à l’entrée éventuelle de la Turquie dans l’UE). La différence réside donc dans le parcours et les profils des représentants de ces gouvernements. Lle gouvernement Prodi avait en effet, selon Michele Comelli, des allures de Commission européenne à l’italienne. L’ancien commissaire européen Franco Frattini joue actuellement un rôle pro-européen important dans le gouvernement Berlusconi. Les ministres eurosceptiques y sont moins nombreux, et les relations avec les leaders européens se sont nettement améliorées par rapport au gouvernement italien précédent.
Débat : Nicolas Schmit a plaidé pour une Europe-puissance qui exploite les virtualités du traité de Lisbonne et Lydie Polfer pour une Europe qui est "une recherche permanente entre Etats-nations"
Le soir du colloque, un débat fut consacré aux négociations sur le traité constitutionnel et le traité de Lisbonne. Lydie Polfer, députée européenne, avait participé comme ancienne ministre des Affaires étrangères entre 1999 et 2004 aux négociations du traité de Nice, sous lequel l’Union européenne fonctionne depuis 2003 et à celle du traité constitutionnel, qui fut conclue lorsqu’elle était encore membre du gouvernement luxembourgeois. Elle mit en garde contre cette habitude prise de décrier le traité de Nice, qui fut selon elle en 2000 le meilleur résultat possible lorsque l’Union des 15 se préparait à devenir l’Union des 27. Pour elle, "le moteur de l’Union européenne est la tension entre les enjeux nationaux et les enjeux communautaires. Le plus important ne sont pas pour Polfer les traités ou les textes, sur lesquels la discussion dure depuis 10 ans, "mais la volonté politique".
 "Ce ne sont pas 10 ans de réunions et de discussions sur les traités, mais 23 ans, depuis l’Acte unique", lui a répliqué Nicolas Schmit, ministre délégué aux Affaires étrangères, et pendant le mandat ministériel de Lydie Polfer représentant permanent auprès de l’Union européenne. « Maastricht, en 1991, fut un vrai saut qualitatif. Amsterdam, en 1997, fut négocié, parce que cela avait été prévu, et l’on fit de nouveau des pas en avant sur les questions de justice et affaires intérieures. Mais la question de la taille de la Commission européenne n’était pas réglée. A Nice, l’on avançait péniblement, parce que l’Allemagne réunifiée voulait décrocher en nombre de voix au Conseil et de députés au Parlement européen la France. Un conflit entre petits et grands pays s’annonçait dans une Union qui allait être dominée, après l’élargissement, par des petits pays. L’idée de constitutionnaliser l’Union européenne est issue du malaise qu’a laissé la négociation de Nice."
"Ce ne sont pas 10 ans de réunions et de discussions sur les traités, mais 23 ans, depuis l’Acte unique", lui a répliqué Nicolas Schmit, ministre délégué aux Affaires étrangères, et pendant le mandat ministériel de Lydie Polfer représentant permanent auprès de l’Union européenne. « Maastricht, en 1991, fut un vrai saut qualitatif. Amsterdam, en 1997, fut négocié, parce que cela avait été prévu, et l’on fit de nouveau des pas en avant sur les questions de justice et affaires intérieures. Mais la question de la taille de la Commission européenne n’était pas réglée. A Nice, l’on avançait péniblement, parce que l’Allemagne réunifiée voulait décrocher en nombre de voix au Conseil et de députés au Parlement européen la France. Un conflit entre petits et grands pays s’annonçait dans une Union qui allait être dominée, après l’élargissement, par des petits pays. L’idée de constitutionnaliser l’Union européenne est issue du malaise qu’a laissé la négociation de Nice."
Pour Schmit, "Nice fonctionne, mais la Commission européenne est en état de mort clinique. Elle est devenue une sorte de secrétariat d’un Conseil où les vraies décisions sont prises. La Commission a été absente dans les dernières grandes crises. Or, s’il y a un leadership faible pendant les crises, comment faire face ? Nous avons eu la chance d’avoir eu une présidence française qui a su prendre les choses en main à un moment où les USA sont en pleine déconfiture. Si on reste avec Nice, nous aurons un G4 formé par l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume Uni qui devraient selon le président d’un grand pays voisin conduire l’Europe. De cette Union européenne, je ne veux pas. Choisir entre une Europe sans leadership et une Europe dirigée par une sorte de G4, c’est choisir entre Charybde et Scylla"
Schmit a mis en avant "les virtualités du traité de Lisbonne en matière de leadership". "En temps de crise il faut une Présidence de l’Union européenne permanente, qui ne change pas tous les six mois. Celle-ci est donnée par le traité de Lisbonne à travers le Président du Conseil européen, qui peut assurer une vraie continuité de la représentation de l’Union européenne à l’extérieur. Dans le contexte actuel, la seule manière de survivre, c’est que l’Europe devienne une Europe-puissance. L’Europe a une monnaie commune, elle doit devenir une puissance politique. Et pour cela, elle doit être lisible à travers son leadership. D’où la nécessité de trouver pour le traité de Lisbonne une solution tout en respectant le Non irlandais. Puis il faudra au moins dix ans de tranquillité constitutionnelle."
Tout en étant d’accord avec Schmit, Lydie Polfer a opiné que ce Président du Conseil européen devrait être élu, pour qu’il ait une vraie légitimité. Nicolas Schmit lui répliqua que la légitimité de Nicolas Sarkozy venait des Français, pas de l’Union européenne. Le président du Conseil européen sera, selon le traité de Lisbonne, élu par ses pairs du Conseil européen. Il aura donc sa légitimité propre. Comme l’élection du président de la Commission européenne par le Parlement européen donnerait à celui-ci une nouvelle légitimité. "Encore faudrait-il que ce président de la Commission développe aussi une volonté politique qui lui permette de tirer de son élection une vraie légitimité !", a conclu Schmit pour qui "l’Union européenne doit être là où l’on attend une Europe forte." Lydie Polfer conclut de son côté en qualifiant l’UE de "recherche permanente entre Etats-nations, qui sont à l’écoute de l’autre dans sa différence, les grands pays à l’écoute des petits, et vice-versa."
L’ambassadeur de la République tchèque, à qui échoit en janvier la Présidence du Conseil de l’Union européenne, prit la parole pour dire que l’Union européenne "est un club de réflexion et ne sera jamais une puissance. Il faut une puissance derrière l’Union européenne", déclara-t-elle comme représentante "d’un pays qui a été trop souvent confronté aux puissances".
Philippe Poirier : L’après référendum, ou la politique euro-nationale du Luxembourg
Philippe Poirier, professeur à l’Université du Luxembourg, a ébauché une image du contexte et des résultats du référendum au Luxembourg. D’après lui, la campagne électorale qui a précédé le référendum sur le traité constitutionnel fut fortement marquée par la Présidence luxembourgeoise de l’Union européenne, et par les dossiers qui ont dominé cette présidence : révision de la stratégie de Lisbonne, perspectives financières de l’Union, élargissement. Qui plus est, le Premier ministre Jean-Claude Juncker avait menacé de démissionner au cas où le Non l’emporterait au référendum.
Bien que 57 % des électeurs aient voté Oui, le score fut bien décevant pour les responsables politiques selon Poirier. Parmi les raisons qui ont amené les Luxembourgeois à voter en faveur du traité, l’on retrouve les sujets généraux de la construction européenne, le traité étant jugé "indispensable à la future construction européenne. Presque 40 % des défenseurs du Non par contre ont indiqué que le traité de Lisbonne aurait des effets néfastes sur l’emploi.
Philippe Poirier a ensuite dressé le tableau des différences et des similitudes entre les référendums français, néerlandais et luxembourgeois. Première grande distinction : contrairement à la France, le souverainisme libéral et le protectionnisme social n’ont pas encore trouvé de matrices électorales structurées au Luxembourg. Deuxièmement, les Luxembourgeois ont toujours une grande confiance dans l’état de la démocratie.
Au Luxembourg, le traité de Lisbonne a finalement été ratifié par voie parlementaire, et non par un nouveau référendum. Il a été voté le 29 mai 2008 par 47 voix contre 1, avec trois abstentions et 9 absents sur un total de 60 députés. Conclusion pour Philippe Poirier : la politique européenne du Luxembourg constitue un paradigme euro-national. Le Luxembourg reste fortement attaché à la méthode communautaire, tout en défendant des intérêts et priorités nationales au niveau européen.
Patrick Dumont, Sandra Boldrini : Belgique - une ratification à multiples niveaux

Patrick Dumont a estimé que "les enjeux nationaux ont largement dominé dans les débats autour du traité constitutionnel et le traité de Lisbonne". La Belgique connaissait en effet à l’époque des difficultés à former une coalition gouvernementale après les élections. Pourtant, la ratification des deux traités ne fut pas véritablement remise en question, puisqu’il existe, aux yeux du chercheur, "un consensus traditionnel sur l’intégration communautaire parmi les élites politiques et la population belges".
Sandra Boldrini s’est ensuite penchée sur la position belge sur le traité constitutionnel et le traité de Lisbonne. "Après les Non français et néerlandais, la Belgique s’est prononcée en faveur d’une continuation du processus de ratification", a-t-elle expliqué. En gros, les responsables politiques belges considéraient que le traité de Lisbonne était un "bon compromis". Les deux traités ont été ratifiés quasiment à l’unanimité par l’ensemble des parlements belges.
Sonja Putschner Riekmann : L’Autriche entre désirs européens et réaffirmations souveraines

Pour Sonja Putschner Riekmann, le personnage de Jörg Haider avait largement dominé et influencé la politique autrichienne à l’égard de l’Union européenne. Son parti, la FPÖ, très eurosceptique, avait formé une coalition gouvernementale avec la ÖVP entre 2000 et 2005. Au niveau européen, l’arrivée au pouvoir d’un parti d’extrême-droite avait entraîné des sanctions diplomatiques à partir de 1999. D’après la chercheuse autrichienne, ces sanctions ont rencontré l’incompréhension dans la population. "Par ailleurs, le parti n’était pas vraiment préparé à diriger le pays, et le gouvernement a vu une grande fluctuation de ministres", a expliqué la chercheuse. Une autre inquiétude est pour elle le fait que les dirigeants politiques des deux grands partis autrichiens, le SPÖ et le ÖVP, semblent évoluer dans une direction plus eurosceptique.
Cependant, les problèmes politiques internes de l’Autriche et l’arrivée au pouvoir d’un parti d’extrême-droite n’ont pas eu de conséquences sur la ratification du traité constitutionnel ni sur celle du traité de Lisbonne, qui ont tous les deux été ratifiés à l’unanimité moins une voix au parlement autrichien.
Rafal Trzaskowski : La Pologne, un "trouble maker "?

La Pologne aurait toujours compté une multitude de petits partis, souvent extrémistes. Mais depuis les dernières élections, la situation s’était stabilisée et la Pologne ne compte plus que quatre grands partis dans son parlement, dont le parti qui gouverne, la "Plate-Forme Civique". Tous les grands partis représentés au Parlement polonais sont pro-européens, même si certains d’entre eux ont conservé des approches souverainistes. Trzaskowsi continua que le traité de Lisbonne avait été ratifié par une grande majorité au Parlement polonais et qu’il bénéficie en outre du consentement d’une grande partie de la population et du président Kaczynski.
Avec "Droit et Justice", les citoyens polonais avaient élu en 2005 un parti plus enclin à la méthode intergouvernementale, qui avait par conséquent négocié le traité de Lisbonne avec une vue très forte des intérêts du pays. En ce qui concerne le vote à la majorité qualifiée au Conseil européen par exemple, la Pologne a obtenu presque autant de poids que les grands pays pour bloquer une décision. Rafal Trzaskowski passa en revue les statistiques des décisions prises au Conseil et constata que la Pologne avait plutôt tendance à bloquer d’importantes décisions, mais pour ce qui est des décisions au jour le jour, le pays s’est toujours montré très coopératif et constructif.
En conclusion, Rafal Trzaskowski constata que les problèmes et les peurs précédant l’élargissement de l’Union européenne étaient finalement sans objet : le Conseil et le Parlement européen fonctionnent bien, la Présidence slovène a été un vrai succès. L’image de la Pologne comme "trouble maker" ne serait donc pas vraiment justifiée et le nouveau gouvernement polonais pro-européen jouit d’une bonne réputation et du respect au sein de l’Union européenne, même s’il défend parfois de manière très dure ses intérêts, comme c’est dans le cas dans les discussions sur le paquet climat-/énergie.
Michael Marsh : La République d’Irlande : Un référendum ébranlant le traité de Lisbonne
Michael Marsh du Trinity College Dublin a livré une présentation des raisons du Non irlandais au traité de Lisbonne. Le tableau qu’a dressé le spécialiste fut assez sombre. D’après Michael Marsh, trois raisons expliquent pourquoi le Non a pu l’emporter au référendum irlandais. Premièrement, les élites politiques irlandaises étaient distraites par une affaire financière du Premier ministre qui remontait aux années 1990, ainsi que la décision de ce dernier de démissionner. Ensuite, les dispositions législatives interdisaient au gouvernement de financer une campagne électorale en faveur d’un Oui. "Les partis ont dû eux-mêmes se charger de la campagne électorale", a expliqué le professeur irlandais. Dernièrement, un financement massif et une bonne organisation de la campagne du Non a largement contribué au résultat.
Qu’ont fait alors les défenseurs du Non pour remporter un tel succès ? "Les nonistes ont tout simplement bâti sur le fait que pour la majorité des Irlandais, l’Union européenne est une bonne chose. Leur stratégie consistait à prétendre que le traité de Lisbonne aura surtout des conséquences négatives sur l’Europe et sur l’Irlande. Ils ont ainsi vendu le Non comme un maintien du statu quo", a expliqué le professeur. A l’opposé, la campagne du Oui n’avait pas de véritables arguments forts. D’après le professeur irlandais, une autre raison pourquoi les Irlandais ont voté non est le fait qu’ils ont eu très peu d’informations objectives sur l’Union européenne et le traité de Lisbonne.
Finalement, Michael Marsh a porté l’attention du public sur les implications d’un deuxième référendum sur le traité de Lisbonne. Le professeur voit mal comment un deuxième référendum pourrait donner un meilleur résultat. "Une deuxième campagne pourrait difficilement faire pire. Mais en raison des contraintes financières et le manque d’intérêt de la population, un deuxième référendum sera difficile à organiser", a-t-il conclu.
Brendan Donnelly : Incertitude britannique sur le traité de Lisbonne

Aux yeux de Brendan Donnelly, la démission de Tony Blair et l’arrivée au pouvoir de Gordon Brown aurait davantage compliqué les négociations au niveau européen. Après l’échec du traité constitutionnel, Tony Blair avait, à la surprise générale, consenti à coopérer avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel pour les négociations du traité de Lisbonne. Gordon Brown était par contre beaucoup plus critique à l’égard du traité de Lisbonne, et il a refusé de participer à la cérémonie de signature officielle du document.
Au moment du Non irlandais, le processus de ratification était déjà beaucoup trop avancé en Grande-Bretagne, et il n’était plus possible de faire marche arrière. Mais d’après le chercheur britannique, les choses sont loin d’être réglées. "La situation politique de Gordon Brown s’est empirée ces dernières années, et il est très probable que le parti conservateur battra le Labour aux prochaines élections. Dans les rangs conservateurs, il existe un consensus sur l’idée que, si tous les pays auront ratifié jusqu’aux prochaines élections britanniques, le traité de Lisbonne sera accepté. Mais s’il n’a pas encore pu entrer en vigueur d’ici là, le nouveau gouvernement pourrait rouvrir la ratification britannique et organiser un référendum qui se terminera par un refus du traité de Lisbonne par la population britannique", a mis en garde Donnelly.
Le débat sur l’Irlande et le Royaume-Uni
Un débat très animé a suivi les exposés. La discussion a soulevé de nombreuses questions, notamment celle du manque d’information qu’il y a eu en Irlande pendant la campagne précédant le référendum. Claire Fitzgibbon de l’ambassade de l’Irlande a souligné que les Irlandais étaient en réalité pro-européens, qu’il fallait maintenant s’occuper de leurs questions et en aucun cas presser le pays à la ratification du traité.
Une autre intervention portait sur la formulation de la question lors d’un deuxième référendum irlandais. Serait-ce juste de demander aux citoyens irlandais de faire un choix entre la ratification du traité de Lisbonne et le retrait de leur pays de l’Union européenne ? Cette question resta sans réponse précise. On a également abordé le rôle joué par la presse dans ce contexte. Est-ce que celle-ci déforme la réalité et véhicule une image trop négative de l’Union européenne ? Il reste certainement des d’éclaircissements à faire et des responsabilités à déterminer. Pour conclure, le constat s’imposa que l’Union européenne est une matière difficile à expliquer aux citoyens qui nécessite une légitimation démocratique pour disperser la méfiance générale qui règne à son égard.
Les expériences de démocratie délibérative
L’après-midi fut consacrée aux expériences de démocratie délibérative dans le cadre du plan D - comme démocratie, dialogue et débat - de la Commission européenne


Sylvie Strudel, de l’Université de Tours, aborda dans son exposé les différents types de citoyenneté européenne et la manière "difforme et disproportionnée" dont l’Union européenne était perçue. La citoyenneté européenne n’est pas identique à celle de l’Union européenne. La dernière est définie par des textes qui renvoient à un ensemble hiérarchique, la première est liée à des ambitions post-nationales. L’approche politique de la question de la citoyenneté européenne constate que si elle est conçue en analogie avec la citoyenneté de l’Etat-nation, elle découple nation et citoyenneté. L’approche juridique ne retient que la citoyenneté de l’Union européenne. Mais ceux qui sont parmi les juristes penchant vers la citoyenneté de résidence la jugent pusillanime, car elle est limitée et exclut les résidents des Etats tiers. Pour les sociologues, la citoyenneté européenne a été pensée par le haut, mais quand il s’agit de la mettre en œuvre, cela se fait avant tout de manière hésitante en ce qui concerne le droit de vote et l’éligibilité. Les personnes concernées représentent au plus 2 % de la population de l’Union. 15 % de ces 2 % sont inscrits sur les listes électorales, et le progrès des inscriptions est lent. Ce n’est qu’en ancrant l’exercice de la citoyenneté européenne dans des problèmes forts comme c’est le cas dans l’exercice de la citoyenneté dans les Etat-nations que l’on pourra passer "de son incantation à son incarnation."
L’Europe a-t-elle atteint la fin de son cycle constitutionnel ?
Larry Siedentop, de l’Université d’Oxford, s’efforça de répondre à répondre à cette question en lançant une volée de bois vert contre le traité de Lisbonne, car pour lui, "c’était une erreur de transposer autant du traité constitutionnel dans le traité de Lisbonne." Il faudrait procéder de manière sérielle, problème par problème, plutôt que de ficeler d’aussi gros paquets que ces traités-là. Pour Siedentop, déçu que depuis le Non irlandais il n’y ait eu que des discussions de stratégie à court terme, "le traité de Lisbonne est mort".
Pour le professeur anglais, l’Europe est de nouveau en crise. S’agit-il d’une crise de légitimité ou d’un défi démocratique ? Si les Irlandais ont voté non, c’est parce qu’ils n’ont pas été consultés sur le traité lorsqu’il fut élaboré. Et lorsqu’ils le furent après la conclusion du traité, ils ont voté Non. En gros, Siedentop constate un déclin des idées politiques en Europe, et les jeunes générations pensent que la prévention de la guerre par l’Europe est une chose acquise. Comment alors refonder les idées sur l’Europe, et ce contre le nationalisme rampant qui n’est pas le nationalisme sinistre d’autres temps, mais qui ne doit pas moins déclencher une certaine angoisse au sujet des futures institutions de l’Union européenne ?
Siedentop a cité toute une série de paradoxes dans l’ultime évolution de l’Union européenne. Ainsi, les Non français, néerlandais et maintenant irlandais aux référendums montrent que ces peuples ont paradoxalement défendu leurs démocraties représentatives. D’autre part, le Parlement européen est la seule institution européenne qui a augmenté son pouvoir. Malgré sa légitimité démocratique, il a cependant failli à établir son autorité auprès de l’opinion publique. Autre aspect : les partis et les classes politiques nationaux, confrontés à leur crise de légitimité, prennent leurs distances avec l’Union européenne, qui devient un mélange bizarre entre consumérisme, bureaucratie et des brins de démocratie.
D’où selon Siedentop la nécessité que les partis politiques nationaux se réengagent dans le projet européen, et qu’à la crise, l’on réponde par un processus constitutionnel européen, mais un processus lent, progressif, où tout ne soit pas présenté d’un coup. Ce processus doit coller aux réalités européennes, il doit rapprocher l’Union européenne des gens et il doit aspirer à faire de l’Union un pouvoir mondial. Mais avec la professionnalisation de la vie politique, cela est d’autant plus difficile que celle-ci a entraîné un déclin de la vie constitutionnelle par la précision et la technicité des chartes politiques qu’elle entraîne. "C’est un fait historique que l’Union européenne n’a pas hérité d’un sens constitutionnel comme c’est le cas pour les USA."
Il faut aussi être plus réaliste quant aux conséquences de l’élargissement. Les conflits d’intérêt deviennent de plus en plus possibles, par exemple quand il s’agit de définir les relations avec les USA ou avec la Russie. Va-t-on vers la constitution d’un nouvel Empire ? Difficile d’y répondre pour Siedentop, mais il adviendra sûrement une nouvelle relation entre les marchés et leur régulation par les Etats. Et l’on ne pourra pas exclure qu’un jour, l’on arrive à la formation d’un peuple européen. Mais pour que l’on arrive à cela à travers un système démocratique, il faut que la politique remplisse trois conditions : qu’elle soit intelligente, qu’elle arrive à mobiliser et orienter l’opinion publique par une démarche éducative, et aussi qu’elle divertisse, par la présentation des enjeux et le débat qui est mené.
Lukas Sosoe, de l’Université de Luxembourg, est parti du constat qu’une constitution représente un consensus dans lequel peut s’articuler le pluralisme des intérêts nationaux, de sorte que seule la nation peut être un élément fondateur de la dimension constitutionnelle. "Dans l’Union européenne, ce qui manque est le sentiment d’être des pionniers", comme ce fut le cas lorsque de nouveaux Etats furent fondés à la fin du colonialisme. En tout cas, il n’est pas possible de passer à une constitution européenne sans parler d’intérêts nationaux. Mais l’Union peut-elle être démocratique alors qu’elle opère dans un monde tellement spécialisé qu’il dépasse les compétences des citoyens, un monde qui recèle des caractéristiques post-démocratiques où tout se passe entre experts et dirigeants politiques ? Face à cette tendance, Sosoe constate cependant que les citoyens savent ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. La démocratie serait-elle alors un leurre dans l’UE? Ou bien ne faudrait-il pas envisager une politique européenne normale comme des politiques européennes nationales qui sont décidées dans un cadre intergouvernemental, comme le veut le traité de Lisbonne ? Pour faire avancer l’Europe, Sosoe ne voit qu’une seule condition : que les intérêts nationaux soient satisfaits dans un cadre commun.