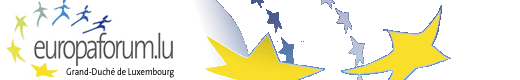Economie, finances et monnaie - Traités et Affaires institutionnelles
"Je suis fier, très fier, d’être le père de cet euro-là, car il n’aurait pas été possible de créer autrement la monnaie unique", confie Jean-Claude Juncker au Temps à l’occasion du 20e anniversaire de la signature du traité de Maastricht
07-02-2012
Le 7 février 1992, Jean-Claude Juncker, alors ministre des Finances, était à Maastricht pour la signature du traité créant l’Union économique et monétaire (UEM). Vingt ans après, Le Temps et le TagesAnzeiger publient de longs entretiens qu’il a accordés aux journalistes suisses Richard Werly, pour le quotidien francophone, et Stephan Israel, pour le quotidien germanophone. Le Premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe leur a réaffirmé sa conviction que la monnaie unique reste le meilleur atout de l’Union européenne dans un monde globalisé. Dans ces entretiens où l’évocation de souvenirs se fait à la lumière de l’actualité, Jean-Claude Juncker se pose en défenseur du modèle social européen, tout en affirmant que "c’est un tort de croire que l’assainissement financier – la rigueur, que beaucoup confondent avec l’austérité – est contradictoire avec la création d’emplois".
pour le quotidien germanophone. Le Premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe leur a réaffirmé sa conviction que la monnaie unique reste le meilleur atout de l’Union européenne dans un monde globalisé. Dans ces entretiens où l’évocation de souvenirs se fait à la lumière de l’actualité, Jean-Claude Juncker se pose en défenseur du modèle social européen, tout en affirmant que "c’est un tort de croire que l’assainissement financier – la rigueur, que beaucoup confondent avec l’austérité – est contradictoire avec la création d’emplois".
"Si la Grèce sort de l’euro, le prix de notre solidarité sera encore plus élevé!", met en garde Jean-Claude Juncker
"La survie de la monnaie unique ne passe-t-elle pas par une faillite de la Grèce ?" C’est par cette question, devenue un leitmotiv ces derniers jours, que Richard Werly commence l’entretien. "Je n’ai pas changé d’opinion: la Grèce restera dans la zone euro, parce qu’aucune autre option sur la table n’est envisageable, pour Athènes comme pour les autres pays dotés de la monnaie unique", affirme Jean-Claude Juncker qui rappelle "que les traités européens ne prévoient aucun mécanisme d’éjection d’un Etat membre, et qu’une sortie de la Grèce ne signifierait en rien un allégement du fardeau financier pour la communauté".
"Ceux qui, en Allemagne, fulminent contre la fameuse `Union de transfert´ oublient que le sauvetage du pays, si celui-ci revient à la drachme, nous coûtera des montants inimaginables en terme de fonds structurels puisqu’il restera membre de l’UE", indique encore le Premier ministre luxembourgeois aux yeux duquel "si la Grèce sort de l’euro, le prix de notre solidarité sera encore plus élevé". Jean-Claude Juncker ne perd pas non plus de vue les "conséquences stratégiques d’un naufrage de la Grèce, avant-poste de l’Union européenne entre les Balkans et la Turquie". "Sommes-nous prêts à assister sans bouger à cet affaissement total, qui serait aussi le nôtre?", s’interroge Jean-Claude Juncker qui réaffirme que "nous avons vis-à-vis des Grecs un devoir de solidarité, au diapason de la solidité des réformes entreprises".
L’erreur est aujourd’hui "de répéter notre discours traditionnel sur l’Europe de la paix et de la guerre", un discours certes "justifié", mais qui "laisse les jeunes générations indifférentes", analyse le Premier ministre luxembourgeois
Pour le président de l’Eurogroupe il ne fait aucun doute qu’en 2032, soit quarante ans après la signature du Traité de Maastricht, "l’euro sera une monnaie stable, et protégera le pouvoir d’achat interne des pays qui l’ont adopté", d’ailleurs plus nombreux qu’aujourd’hui selon ses prévisions. "La force de l’Europe sera d’avoir, avec l’euro, une monnaie de réserve à l’égal du dollar et, sans doute, du yuan chinois", assure Jean-Claude Juncker qui estime que c’est ainsi que "notre Vieux Continent, devenu proportionnellement, de plus en plus petit, compensera ainsi son relatif déclin". "La géographie, comme la démographie, ne jouent pas en notre faveur", explique en effet le Premier ministre luxembourgeois pour qui "un euro fort est la condition d’une Europe qui pourra continuer d’influence le cours des choses dans un monde globalisé, grâce à la puissance et à la solidarité nouée autour de son marché intérieur".
"C’est ce message que nous devons inculquer aux jeunes générations", pense Jean-Claude Juncker qui confie que l’erreur est aujourd’hui "de répéter notre discours traditionnel sur l’Europe de la paix et de la guerre", un discours certes "justifié", mais qui "laisse les jeunes générations indifférentes". "Ce qu’il faut, c’est observer la réalité", plaide Jean-Claude Juncker, convaincu que "la démographie nous obligera à resserrer les rangs".
"Je suis fier, très fier, d’être le père de cet euro-là, car il n’aurait pas été possible de créer autrement la monnaie unique", déclare le président de l’Eurogroupe
Jean-Claude Juncker revient ensuite longuement sur la naissance de l’euro, créé "sur la seule base viable au sein de l’Union européenne : celle d’Etats souverains qui acceptent in fine de se doter d’une banque centrale indépendante, pour mettre leur monnaie commune à l’abri de l’action publique immédiate". "Nous avons tous dû faire des efforts colossaux pour en arriver là", rappelle ainsi celui qui a été à la fois acteur et témoin privilégié du processus qui a conduit à Maastricht. Jean-Claude Juncker se souvient "que l’Allemagne ne voulait faire aucun compromis sur la Banque centrale", tandis que la France "exigeait un gouvernement économique". "Berlin voulait d’un euro avec moins de pays, sans l’Italie ou la Belgique", quand "Paris, de son côté, ne pouvait pas imaginer de laisser de côté un seul pays fondateur de la Communauté", raconte Jean-Claude Juncker pour décrire "le chantier sur lequel nous  avons bâti l’euro".
avons bâti l’euro".
Pour autant, Jean-Claude Juncker ne considère pas que la monnaie unique ait été "le prix à payer pour la réunification" allemande. "La décision de créer l’euro remonte très exactement à la mise en place du comité Delors des gouverneurs des banques centrales, en octobre 1988", rappelle-t-il, et "personne ne prévoyait alors la chute si rapide du Mur de Berlin et de l’Allemagne de l’Est", même s’il reconnaît que "la perspective de la faisabilité de la réunification a bien sûr accéléré les choses". "La naissance de l’euro, pour moi, est intervenue en mai 1991, lors d’un conseil informel des ministres des Finances à Luxembourg", se souvient le Premier ministre luxembourgeois : "Nous avons compris, avec Jacques Delors, que la monnaie unique verrait le jour lorsque le Royaume-Uni a accepté la dérogation que nous lui avons proposé, suivi par le Danemark".
"Je suis fier, très fier, d’être le père de cet euro-là, car il n’aurait pas été possible de créer autrement la monnaie unique", déclare Jean-Claude Juncker qui se dit "partagé entre la religion allemande de l’orthodoxie budgétaire absolue, et la conviction française qu’il faut laisser de la place à l’action politique". Or, selon lui, "la monnaie unique est le fruit de cette inévitable synthèse" et c’est à ses yeux un choix que "nous ferions encore aujourd’hui car il reste le seul possible sur la base d’Etats souverains et attachés à leurs prérogatives".
Aux yeux de Jean-Claude Juncker, "ce que l’écrivain néerlandais Geert Mak appelle les deux hémisphères de l’Europe monétaire" a été sous-estimé
Les tensions internes à la zone euro, "on les a très vite vues à l’œuvre", admet Jean-Claude Juncker qui évoque quelques moments de tensions dans les années 1990. Mais il reconnaît surtout que "ce que l’écrivain néerlandais Geert Mak appelle les deux hémisphères de l’Europe monétaire" a été sous-estimé. "La légèreté avec laquelle ces questions sont abordées au sud du continent est une réalité problématique", constate le président de l’Eurogroupe qui avoue que "nous avons là péché par ignorance". Mais à ses yeux, "le mérite essentiel de la monnaie unique est toutefois que ces différences culturelles s’estompent". Comme il le répète souvent, Jean-Claude Juncker regrette que le gouvernement économique ait été "trop négligé", tandis que l’indépendance de la Banque centrale européenne s’est révélée "être un rempart contre les excès immédiats".
S’il n’a pas de regrets "sur la manière de faire aujourd’hui des dirigeants européens", Jean-Claude Juncker constate un changement. Ainsi, il trouve que par rapport au temps du Traité de Maastricht, "l’Europe est sans doute devenue moins conviviale". "Il y avait, à l’époque, plus de volonté commune de bien faire ensemble", se souvient-il, quand il observe aujourd’hui "davantage de volonté de se singulariser". "Les modes de pensée et d’action ont changé et les dirigeants habitués à dresser des ponts, comme moi, sont peut-être moins sollicités", note le président de l’Eurogroupe.
"C’est un tort de croire que l’assainissement financier – la rigueur, que beaucoup confondent avec l’austérité – est contradictoire avec la création d’emplois", souligne Jean-Claude Juncker
Lorsque Richard Werly lui demande s’il fait "partie de ceux pour qui le retour de compétitivité est aujourd’hui un impératif absolu", Jean-Claude Juncker souligne que "les mots `compétitivité´ et `concurrence´ ont une connotation péjorative" qu’il dit ne pas partager. A ses yeux, "il s’agit d’assurer à l’Europe sa place, d’affronter d’autres grandes puissances : c’est la simple observation de la réalité". Ce qui, selon lui, ne sera pas possible sans une reconsolidation des finances publiques. "On ne pourra pas faire de saut qualitatif en matière d’emploi si nous laissons péricliter nos finances", juge en effet Jean-Claude Juncker pour qui "c'est un tort de croire que l’assainissement financier – la rigueur, que beaucoup confondent avec l’austérité – est contradictoire avec la création d’emplois". "Ce qu’il faut, c’est trouver la bonne intersection, avec des politiques bien ciblées et des injections d’aide appropriées", préconise le Premier ministre luxembourgeois.
Jean-Claude Juncker, qui se pose en défenseur du modèle social européen, considère que le marché "crée de l’efficacité économique, que nous devons, en Europe, continuer d’utiliser pour une juste répartition des richesses"
Jean-Claude Juncker se pose en défenseur du modèle social européen, faisant "le pari que, dans vingt ans, les Européens n’auront pas abandonné leur modèle sociétal, pour glisser vers une organisation qui prenne congé de nos vertus économiques et sociales". Le président de l’Eurogroupe, appelle ainsi à cesser de chercher, à la faveur de la crise de la dette, "la main invisible du marché". "Elle n’existe pas", affirme-t-il. A ses yeux, "le marché est incapable de créer de la solidarité", mais "il crée de l’efficacité économique, que nous devons, en Europe, continuer d’utiliser pour une juste répartition des richesses". "Je lutte pour retrouver la confiance des Européens et ma conviction est qu’ils n’abandonneront pas ce projet", conclut Jean-Claude Juncker.