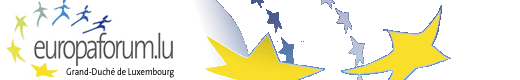Entreprises et industrie - Economie, finances et monnaie - Marché intérieur
Table ronde sur les destinées de la sidérurgie européenne: entre globalisation et patriotisme économique?
13-09-2012
Les 13 et 14 septembre 2012, le Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman de Luxembourg organisait, en coopération avec l'université d'Aix-Marseille et l'académie François Bourdon du Creusot, un colloque international d'histoire intitulé "Mutations de la sidérurgie mondiale du XXe siècle à nos jours – Les destinées de la sidérurgie européenne".
Le premier jour se tenait notamment une table ronde baptisée pour sa part "Les destinées de la sidérurgie européenne: entre globalisation et patriotisme économique? ". Il mettait aux prises le directeur de la DG Industrie de la Commission européenne, Gwenole Cozigou, l'ancien vice-président de la Commission européenne (1981-85) et auteur du plan éponyme, Etienne Davignon, le ministre luxembourgeois du Travail, Nicolas Schmit, et le président du Conseil d'administration d'ArcelorMittal-Luxembourg, Michel Wurth. Lors de cette discussion modérée par le journaliste économique du Luxemburger Wort, Pierre Leyers, le monde syndical n'était pas représenté en raison de l’absence pour cas de force majeure du représentant de la Fédération européenne des métallurgistes.
La situation actuelle au regard de la crise des années 70
Michel Wurth : "L'Europe est plus pénalisée que les autres pays"
 C'est le président du Conseil d'administration d'ArcelorMittal-Luxembourg, Michel Wurth, qui, en guise d'introduction au débat, a resitué l'évolution de la sidérurgie depuis 1945. Les Trente glorieuses furent celles de l'augmentation annuelle de la consommation d'acier, qui fut plus élevée que la croissance économique, jusqu'à atteindre à la fois un pic et une crise en 1973-74. S'en est suivie jusqu’en 1998 la quasi-stagnation de la consommation d'acier. "L'intensité de l'utilisation de l'acier dans la croissance était en recul" jusqu'à ce que à la faveur du développement des pays émergents et principalement de la Chine, la consommation reprenne un rythme soutenu sans toutefois retrouver le volume d'avant la crise des années 70. Ainsi, en 2011, la consommation mondiale atteignait 152 millions de tonnes d'acier, quand celle-ci flirtait avec la barre des 200 millions de tonnes en 1973, ce qui indique une "baisse structurelle", explique Michel Wurth.
C'est le président du Conseil d'administration d'ArcelorMittal-Luxembourg, Michel Wurth, qui, en guise d'introduction au débat, a resitué l'évolution de la sidérurgie depuis 1945. Les Trente glorieuses furent celles de l'augmentation annuelle de la consommation d'acier, qui fut plus élevée que la croissance économique, jusqu'à atteindre à la fois un pic et une crise en 1973-74. S'en est suivie jusqu’en 1998 la quasi-stagnation de la consommation d'acier. "L'intensité de l'utilisation de l'acier dans la croissance était en recul" jusqu'à ce que à la faveur du développement des pays émergents et principalement de la Chine, la consommation reprenne un rythme soutenu sans toutefois retrouver le volume d'avant la crise des années 70. Ainsi, en 2011, la consommation mondiale atteignait 152 millions de tonnes d'acier, quand celle-ci flirtait avec la barre des 200 millions de tonnes en 1973, ce qui indique une "baisse structurelle", explique Michel Wurth.
La crise de 2007-08 a elle aussi eu des conséquences sur la consommation globalement en recul, mais à des niveaux très variables selon les pays. Ainsi, en 2007 et 2011, la consommation espagnole a baissé de 52 %, l'italienne de 31 %, la française de 22 % mais l'allemande de 5 %.
La sidérurgie n'a plus la place qu'elle occupait jadis. Elle est aujourd'hui tout juste "un des maillons de la chaîne de transformation des métaux".
Les prix à la hausse des matières premières, la sidérurgie beaucoup plus performante (l'énergie consommée pour une tonne a été divisée par deux par rapport à 1970) et la progression de la productivité (9,5 heures de travail pour une tonne d'acier en 70, une heure pour une tonne aujourd'hui), expliquent également le recul de l'emploi, passé, depuis 1970, d'un million à 250 000 personnes actives dans ce secteur dans l’UE.
Au final, la sidérurgie en Europe ne permet pas de générer assez d'argent pour se renouveler, encore moins pour donner des dividendes aux actionnaires. De plus, elle souffre de surproduction. Michel Wurth cite un rapport allemand selon lequel l'Europe a une surproduction de 65 millions de tonnes.
Le secteur fait face à trois grands problèmes. "La part de la valeur ajoutée diminue, pour des raisons de manque de concentration, de réduction de la consommation et des raisons technologiques". Dans ce cas, une entreprise mondialisée comme ArcelorMittal se concentre là où il y a une croissance soutenue, à savoir les mines et les pays émergents
Enfin, un problème "spécifique de la sidérurgie en Europe" seraient dans les charges imposées aux entreprises. "Quand on voit la problématique du CO2, quand on voit l'importance relative qui est mise par le pouvoir politique et par les organisations au niveau de l'environnement, à ce moment là, l'Europe est plus pénalisée que les autres pays", déplore Michel Wurth.
Pour le patron d'ArcelorMittal Luxembourg, c'est un "certain sentiment anti-industrie en Europe, beaucoup plus fort que dans des pays comme la Chine qui ont vu leur avenir dans l'acier", qui explique qu'on ait "pénalisé un peu l'industrie européenne par des salaires et des coûts réglementaires plus élevés."
Pour autant, l'exemple de l'industrie allemande montre qu'il est encore possible d'avoir une industrie florissante en Europe. "Si l'Europe veut garder une industrie, c'est dans la transformation des métaux que cela va se jouer; Car nous sommes nulle part sinon : dans les nanotechnologies, nous sommes relativement faibles, dans l'industrie électronique, les leaders ne sont pas européens", pense en effet Michel Wurth. En termes d'innovations, la sidérurgie européenne est "au sommet du monde".
Etienne Davignon : "L'intervention publique a été l'instrument du retour à la logique économique"
 Ancien commissaire en charge du marché intérieur et des affaires industrielles, à partir de 1977, puis vice-président de la Commission européenne entre 1981 et 1985, Etienne Davignon a laissé son nom au plan de restructuration de la sidérurgie européenne mis en œuvre à partir de 1977. La sidérurgie européenne était alors confrontée à une "surcapacité structurelle". Le plan Davignon a réduit ses capacités annuelles de production de 32 millions de tonnes (sur 126 millions) sur 5 ans et a provoqué la disparition de 250 000 emplois.
Ancien commissaire en charge du marché intérieur et des affaires industrielles, à partir de 1977, puis vice-président de la Commission européenne entre 1981 et 1985, Etienne Davignon a laissé son nom au plan de restructuration de la sidérurgie européenne mis en œuvre à partir de 1977. La sidérurgie européenne était alors confrontée à une "surcapacité structurelle". Le plan Davignon a réduit ses capacités annuelles de production de 32 millions de tonnes (sur 126 millions) sur 5 ans et a provoqué la disparition de 250 000 emplois.
Etienne Davignon s'est attaché à expliquer la démarche de la Commission européenne à l'époque et de commenter la situation actuelle où le secteur est en phase de restructuration.
Le plan Davignon fut un exemple où "l'intervention publique a été l'instrument du retour à la logique économique". La Commission européenne, en tant que garante de la bonne application du traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), a pu déclarer la situation dite de "crise manifeste" et intervenir pour remettre en ordre un marché largement perturbé par les soutiens publics des Etats à leur sidérurgie.
Les Etats compensaient ainsi la "surcapacité structurelle" qu'allait identifier la Commission européenne, et déréglaient dans le même temps les lois de la concurrence libre et non faussée. "Quand vous avez une surcapacité structurelle, la non-adaptation de cette capacité ne permet pas aux lois du marché de fonctionner", a expliqué Etienne Davignon.
"Pour que la loi de l'offre et de la demande joue, il faut qu'elle soit aussi réelle que possible. Or elle ne jouait pas car elle était pervertie par les compensations publiques au non-fonctionnement de la réalité économique", a-t-il poursuivi. "Tout le monde a compensé la surcapacité et l'impact de la surcapacité sur la réalité économique. A partir du moment où le traité permettait à l'instance responsable du fonctionnement du traité de réaliser son objectif, c'est-à-dire de faire en sorte par voie autoritaire, d'adapter l'offre à la demande, il fallait le faire."
Pour Etienne Davignon, il fallait adapter les capacités et non procéder à des "arrêts provisoires", dit-il en référence à la situation actuelle. Et si le choc social fut violent, il était "le prix à payer pour le non-ajustement au changement des circonstances extérieures", et donc pour le manque d'anticipation des entrepreneurs alors que "le choc était totalement prévisible".
Etienne Davignon constate d'ailleurs que la situation actuelle, en termes de problèmes d'anticipation, n'est pas vraiment différente. Il est dommageable, selon lui, que le suivi du secteur sidérurgique consacré par le traité de Paris instituant la CECA, fut abandonné, une fois que ce dernier a expiré. Cette absence aura été "un élément qui a permis de croire que la continuation de l'anticipation n'était pas nécessaire à la fois au niveau des besoins et des perceptions des acteurs du secteur".
Si aujourd'hui, les raisons pour faire des restructurations ne sont pas identiques, notamment parce que les éléments technologiques sont différents, la nécessité est la même.
Nicolas Schmit : "Si la CECA a pu être lancée et devenir un grand succès, être le berceau de l'intégration européenne, c'est parce qu'on mettait les syndicalistes à bord"
 Le ministre du Travail, Nicolas Schmit, explique que le plan Davignon a sauvé la sidérurgie au Luxembourg. Toutefois, ce qu'il souhaite mettre en valeur, ce sont les acquis sociaux, aussi bien ceux nés de la création de la CECA que ceux hérités de la crise des années 70.
Le ministre du Travail, Nicolas Schmit, explique que le plan Davignon a sauvé la sidérurgie au Luxembourg. Toutefois, ce qu'il souhaite mettre en valeur, ce sont les acquis sociaux, aussi bien ceux nés de la création de la CECA que ceux hérités de la crise des années 70.
"La philosophie CECA, c'est une philosophie sociale", a-t-il en effet expliqué. Le modèle de la CECA était encore le résultat de l'expérience de la guerre mondiale, et a introduit ainsi la coopération entre partenaires sociaux. "Si la CECA a pu être lancée et devenir un grand succès, et être le berceau de l'intégration européenne, c'est parce qu'on mettait les syndicalistes à bord", pense-t-il.
Puis est venue la crise. Nicolas Schmit rappelle dans ce contexte, que 1974, année de la crise de la sidérurgie, est pour le Luxembourg l'année du record absolu de production d'acier (6,4 millions de tonnes), tandis que l'année 1975 fut celle "où les syndicats ont obtenu de meilleures augmentations salariales". L'exemple illustre ainsi la critique du manque d'anticipation émise par Etienne Davignon.
Nicolas Schmit rappelle par ailleurs que la gestion de la crise a aussi été l'occasion d'acquis sociaux, aujourd'hui ballottés mais toujours bien présents. Face à la situation, plutôt qu'une gestion "à l'américaine", on avait opté pour un système de gestion "non pas seulement économique mais aussi social". Au Luxembourg, où un actif sur quatre travaillait alors dans le secteur, furent créés les instruments tels que la division anti-crise (DAC) par laquelle on occupait les gens partiellement dans la sidérurgie ou ailleurs à des travaux extraordinaires, mais aussi la préretraite, outil qui sert encore aujourd'hui à " gérer les sureffectifs".
Ceci fut permis notamment par le dialogue social avec l'objectif partagé par tout le monde de sauver des emplois et de limiter les conséquences sociales des suppressions. "Ces instruments ont été préservés. L'état d'esprit a peut être un peu changé depuis. La crise elle aussi est différente. Mais il reste quand même quelque chose encore de ce modèle-là", observe le ministre du Travail.
Gwenole Cozigou : "Nous avons l'impression que nous sommes davantage entendus qu'à une certaine époque au Conseil et au Parlement"
 Le directeur de la DG Industrie de la Commission européenne, Gwenole Cozigou, a commencé par défendre les "coûts environnementaux" dénoncés par Michel Wurth au début de la table-ronde. Ils relèvent pour lui de l'anticipation. La Commission part du raisonnement qu'"une adaptation de notre politique énergétique, par anticipation des hausses du coût des matières premières énergétiques que nous utilisons massivement actuellement, serait inévitable et que par conséquent anticiper serait une bonne chose", a-t-il tranché sans oublier de rappeler que la Commission a reconnu la nécessité d'un traitement spécifique pour les entreprises à haute intensité en énergie.
Le directeur de la DG Industrie de la Commission européenne, Gwenole Cozigou, a commencé par défendre les "coûts environnementaux" dénoncés par Michel Wurth au début de la table-ronde. Ils relèvent pour lui de l'anticipation. La Commission part du raisonnement qu'"une adaptation de notre politique énergétique, par anticipation des hausses du coût des matières premières énergétiques que nous utilisons massivement actuellement, serait inévitable et que par conséquent anticiper serait une bonne chose", a-t-il tranché sans oublier de rappeler que la Commission a reconnu la nécessité d'un traitement spécifique pour les entreprises à haute intensité en énergie.
Pour aider l'industrie, l'action de la Commission européenne se concentre sur trois axes : la R&D, les matières premières et la politique commerciale.
Certes; la situation par rapport aux années 70 a changé : "Nous avons d'abord beaucoup moins d'acteurs qu'à l'époque, nous avons un marché largement globalisé, il n'y a plus de tarifs douaniers en ce qui concerne l'UE et nous sommes totalement ouverts", souligne le fonctionnaire. Toutefois, la Commission se donne les moyens d'agir en mesurant l'impact des législations sur la compétitivité en général, "élément qui n'était pas pris en compte de manière complète" auparavant. Elle procède aussi au "fitness check", qui consiste à évaluer une proposition législative, selon son impact en termes de cohérence de la législation, et à nettoyer tout obstacle administratif et toute lourdeur et autres impasses juridiques qui se constituent dans la législation avec le temps.
L'action de la Commission européenne est par ailleurs facilitée par la crise. En effet, avant cette dernière, "dans l'approche en matière de politique industrielle, on a connu toutes sortes de modes et à une époque, c'était quasiment un gros mot de parler d'industrie. Le terme à la mode était la société postindustrielle. De ce point de vue là, la crise a joué un rôle positif, elle a au moins réveillé les consciences, l'industrie a par défaut démontré son importance pour l'économie en général. Désormais, quand nous venons avec des préoccupations en matière d'industrie, nous avons l'impression que nous sommes davantage entendus qu'à une certaine époque au Conseil et au Parlement européen."
Le Patriotisme économique européen : une notion qui ne plaît guère aux orateurs
La deuxième partie de la table-ronde se penchait sur la pertinence de l'idée d'un patriotisme économique européen, lequel n'a suscité d'ailleurs que très peu de ferveur.
Etienne Davignon a souligné qu'il y avait " ambiguïté sur le sujet". 'Est-ce mal d'être attentif à l'endroit où un produit est fait au moment où on l'achète ? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'il suffit que quelque chose soit produit quelque part pour faire en sorte que les produits concurrents ne puissent pas faire la concurrence ? La réponse est non. Juridiquement, ce n'est pas possible et techniquement, ça ne fait pas de sens."
Pour Gwenole Cogazou, "opposer patriotisme économique européen et mondialisation est limitatif". L'intérêt européen peut se retrouver dans le recours judicieux à la globalisation. Ainsi, cite-t-il en exemple, la bonne santé de l'industrie chimique allemande largement due au fait que les produits semi-finis sont sous-traités à l'Asie. Le membre de la Commission européenne constate pour conclure que le terme de patriotisme économique européen est "souvent connoté protectionnisme". "Pour une puissance exportatrice ce n'est pas forcément la priorité du moment", en déduit-il.
Michel Wurth n'est pas opposé à cette notion de patriotisme économique. Il serait possible en son nom de revenir sur les coûts qui grèveraient sensiblement les capacités de l'industrie européenne. "Le patriotisme européen, c'est à la fois faire en sorte que les externalités négatives de la réglementation européenne soient les moins grandes possibles et si possible aussi, qu'on crée des externalités positives, comme la coopération en matière de recherche."
Par contre, il est satisfait de l'existence de l'Europe lorsqu'il s'agit de mettre un frein à un patriotisme qui est plus local. "On trouve un peu ce patriotisme chaque fois qu'il y a un dossier difficile qui se présente. Les hommes et femmes politiques, les syndicalistes, au Luxembourg, en Belgique ou en France, quand il y a une restructuration à mener, ont plutôt tendance à être patriotiques et à dire : "faites le à l'extérieur, ne le faites pas chez nous"." La limite qu'apportent à ce patriotisme la Commission et le marché commun sont "un des grands atouts de l'Europe" comme ce fut également "un des grands atouts du plan Davignon".
Pour Michel Wurth, la solution passe bien plus par de nouvelles concentrations afin de faire naître sur le sol européen des entreprises capables de rivaliser au niveau mondial. Pour cela, il faudrait conduire "une nouvelle réflexion sur l'interprétation des concentrations dans un marché mondial dans lequel la part de l'Europe n'est plus la même qu'avant, quand, à l'époque de M. Davignon, elle produisait encore un tiers de l'acier dans le monde."
Nicolas Schmit affiche son scepticisme vis-à-vis de ce concept : "On ne peut pas simplement mettre entre parenthèses la mondialisation. Elle est un fait. Et nous devons simplement l'accepter et nous y adapter. Mais nous y adapter ne suffit pas. Il faut aussi un minimum la façonner."
Il faut en conséquence un minimum de règles : "L'Europe doit à la fois jouer le rôle de défenseur du libre échange mais à la fois aussi de défenseur d'un certain nombre de règles en matière d'organisation du système commercial en général, voire de la mondialisation."
Par contre, pour ce qui est de l'avenir de l'industrie européenne, c'est bien plus par une politique économique adaptée à la situation que par le patriotisme qu'il faudrait agir. "Si l'Europe se condamne pour les dix, quinze ans à venir à être une économie qui tourne absolument au ralenti, où la croissance économique ne reprend pas, il est clair que des secteurs comme la sidérurgie, comme l’automobile, vont tourner au ralenti et on va devoir faire face à des restructurations encore bien pires que celles qu'on a connues aujourd'hui."
Le salut passe donc par le renoncement à l'austérité. "Il faut savoir gérer les calendriers, gérer les temps en matière de réduction des déficits. Mais si on le fait de manière à complètement étrangler l'économie européenne, (…) il ne faut pas s'étonner que des entreprises qui auraient la possibilité de tourner avec une rentabilité correcte, vont fermer leurs portes."
L'objectif partagé en Europe doit être de trouver comment le continent peut "disposer d'une industrie performante, autrement productive sinon elle ne va pas tenir le choc de la mondialisation".
L'avenir de l'industrie
Michel Wurth : "Pour simplifier les choses, il faut dire qu'il faut suivre l'Allemagne."
"Pour avoir une industrie à développer, il faut d'abord avoir des clients, et ensuite être compétitifs lorsqu'un produit doit s'adapter à ce que le client demande. Ce sont les deux choses sur lesquels il faut travailler", considère Michel Wurth.
"Par des partenariats intelligents, on peut créer des avantages compétitifs." Toutefois, c'est par la réduction des coûts qu'il faut commencer pour être compétitifs. Sur les dix dernières années, l'évolution des coûts salariaux unitaires montrent une différence de 20 % entre la France et l'Allemagne, et de 40 % entre le Luxembourg et l'Allemagne. "L'industrie a de l'avenir en Europe. L'industrie allemande, et surtout celle transformatrice des métaux, en est l'exemple. (…) Cela montre qu'on peut le faire. L'excédent commercial allemand par rapport à la Chine est une réalité. Il ne faut pas regarder trop loin ce qu'il faut faire. (…) Pour simplifier les choses, il faut dire qu’il faut suivre l'Allemagne."
Interrogé sur l'avenir de l'industrie européenne, dans lequel il croit, Etienne Davignon insiste sur l'action que la Commission européenne avait menée sous son égide. Même si la Commission n'a plus les mêmes moyens d'action, l'industrie ne peut se passer d'un "observateur extérieur" qui puisse dire ce qui, dans les problèmes rencontrés, "est structurel ou conjoncturel". "L'entrepreneur est suspect. L'entrepreneur, pour faire passer un certain nombre de changements, va être perçu comme opportuniste. (…) Nous ne serions jamais arrivés là où nous en sommes si l'objectivation des besoins par rapport aux interlocuteurs sociaux n'avait pas eu lieu." De même, il estime que "la confiance dans la capacité à réaliser des choses difficiles" est le deuxième élément primordial pour vaincre ce défi.
Nicolas Schmit : "Il n'y a pas de secteurs condamnés. Il y a des technologies condamnées."
"Il n'y a pas de secteurs condamnés. Il y a des technologies condamnées. Le défi est la capacité novatrice, et la capacité d'avoir les niveaux de productivité les plus élevés possible", a déclaré Nicolas Schmit. Il faut pour cela "trouver un bon équilibre entre les contraintes économiques et le social." Le système de cogestion allemand, auquel Volkswagen doit une grande partie de son succès, montre que cela peut être bénéfique à l'industrie.