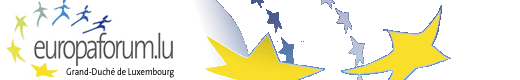Emploi et politique sociale - Traités et Affaires institutionnelles
Dans un entretien à la Aachener Zeitung, Jean-Claude Juncker imagine une nouvelle "chorégraphie" pour une future Europe élargie qui tournerait autour d’un noyau-dur, avec des pays qui trouveraient leur place en orbite
26-10-2012
Le Premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe a accordé aux journalistes Bernd Mathieu et Marco Rose un entretien qui a été publié dans la Aachener Zeitung le 26 octobre 2012 et qui porte essentiellement sur la période de crise que traverse la zone euro.
Dans la situation actuelle, il en va "de la stabilité de la zone euro", mais aussi de l’influence de l’UE dans le monde, explique le président de l’Eurogroupe qui considère que ce que l’UE a bien à offrir dans le concert des nations, c’est bien l’euro, car la puissance économique européenne serait peu de choses sans la monnaie unique.
"La politique européenne se trouve en panne d’explications"
Jean-Claude Juncker observe aussi, non sans inquiétude, que les ressentiments nationaux sont à nouveau en vogue, que l’idée que chacun pourrait faire mieux seul qu’avec les 26 autres s’ancre dans les têtes. Ce qu’il explique notamment du fait que, face à des processus toujours plus complexes et confus que la mondialisation a contribué à générer, on choisit des solutions simples, que l’on comprend spontanément. Or, on comprend mieux ce qui est proche de nous que ce qu’il faut considérer dans des contextes plus larges, poursuit Jean-Claude Juncker qui voit là un terrain idéal pour le populisme.
"La politique européenne se trouve en panne d’explications", constate le président de l’Eurogroupe, conscient que "les gens ne comprennent pas ce que nous faisons", mais aussi que la critique est toujours plus facile que des réponses qui nécessiteraient des pages d’explications que peu liraient.
Nouvelle chorégraphie autour d’un noyau-dur, avec des pays qui trouveraient leur place en orbite de l’UE
Jean-Claude Juncker souligne toutefois que "nous allons mieux qu’il y a cinquante ans", et, s’il ne veut en rien minimiser ce qui se passe en Grèce, il ne cache pas sa circonspection face à la "larmoyance collective" qu’il observe. Il poursuit en disant constater "avec satisfaction et étonnement que les pays européens qui ne sont pas dans l’UE tentent de toutes leurs forces de devenir membres de l’UE", ce qui pose de nouvelles questions auxquelles il va falloir, dit Jean-Claude Juncker, répondre de façon adéquate.
Pour sa part, il n’est pas d’avis que l’UE pourra continuer à se développer avec 35 ou 36 membres sans que la chorégraphie d’ensemble ne soit réajustée.
"Je crois que nous allons devoir nous entendre à un moment sur un certain nombre de missions centrales européennes auxquelles participera une coalition de volontaires", poursuit le président de l’Eurogroupe. Il cite comme exemple la monnaie ou le marché intérieur.
Pour des pays qui ne peuvent ou ne veulent pas participer, il faut créer une orbite autour de ce noyau-dur européen, imagine Jean-Claude Juncker. Il pense par exemple à la Turquie qui pourrait peut-être s’y retrouver un jour si elle ne veut pas participer à tout ce que l’UE veut faire avancer, mais aussi au Royaume-Uni qui "émigrera peut-être un jour sur cette orbite". Car si le gouvernement britannique veut déjà aujourd’hui se défaire de pans entiers de la politique européenne, Jean-Claude Juncker l’interprète comme un signe de l’avancée de cette tendance à la séparation.
"Il n’est pas normal que nous ayons levé toutes les barrières commerciales et que les barrières sociales restent"
Lorsque les journalistes lui demandent à quelles compétences pourrait renoncer ce noyau-dur européen, Jean-Claude Juncker évoque les débats théoriques en cours sur les compétences que l’Europe pourrait rendre aux Etats, soulignant toutefois qu’il ne lui a jamais été présentée de liste détaillée. Pour sa part, il imagine qu’on pourrait laisser plus de champ au niveau local en matière de protection de l’environnement.
Mais il ajoute aussi qu’il y a des domaines inachevés, notamment en matière de politique sociale, et il juge qu’il serait judicieux de s’entendre sur un socle minimal de normes sociales en Europe. "Il n’est pas normal que nous ayons levé toutes les barrières commerciales et que les barrières sociales restent", s’indigne-t-il, plaidant pour des standards minimaux en matière de droit du travail ou de protection contre le licenciement. En clair, le Premier ministre luxembourgeois voit plus de sujets sur lesquels il faudrait que l’Europe avance plus que de thèmes dont elle devrait rester en dehors.
Et s’il y a eu un échec sur ces questions sociales, c’est, répond Jean-Claude Juncker à la rédaction du quotidien allemand qui se demande si ce n'est pas la faute aux lobbies, en raison de la folie néolibérale qui a saisi le monde développé et de l’appât du gain que trop de gens partagent. Pour le Premier ministre luxembourgeois, c’est aussi lié au fait que "les sociaux-démocrates n’ont pas été à la hauteur de leur propre mission et ont laissé choir le social sous la table". Il évoque ainsi un temps où il s’est senti "très seul au Conseil européen", et ce fut pourtant à une période où 13 des 15 chefs d’Etat et de gouvernement étaient des sociaux-démocrates. "Je pouvais facilement les doubler par la gauche, il y avait largement la place", glisse-t-il encore.
Plaidoyer pour un socle minimum en termes de droits des salariés, pour que "le salariat européen se réconcilie avec l’UE"
Quand les deux journalistes lui demandent si ces standards sociaux devraient avoir des répercussions sur d’autres continents, Jean-Claude Juncker leur répond qu’il imagine plutôt une hausse de leur impact sur le continent européen. Car il constate, - avec lucidité, commente-t-il - qu’une "grande partie du salariat ne se reconnaît pas dans cette Europe". L’intégration européenne est née de l’amour entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates et des forces principales de la société, à savoir le salariat d’un côté et le patronat de l’autre, raconte Jean-Claude Juncker qui note que le mouvement syndical est toujours allé dans le sens d’une plus grande intégration européenne. Pourtant il constate qu’avec la crise, les travailleurs sont nombreux à se détourner de l’UE. Et s’il propose un socle minimum en termes de droits des salariés, c’est aussi parce qu’il aimerait que le salariat européen se réconcilie avec l’UE, confie le Premier ministre luxembourgeois. Il est certain, poursuit-il, que ce modèle social européen doit être conçu de sorte que d’autres parties du monde puissent y découvrir un modèle à transposer chez eux, un modèle non contraignant qui permet de maintenir en mouvement une société harmonieuse.
"N’est-ce pas le contraire qui a lieu actuellement dans le Sud de l’Europe ?" A cette remarque des journalistes, Jean-Claude Juncker confie que son grand souci est que, si l’on ne fait pas infiniment attention, on en arrive, dans un Sud de l’Europe déjà compliqué politiquement, il pense surtout à la Grèce, à des troubles sociaux extrêmes. C’est d’ailleurs pour cela, qu’il insiste autant pour qu’on stimule la croissance de ces pays, indique-t-il à la rédaction du quotidien allemand. Mais il ne perd pas non plus de vue que, même réduit, le salaire minimum grec reste plus élevé que celui de la Slovénie, de la Slovaquie, du Portugal ou de Chypre. "C’est un terrain difficile que celui sur lequel nous avançons", commente le président de l’Eurogroupe.