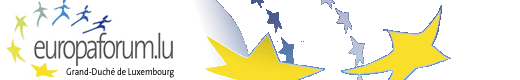Commerce extérieur - Emploi et politique sociale - Marché intérieur
La précarité, "sous-bassement et résultat" d’une construction européenne dont "l’objectif premier est d’accroître la compétition entre les Etats, les gouvernements et les citoyens", selon Bruno Poncelet et Ricardo Cherenti du réseau "Econosphères"
16-05-2014
Invités pour la seconde fois en quelques mois au Luxembourg, les deux Belges auteurs du livre "Le grand marché transatlantique, les multinationales contre la démocratie" (première édition 2011 – seconde édition 2014, éditions Bruno Leprince), Bruno Poncelet et Ricardo Cherenti étaient à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2014, sur invitation d’ATTAC Luxembourg, de l'Association Stop TAFTA Luxembourg ainsi que des Amis du Monde Diplomatique Luxembourg. Présents une première fois en novembre 2013, occasion lors de laquelle ils avaient largement abordé le projet de partenariat transatlantique (TTIP) négocié entre l’UE et les USA et ses dangers, les deux auteurs, qui collaborent tous deux au réseau "Econosphères", se sont cette fois penchés sur les biais de la construction européenne reposant selon eux sur la précarité.

Ce diplômé en sciences politiques, en psychanalyse et en philosophie a tout d’abord tenu à préciser le concept de précarité, compris la plupart du temps comme la précarité financière qui elle-même peut conduire à la pauvreté. "La pauvreté a deux définitions : la pauvreté objective qui est égale à un seuil placé à 60 % du revenu médian", explique Ricardo Cherenti qui note qu’en Belgique, 15 % de personnes se trouvent sous ce seuil. A cette définition "objective" s’en ajoute une autre subjective, qui concerne le ressenti des personnes face à la pauvreté. Toujours en Belgique, elles sont cette fois 21,3 % à se dire pauvres.
"C’est un hiatus qui s’explique probablement parce que les gens ne prennent pas en compte leur situation telle qu’elle est mais l’imaginent telle qu’elle pourrait être", affirme-t-il. L’auteur souligne ainsi que les enquêtes d’opinion annuelles menées en France et en Belgique montrent que 68 % des Français ont peur d’être sans domicile fixe un jour, et 56 % des Belges craignent de devoir avoir recours aux CPAS. "C’est dire à quel point les gens ont peur du lendemain", poursuit-il.
Quand la lutte contre la pauvreté devient l’accumulation de biens
"L’opposé parfait" de la pauvreté, la richesse, va "marquer très fortement" le chemin de la lutte contre la pauvreté, lutte dans laquelle l’Europe va beaucoup s’investir, rappelle l’auteur. "Il y a au 18e siècle un basculement à propos de la richesse. C’est Malthus, économiste, qui va la définir. Il dit que la richesse, c’est beaucoup de choses : la poésie, l’amour, le bonheur, l’accumulation de biens, etc. Mais, ajoute-t-il, on ne peut pas mesurer tout ça, l’amour, la poésie ne se mesurent pas, et comme je veux mesurer l’évolution de la société, je ne vais prendre que ce qui est mesurable", note Ricardo Cherenti.
"C’est un biais impressionnant : dès ce moment, la richesse ne sera plus considérée qu’en fonction des biens matériels, ce qui va devenir petit à petit le produit intérieur brut (PIB). Dans cette conception, on ne prend en considération que ce qu’on peut compter et inversement, ce qui ne peut être compté ne compte plus. Petit à petit on arrive à une Europe très matérialiste, dont l’imaginaire collectif est basé sur l’accumulation des biens", note-t-il.
Dans cette conception où la richesse est définie de manière comptable, la lutte contre la pauvreté va consister à "aller vers du bien matériel". "Il y a deux manières de lutter contre la pauvreté. La façon collective, qui est d’augmenter toujours plus le PIB, et la façon individuelle, qui consiste à prendre le chemin du salaire, donc chercher un travail, et puisque ce chemin devient impératif, la norme travail devient également impérative. Le travail devenant un impératif moral, il faut travailler à tout prix, et surtout à n’importe quel prix : nous devons accepter n’importe quel travail et dans n’importe quelles conditions", poursuit Ricardo Cherenti. De ce fait, en Europe, une tendance à la généralisation des bas salaires va se développer, relève-t-il.
L’auteur souligne que l’une des méthodes "très efficaces" développées par l’Union européenne en la matière est la méthode ouverte de coordination (MOC), elle aussi basée sur une "logique comptable". "Cette MOC est une sorte de benchmarking, de comparaison entre les pays dans un grand tableau, et c’est par cette comparaison qu’on va essayer de tirer les pays vers le haut"
Le chômage n’est "désormais plus un problème mais une solution"
Ricardo Cherenti cite notamment la transformation du concept de lutte contre le taux de chômage en augmentation du taux d’emploi. "On n’est plus du tout dans la même logique puisque augmenter le taux d’emploi peut très bien se faire en accroissant le taux de chômage. On peut donc se demander si le chômage est encore un problème en Europe : en réalité, non, le chômage est désormais une solution. Et à partir d’un certain moment, si le chômage baisse trop, des voix s’élèvent pour dire qu’il doit être augmenté", affirme-t-il.
Ainsi en 2008, Jean-Claude Trichet, alors à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), s’était inquiété d’un taux de chômage qui baissait trop en Europe. "Il se basait sur une théorie de Milton Friedman qui dit qu’il y a un taux de chômage naturel en dessous duquel on ne peut pas aller sinon on va créer une inflation beaucoup trop importante. Ce taux de chômage naturel était estimé en France autour de 9 %, donc lutter contre le chômage au-delà de cette limite était, dans sa conception, aller contre l’intérêt, avant tout des multinationales, mais surtout du bien commun", rapporte le conférencier.
Le taux de chômage serait ainsi devenu "une solution" dont profitent tout particulièrement les multinationales, estime Ricardo Cherenti, "parce qu’il faut veiller à diminuer les salaires, et plus le taux de chômage va croître, plus les salaires vont être réduits, c’est un principe assez clair". Si malgré tout, le niveau des salaires devait se stabiliser, il suffit d’étendre la base de comparaison : "On passe de 28 à 30 Etats membres, on va prendre des pays plus pauvres et il va y avoir comparaison par rapport aux salaires moindres", souligne-t-il.
D'un sytème de protection sociale universel vers un système particulier
Autre solution, le détricotage de tout ce qui relève de la sécurité sociale. "On le voit très fortement en Belgique où il y a une dégressivité des allocations de chômage, une fin de droit après trois ans d’allocations d’insertion et des exclusions de plus en plus fréquentes des allocataires du chômage", appuie l’auteur, selon lequel ce détricotage de la sécurité sociale conduit d’un système universel, général et pris en charge par les Etats, à un système qui est local, individuel, particulier et pris en charge par les communes.
Ricardo Cherenti rappelle les engagements du millénaire de l’ONU, qui, en l’an 2000, avait décidé d’éradiquer la pauvreté en 30 ans et ceux, plus prudents, de l’UE qui s’était engagée à une diminution très importante en 20 ans. "En 2007, 60 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en Europe. Elles étaient 80 millions en 2010 et sont 115 millions en 2014… La lutte contre la pauvreté, telle qu’on la met en place, ne marche pas", ajoute-t-il.
En réalité, relève l’auteur, le taux de pauvreté dans le monde n’a cessé d’augmenter. "Mais l’ONU a dit ‘attention’, le taux de grande pauvreté, lui, a diminué. Si on regarde les chiffres, en effet, la grande misère a diminué. Désormais, si on regarde les textes européens et internationaux, on verra qu’on ne lutte plus contre la pauvreté, on lutte contre la grande pauvreté. Et c’est encore plus vicieux que ça en Europe, dans la stratégie 2020, on ne lutte plus contre la pauvreté, mais contre la pauvreté des enfants. Tout simplement car il n’y avait pas de consensus pour lutter contre la pauvreté en général, en revanche on est dans l’émotion quand on parle des enfants", poursuit Ricardo Cherenti. "J’aimerais bien qu’on m’explique comment lutter contre la pauvreté des enfants en y laissant leurs parents", appuie-t-il.
Les systèmes sociaux "sur le chemin de la marchandisation"
Un deuxième type de précarité évoqué par l’auteur est la précarité relative aux systèmes sociaux. "C’est très important car nous avons des services sociaux efficaces", rappelle-t-il. "Dans la ‘directive services’, on a décidé de marchandiser l’entièreté des services publics : l’Europe n’aime pas les services publics et vise à privatiser tous les services publics et à les mettre en concurrence, sauf la sempiternelle exception culturelle qui touche plus particulièrement les services audiovisuels", estime Ricardo Cherenti.
Si l’Europe "n’aime pas" les services publics, elle dit néanmoins que les services sociaux "doivent être protégés". Pour les protéger, elle crée une exception au principe général de mise en concurrence pour ces services. Mais la particularité est que, alors qu’elle donne le principe général dans la directive, l’exception n’y apparaît pas : "elle se trouve dans une annexe", explique le conférencier. "On dit : ‘Ne vous tracassez pas, ça ne vous concernera pas.’ Eh bien demain ça concernera les systèmes sociaux qui devront être en concurrence, qui devront recourir aux marchés pour des services publics, sociaux, de base, comme par exemple le revenu d’intégration", prévient-il.
Le projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP), que l’auteur préfère nommer "grand marché transatlantique", négocié actuellement entre l’UE et les USA, repose sur "le même principe de mise en concurrence de tous les services, de marchandisation de tout, sauf ici aussi l’exception culturelle" qui fait selon lui figure de "cache-sexe". "Quand on met une exception, c’est qu’on accepte tout le reste."
L’auteur relève d’ailleurs que le patronat s’est fait fort "de briser" tout ce qui concerne la protection sociale. Et de citer l’ancienne présidente du patronat français, Laurence Parisot, qui déclarait en 2010 que "la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?". "Effectivement la santé, l’amour, la vie sont précaires, mais ce que fait Laurence Parisot, c’est prendre une précarité ontologique, naturelle (l’homme naît mortel), et la mélanger avec une précarité sociale, construite et qui dépend des rapports sociaux", appuie-t-il.
Dans cette conception, puisque l’un est précaire, l’autre doit l’être aussi. "Ce ne sont que des mots, mais ça marche : dans beaucoup de législations, on va considérer qu’effectivement l’ensemble des éléments de la vie doivent être précarisés, parce que ça permettrait aux gens de rebondir. Ce principe parcourt toutes les législations sociales actuelles, on appelle ça ‘l’Etat social actif’, vise à amener petit à petit les gens vers le bas, et quand ils auront touché le fond, forcément ils vont rebondir et aller plus haut."
Cette tendance à la précarisation se retrouve au niveau européen également. Ainsi l’UE a-t-elle inventé le concept de "soft law", des "lois souples" par oppositions aux lois "dures" qui s’appliquent avec des sanctions en cas de non-respect. "Ce sont des sortes de recommandations non assorties de sanctions. Donc si 5 ou 6 pays font quelque chose, on va essayer de montrer l’exemple aux autres en disant que ce serait bien de faire pareil. Vous pouvez très bien résister, mais quand on passe de 5 ou 6 à 10 Etats, puis à 15, à 20 et à 25, ça devient plus difficile." L’auteur cite le cas de l’indexation automatique des salaires, cas bien connu en Belgique et au Luxembourg où ce principe reste d’application. "Au moins une fois par an, l’Europe recommande sa révision. Si la Belgique ne le fait pas, il n’y a pas de sanction, mais quand il y en a 25 qui le font, la pression est immense et donc vous avez intérêt à le faire", souligne-t-il.
"La précarisation de la prise de parole et de l’engagement"
Enfin, Ricardo Cherenti est revenu sur ce qu’il nomme "la précarisation de la prise de parole et de l’engagement". "Nous sommes dans une société étrange qui a décidé depuis le 18e siècle d’objectiver toute vie en société. C’était l’époque des découvertes des lois physiques et on s’est dit à l’époque que les lois sociales devaient prendre le même chemin : il doit y avoir des lois strictes, mathématiques. On a donc objectivé la vie en société, ce qui est très grave parce qu’on a ‘désubjectivé’ les individus et on a tout rationalisé."
Ainsi, "face à une équation, quand on dit 1+1=2, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas vous engager là-dessus, vous ne pouvez que constater", regrette-t-il. Et de citer le terme de "gouvernance", qui a remplacé celui de gouvernement, et qui se traduit par "le gouvernement des élites, des experts, ceux qui connaissent la mathématisation des relations". "Quand vous êtes face à cela, vous ne vous engagez plus, vous ne prenez plus la parole, et vous avez une forme de précarisation qui devient un dysfonctionnement humain."
La société étant sur une "pente de précarisation" selon l’auteur, "chacun est affecté par la peur de tomber dans la pauvreté". La précarisation influerait sur la peur à trois niveaux : la peur de soi dans une société de l’évaluation permanente et face à "des défis insupportables", la peur de l’autre, mis en évidence comme le concurrent dans une compétition permanente, celui contre qui il faut se battre et, enfin, la peur de l’avenir où tout est risqué, y compris l’environnement, la technologie, etc.
La compétition permanente entraîne par ailleurs un sentiment de "frustration égalitaire", appuie encore l’auteur. "Auparavant, on regardait les personnes très riches, on ne trouvait pas ça juste et on se disait qu’il fallait combattre cette situation vers plus d’égalité. Aujourd’hui on regarde son voisin, celui qui a à peu près la même chose que soi, et on se dit ce n’est pas normal", explique-t-il. "L’exemple-type, si je suis un bas salaire, c’est le chômeur : ‘il a presque la même chose que moi, ce n’est pas normal’. Et le chômeur va regarder celui qui a l’aide sociale et dire ‘ce n’est pas normal’. Et celui qui à l’aide sociale va dire c’est la faute de l’étranger. Et l’étranger va dire que c’est la faute de l’étranger non-européen… Et ainsi de suite on reporte la faute sur l’autre", constate-t-il
Or, lorsque l’on a peur, on se désengage, prévient l’auteur qui estime que cela crée "un problème démocratique fondamental". "Lors du référendum français sur la constitution européenne, Daniel Cohn-Bendit avait déclaré que ce projet était trop sérieux pour qu’on demande l’avis du peuple. C’est ce à quoi on arrive quand on est dans la précarisation, on considère que seul l’expert peut parler, ce qui est totalement antidémocratique".
Pourquoi les politiques européennes "ne fonctionnent pas"

Selon l’auteur du livre "Europe, une biographie non autorisée" publié aux éditions Aden en 2014, il s’agit pour comprendre de se pencher sur la naissance de l’UE, lors de laquelle six Etats vont se regrouper pour, selon la version officielle, pacifier le continent européen marqué par les deux guerres mondiales en créant un projet commun pour l’Allemagne et la France notamment. "Mais il y a une version officieuse : l’UE a six parents officiels, mais lors d’une naissance, si on est toujours sûr de la maman, ce n’est pas le cas pour le père", souligne Bruno Poncelet. "Et les historiens savent bien que les USA avaient un très grand intérêt à créer un bloc et un projet européens", appuie-t-il.
Les USA, "papa" clandestin de l’UE
Ainsi, relate-t-il, lors de la mise en place du plan Marshall au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’une des conditions d’octroi de l’aide financière promise par les USA est l’adhésion à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques). Celle-ci impliquait "déjà" "l’ouverture du commerce entre les Etats européens et avec les USA", poursuit l’auteur. Par ailleurs, ajoute-t-il, leur octroi était également conditionné à une participation par les gouvernements européens à un "fonds de compensation" : pour un million de dollars prêté par les USA, un million de dollars des gouvernements de l’UE devait abonder ce fonds.
"Environ 5 % de ces fonds étaient réalloués directement à la CIA pour toute une série de projets de cette agence de renseignements sur le sol européen", affirme Bruno Poncelet, qui cite notamment le coup d’Etat en Grèce ayant mené à la dictature des colonels de 1967 à 1974. L’agence américaine de renseignement aurait d’ailleurs financé massivement tous les mouvements politiques favorables à la création de l’UE, ces formations ayant reçu "énormément d’argent de la part de la CIA", assure-t-il. "On estime, même si les chiffres ne sont pas sûrs, qu’environ 50 millions de dollars ont été versés entre 1949 et 1959 dans cet objectif".
La CIA aurait également largement financé des opérations de "propagande culturelle". Alors que les USA sont en pleine "guerre contre le communisme", le communisme reste en Europe une idée très populaire, dominant même les partis majoritaires en France ou en Italie. "La CIA a mis en place toute une série de mécanismes d’influence culturelle secrète afin de lutter contre l’antiaméricanisme et le communisme. Autrement dit, il s’agissait d’utiliser la sphère artistique pour essayer d’influencer les représentations européennes." La CIA ne pouvant par ailleurs pas agir sur ses fonds propres en Europe, on a créé "des fondations bidon ou on en a utilisé des existantes : la fondation Ford, la fondation Rockfeller", poursuit-il.
Selon l’auteur, la naissance de l’Europe a "dès le départ été un jeu de dupe au niveau diplomatique, avec un papa clandestin, l’oncle Sam", auquel s’ajoute un autre problème consubstantiel, le problème démocratique. Ainsi, Bruno Poncelet relève une surreprésentation du pouvoir exécutif dans l’UE. "Au niveau national, la logique des partis fait que l’exécutif et le législatif se confondent, et au niveau de l’UE, le pouvoir exécutif est surreprésenté : le gouvernement de l’UE, c’est le Conseil, donc les gouvernements nationaux. En outre, la Commission européenne est aussi une forme d’exécutif, alors que, s’il a de plus en plus de pouvoir depuis 1979, le Parlement européen est dans la situation inédite de ne pas pouvoir écrire les lois", appuie-t-il. Si cet état de fait n’était "pas trop grave du temps de la CECA, où les compétences européennes étaient très limitées, aujourd’hui l’Europe a grandi géographiquement et en termes de compétences".
Les législations sociales, salariales et fiscales "au menu" des entreprises
"Suite à la crise des années 80, il y a un vide au niveau politique, puis vient l’idée de fiancer l’Europe à la Table ronde des industriels européens, un lobby composée d’une vingtaine de PDG", explique Bruno Poncelet. "En 1986, la signature de l’Acte unique est le fruit du travail de ce lobby : le discours est le suivant : les petites économies nationales qui n’ont pas beaucoup d’habitants ne peuvent pas s’en sortir, en revanche, avec un grand marché européen… C’est le discours selon lequel le bonheur collectif passe par l’augmentation du PIB qui est exactement le même que celui d’aujourd’hui sur le grand marché transatlantique."
Le discours est ainsi identique, mais les résultats ont-ils été au rendez-vous ? "Non", répond Bruno Poncelet, qui souligne que la création d’un grand marché a eu avant tout pour conséquence une logique de "fusions-acquisitions" qui a elle-même entraîné un "étirement de la distance entre les lieux d’emploi où les gens travaillent et ceux où ils décident", ce qui constitue un "terrible appauvrissement" en encourageant le dumping social.
Si l’UE harmonise de nombreuses lois, ce n’est pas le cas des politiques salariales, de la sécurité sociale, de l’impôt des sociétés ou des prestations sociales, relève-t-il. Ainsi, "on a créé un grand restaurant pour les entreprises qui ont à leur menu les législations sociales, salariales, fiscales grâce au marché européen. Aujourd’hui il y a 28 plats au menu, demain avec le TTIP et les USA, il y en aura 78 à la carte". La précarité est ainsi "un cadeau" offert "aux investisseurs étrangers pour les fidéliser", notamment via la flexibilisation du travail.
L’auteur juge ainsi que les règles du jeu mises en place lors de la création du marché unique sont "mauvaises" et qu’elles ont largement contribué à la hausse de la pauvreté et au creusement des inégalités. Depuis le "mariage de l’UE au marché unique", Bruno Poncelet note que l’UE a été plongée dans une série de "valses financières" avec la création de l’euro ou de la BCE, qui ont pâti "de mauvais choix". Ainsi la BCE est-elle "la seule institution monétaire publique auprès de laquelle les Etats ne peuvent pas emprunter mais les banques oui", poursuit-il, soulignant "le déséquilibre" entre des règles plus favorables pour le privé que celles mises en place pour le public, qui conduit à une "privatisation du public".
Exemple selon l'auteur: "la crise des subprimes, ces prêts pourris, a résulté de la spéculation menée par les banques sur les pauvres, jusqu’à ce qu’elles se rendent compte avoir perdu leur pari. Elles n’avaient pas prévu que, si des millions de gens perdaient leur logement en même temps, le marché immobilier s’effondrerait. Et quand cela s’est produit, les banques se sont dites ‘trop grosses pour faire faillite’. Environ 1 600 milliards d’euros d’argent public ont servi à ce sauvetage massif."
Si, à l’époque, un discours de moralisation du capitalisme et de surveillance accrue des marchés s’était fait jour, aucune mesure concrète, comme l’octroi à la BCE de la capacité de prêts aux Etats, n’a été décidée. "On a laissé un système peu démocratique le devenir encore moins : lors de la crise de la zone euro, on a appelé comme médecins les agences de notation pour adapter l’économie de l’UE. Ils ont prescrit une austérité radicale qui a fait exploser la pauvreté." En outre, les budgets nationaux ont été placés sous surveillance budgétaire de la Commission européenne via le semestre européen. "Les Etats doivent désormais rendre compte sur base de critères financiers, et il est grave que ces critères l’emportent sur les critères démocratiques."
De même, dans les négociations de libre-échange menées par l’UE, "l’objectif premier de l’UE est d’accroître la compétition entre les Etats, les gouvernements et les citoyens", affirme Bruno Poncelet, qui souligne que les arbitres en seront les multinationales et les investisseurs. "Loin de corriger les déséquilibres existants, on s’y enfonce de manière de moins en moins démocratique", poursuit-il. Pour que fonctionne un marché national, il faut des instances nationales, idem au niveau européen et encore plus au niveau transatlantique. "Or, ces grandes institutions s’éloignent toujours plus des citoyens qui ont de plus en plus de mal à se faire entendre", conclut-il.