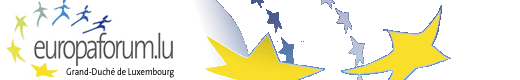Culture - Economie, finances et monnaie - Politique étrangère et de défense - Traités et Affaires institutionnelles
Ethique et gouvernance en Europe et dans le monde
Politiques, politistes, juristes, philosophes, théologiens, économistes et sociologues ont exploré la question à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu au Collège des Bernardins en partenariat avec l’Université de Luxembourg.
23-03-2011 / 25-03-2011
 C’est au Collège des Bernardins, à Paris, que s’est tenu, du 23 au 25 mars 2011, un colloque sur "la gouvernance mondiale et l’éthique au 20e siècle" organisé en partenariat avec l’Université du Luxembourg.
C’est au Collège des Bernardins, à Paris, que s’est tenu, du 23 au 25 mars 2011, un colloque sur "la gouvernance mondiale et l’éthique au 20e siècle" organisé en partenariat avec l’Université du Luxembourg.
"Est-il utopique d’envisager une gouvernance à l’échelle du monde acceptée par tous ? » Telle était la question posée par les organisateurs.
"L’usage croissant du terme invite à réfléchir à ce qu’est la gouvernance, à son usage et à ses formes au regard des enjeux économiques, environnementaux, politiques, sociaux et scientifiques contemporains. La pratique de la gouvernance et même l’idée de gouvernance suscitent des résistances de différents ordres suivant les civilisations et les sociétés : il s’agit aussi de les analyser. La gouvernance serait-elle un objet et un instrument purement techniques réservés aux élites ? La dignité humaine ne devrait-elle pas être une condition sine qua non d’une 'bonne gouvernance'?" C’est ainsi qu’ils entendaient aborder la question.
A la confluence du droit, de l’économie, de la morale, de la philosophie, de la science politique et de la théologie, rassemblant aussi bien des praticiens que des chercheurs, le colloque se proposait d’approfondir ces questions désormais primordiales pour l’humanité. Et l’Europe fut de la partie !
Lors de la séance d’ouverture, il y eut des exposés et une table-ronde avec Pascal Lamy, le directeur général de l’OMC, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, du Collège des Bernardins, et Nicolas Schmit, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du Luxembourg.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Collège des Bernardins : le bien commun universel ne saurait être atteint par un Etat à lui tout seul
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, du Collège des Bernardins, s’est demandé si l’appel aux pays du globe à créer une autorité politique mondiale est une idée "catholique". Dans la logique des encycliques papales qui ont émaillé les 80 dernières années, une telle autorité est une "nécessité anthropologique", car le bien commun universel ne saurait être atteint par un Etat à lui tout seul.

Mais une autorité mondiale ne peut fonctionner et être reconnue que si elle est efficace, légitime et subsidiaire. C’est pourquoi il faut trouver des formes innovantes pour que les pays pauvres puissent vraiment participer aux processus de décision et envisager aussi une autorité qui soit en mesure de se substituer à un Etat si celui-ci ne peut plus garantir les droits de sa population ou la protéger. Une telle autorité renforcerait en fait la souveraineté des Etats les plus faibles à travers cette possibilité même de pouvoir se substituer aux Etats défaillants.
Reste que l’ONU a été approuvée après la Deuxième Guerre Mondiale, et qu’elle a eu pour tâche, selon le pape Jean-Paul II, de défendre les droits de l’homme, d’être un "centre moral" et une "conscience commune" de la "famille des nations" dont elle représentait l’unité dans la diversité.
Avec les nouvelles réalités de la crise financière, du désarmement, de l’environnement et des migrations, l’Eglise catholique pense néanmoins qu’il faut donner plus de consistance aux relations entre les peuples. Les fondements de son approche sont que les hommes sont tous égaux et créés à l’image de Dieu, que leur destinée est unique, mais qu’il existe entre eux une interdépendance matérielle et spirituelle. Il faut une logique morale qui rende le dialogue possible. En termes de droit, cette anthropologie de l’Eglise se traduit par des règles de respect et de dignité de cette personne qui est par principe universelle.
Mais cette approche, se demande Eric de Moulins-Beaufort, est-elle seulement une vision catholique de la réalité ? En tant qu’église mondiale, l’Eglise catholique propose une réponse spirituelle, qui relève de l’infini, et qui peut générer des réponses matérielles, qui sont par nature finies, mais qui s’appliquent néanmoins au bien commun universel selon des modalités très variables par lesquelles l’ensemble des catholiques pourraient s’approprier l’idée par exemple d’autorité politique mondiale. Au niveau continental, "la construction européenne a profité au début de cette dimension catholique".
Pour Eric de Moulins-Beaufort, l’idée d’une autorité politique mondiale est plus ancienne qu’on ne l’imagine. Elle peut se nourrir de tous les courants, et dans ce cadre, le dialogue interreligieux peut montrer que l’humanité est un seul corps. Pour le prélat français, cette unité doit être abordée avec précaution, cette unité étant un don qui ne relève pas des hommes.
D’autre part, il ne faut pas confondre gouvernance et gouvernement. Une autorité politique mondiale ne serait pas un gouvernement ni un Etat mondial. "La liberté des personnes s’exprime aussi à travers les nations". Un écueil de toute gouvernance est l’économie, quand elle ne tient plus compte de la dignité des hommes et qu’elle génère des inégalités qui nient la justice et l’équité, deux facteurs qui sont les meilleurs pour les hommes puissent exercer leurs libertés. Une telle autorité n’engendrerait ni une société babélienne ni une société prométhéenne ni une société de consommation et ne serait pas non plus le Royaume des cieux des chrétiens. Elle ne serait pas la panacée, mais aiderait à "exhorter et à encourager la destinée de l’humanité".
Pascal Lamy, directeur de l’OMC : Une gouvernance mondiale, dont ferait partie l’UE, et qui doit corriger les déficiences du système westphalien des Etats nations et de l’équilibre des puissances est de plus en plus urgente
 Pour Pascal Lamy, directeur de l’OMC et ancien commissaire européen en charge du commerce extérieur entre 1999 et 2004, la nécessité d’une gouvernance mondiale qui doit corriger les déficiences du système westphalien des Etats nations et de l’équilibre des puissances est de plus en plus urgente. Comment réaliser cette ambition si l’on part du fait que l’état naturel de l’échelon national relève du "solide", celui de l’échelon européen du "liquide" et l’échelon mondial du "gazeux", et que toute gouvernance doit répondre à trois critères : le leadership, l’efficacité, la légitimité ? Remplir ces trois critères est une chose complexe dans le système international. Où est le leader ? La légalité des décisions n’implique pas encore leur efficacité. La légitimité se heurte souvent aux questions de la proximité et du sentiment d’appartenance.
Pour Pascal Lamy, directeur de l’OMC et ancien commissaire européen en charge du commerce extérieur entre 1999 et 2004, la nécessité d’une gouvernance mondiale qui doit corriger les déficiences du système westphalien des Etats nations et de l’équilibre des puissances est de plus en plus urgente. Comment réaliser cette ambition si l’on part du fait que l’état naturel de l’échelon national relève du "solide", celui de l’échelon européen du "liquide" et l’échelon mondial du "gazeux", et que toute gouvernance doit répondre à trois critères : le leadership, l’efficacité, la légitimité ? Remplir ces trois critères est une chose complexe dans le système international. Où est le leader ? La légalité des décisions n’implique pas encore leur efficacité. La légitimité se heurte souvent aux questions de la proximité et du sentiment d’appartenance.
La construction européenne doit par exemple répondre à ces trois critères, et jusqu’à nouvel ordre, l’UE reste pour Pascal Lamy "le seul vrai laboratoire de ce que peut être une gouvernance supranationale" avec un "très haut niveau de sophistication" qui permet de sortir du système westphalien. Elle en est capable parce qu’elle est un "pouvoir qui sort des gangues de l’unanimité", un "mix" d’idées et de projets divers "bâti sur l’espoir que l’histoire n’est pas fatalement une histoire de guerres".
Du point de vue de l’efficacité, le jeu institutionnel entre la Commission, le Parlement et le Conseil arrive à assumer des intérêts continentaux, à garantir la paix et l’indépendance économique et sociale. Du point de vue du leadership, l’UE peut s’affirmer, par exemple dans le domaine de l’environnement. Mais pour Pascal Lamy, "ça coince du côté de la légitimité".
L’UE est perçue comme un espace institutionnel froid, et malgré la Charte des droits fondamentaux, la sauce démocratique ne prend pas. C’est que la dimension anthropologique manque. L’UE n’a pas de récits, de mythes, de fables. Elle est en fait un anti-mythe. Aucune guerre fondatrice n’est à son origine. La fonder sur l’anti-guerre ne fonctionne pas.
Pour Pascal Lamy, une gouvernance internationale ne peut pas se baser non plus sur une réplique des structures du gouvernement national. La vraie difficulté n’est pas non plus le report des compétences. La difficulté relève du politique et du symbolique qui mobilisent le sentiment d’appartenance, car le pouvoir supranational n’est pas entre les mêmes mains que le pouvoir national. La légitimité qui continue de primer est celle qui relève du national.
Comment arriver alors à une légitimité secondaire qui serait celle d’un pouvoir supranational ? Trois pistes s’offrent selon Pascal Lamy face à un travail premier, celui de localiser les problèmes globaux. Il faut accepter les enchevêtrements d’intérêts et d’institutions. Il faut accepter de raviver des débats sur les droits et les valeurs, de nouveau malgré la Charte des droits fondamentaux, car elle ne représente pas à elle seule le meilleur des valeurs partagées. Il faut ensuite miser sur l’intégration régionale, qui a l’avantage de la proximité, source de légitimité.
Il faut par ailleurs être patient et respecter la souveraineté des Etats nations, qui constitue malgré tout une protection pour les Etats plus faibles et les plus faibles dans les Etats. Il faut finalement accepter d’écouter davantage ce que les sciences sociales et l’anthropologie disent aux politiques.
A partir des concepts d’autorité, de légitimité, de subsidiarité et de solidarité, les utopies nationales doivent selon Pascal Lamy pouvoir s’articuler dans des visions communes globales. De telles réflexions ne sont pas gratuites, mais urgentes, car les réflexions identitaires font aussi leur chemin et risquent de contrecarrer la progression d’une autorité politique mondiale. Aussi la démocratie risque-t-elle de s’appauvrir. Et si les pouvoirs nationaux s’avèrent faibles et incompétents pour gérer un certain nombre de problèmes qui ont aussi des facettes globales, l’anti-démocratie progressera, avec le risque de conflits locaux ou globaux que cela comporte.
Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration : Un plaidoyer pour une UE qui doit renouer avec ses valeurs et retrouver son unité et sa dimension sociale pour pouvoir jouer son rôle dans une autorité politique mondiale
Pour le ministre luxembourgeois du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit, qui a participé en tant que diplomate aux négociations de l’Acte unique, des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice, et à celles du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne comme ministre délégué aux Affaires européennes, la question de la gouvernance a gagné en actualité avec la crise.
Les problèmes globaux ne sont pas assez maîtrisés et il faut selon lui des règles communes si l’on veut éviter le pire. L’UE devrait en tout cas jouer un plus grand rôle pour la mise en place d’une autorité politique mondiale. Dans un premier temps, l’Europe a uni le monde, pour se retrouver maintenant marginalisée, une nouvelle perspective par laquelle elle doit aborder les problèmes.

L’Europe s’est faite pour Nicolas Schmit en passant par des phases d’avancées, de stagnations et de crises. Depuis l’Acte unique qui a relancé en 1985 l’Europe économique et le traité de Maastricht, qui a entraîné le passage de la Communauté à l’Union européenne, avec une orientation fédérale qui n’a finalement pas fait son entrée dans le traité", les conférences intergouvernementales et les refontes de traité se sont enchaînées, « mais sans enthousiasme ». Le moment important pour une relance, le traité constitutionnel, « un bel élan », « un rêve fragile », avec plus de légitimité démocratique et plus de compétences, fut un rendez-vous manqué.
Aujourd’hui, l’UE a néanmoins une monnaie commune, mais on s’est rendu compte, avec la crise, que celle-ci n’était pas dotée de moyens de gouvernance suffisants pour affronter les tourmentes monétaires et économiques, la banque centrale indépendante – "un prix à payer à l’Allemagne pour que l’euro soit introduit" - ne pouvant pas à elle seule affronter toutes les tâches qui s’imposaient. Entretemps, ceux qui penchaient vers cette gouvernance minimaliste de l’euro veulent davantage, après avoir mis beaucoup de temps à accepter les faits, ce qui a retardé la réaction de l’UE et favorisé la récession. Les relances dans les Etats membres ont été nationales, à peine coordonnées, alors que les Etats-Unis ont immédiatement commencé à réguler leurs marchés.
Pour le ministre du Travail, la crise de l’euro se trouve à un moment critique. Les gouvernements nationaux n’ont pas été tout de suite à la hauteur. L’Allemagne joue constamment la carte nationale. Au-delà des décisions sur le mécanisme de stabilité économique et du pacte pour l’euro, l’UE devra affronter des crises où les Etats ne sont pas en cause, comme celle de l’Irlande, et elle découvre rapidement que l’euro est devenu une monnaie de réserve européenne et globale. Ces nouveaux éléments soumettent la culture du compromis dans l’UE à rude épreuve. Les idéologies et les intérêts nationaux sont de la partie, comme le montrent les hésitations allemandes sur la création d’euro-bonds.
Un autre élément nouveau est selon Nicolas Schmit le fait que le directoire franco-allemand était traditionnellement "attendu" avec ses positions sur l’intégration européenne, alors que maintenant, ses lettres avant les Conseils européens sont accueillies avec méfiance. L’élargissement est mis en cause. L’UE tend vers une gouvernance technocratique faite de systèmes de règles assorties de sanctions, une approche qui restreint la marge de manœuvre des politiques nationales et tend vers "un idéal ordo-libéral", par exemple avec l’obligation de l’équilibre budgétaire. Ce système "paraît logique", mais Nicolas Schmit craint un "décalage avec le citoyen".
A ce moment, le problème de la légitimité est posé. Certes, il y a selon lui le Parlement européen, qui est devenu plus important, mais dont le pouvoir est "peu compris". Le Conseil européen favorise l’éclosion des seules légitimités nationales et la multiplication des conférences intergouvernementales pour décider, ce qui fera immanquablement passer la Commission au second plan.
Reste la grande question : comment l’UE se positionnera-t-elle face aux BRIC et autres grandes économies, et comment arrivera-t-elle à gérer ses retards technologiques, les dossiers climat et énergie, et d’autres dossiers globaux ? L’image qu’elle a donnée d’elle-même pendant la crise libyenne n’a pas été bonne selon Nicolas Schmit, ni à travers ses Etats membres au Conseil de sécurité (cf. l’abstention de l’Allemagne lors du vote sur la résolution 1973), ni à travers sa politique étrangère. Le directoire franco-allemand a volé en éclats. L’UE ne s’est pas positionnée comme un grand acteur global et n’est pas sortie renforcée au Conseil de sécurité. Son image est brouillée. Sans parler de la manière dont elle aborde sa propre dimension sociale, car pour Nicolas Schmit, la stratégie Europe 2020 ne remplace pas une stratégie sociale, de sorte que nombre de citoyens ne se sentent plus protégés par elle et se demandent si l’euro a apporté le progrès social.
C’est là que l’UE doit retrouver un cours qui lui permette de porter dans une autorité mondiale politique les valeurs de dignité et éthiques dont elle dit qu’elles sont les siennes, et de les porter aussi par le biais de personnes qui les incarnent vraiment.
Philippe Poirier : Différents modèles de gouvernance
Au début du colloque, le 24 mars 2011, Philippe Poirier, de l’Université de Luxembourg, a dans un premier temps tenté de retracer la genèse du concept de gouvernance, la naissance de plusieurs concepts à l’époque contemporaine et de le différencier de celui de gouvernement.
La gouvernance a pris naissance au Moyen Age à travers les différents droits maritimes et portuaires, le droit international et celui des gens, le droit sur les foires et les baillages, les fermages et les fiefs, et avec l’organisation territoriale en sous-régions, comme par la distinction entre bon et mauvais gouvernement, et ce dans différentes régions d’Europe. Cette réflexion sur le pouvoir s’est centrée avec le temps sur l’Etat comme totalité et l’éthique dans l’acte de gouvernement. Avec la souveraineté moderne et le système westphalien déjà évoqué la veille par Pascal Lamy, les gouvernements éclipsent la gouvernance dans la mesure où ils ne reconnaissent plus de règle extérieure, mais sont dérivés du pouvoir absolu et illimité de l’Etat.
 La gouvernance reparaît dans les réflexions sur le pouvoir au tournant des 19e et 20e siècles dans toutes les grandes familles idéologiques, catholique sociale, libérale, classique et social-démocrate dans le sens large du terme. Aujourd’hui, on parle de gouvernance d’entreprise, européenne, urbaine, globale ou à multiples niveaux. Il ne s‘agit pas d’une privatisation du politique, mais d’une approche complémentaire, sans sanction démocratique.
La gouvernance reparaît dans les réflexions sur le pouvoir au tournant des 19e et 20e siècles dans toutes les grandes familles idéologiques, catholique sociale, libérale, classique et social-démocrate dans le sens large du terme. Aujourd’hui, on parle de gouvernance d’entreprise, européenne, urbaine, globale ou à multiples niveaux. Il ne s‘agit pas d’une privatisation du politique, mais d’une approche complémentaire, sans sanction démocratique.
L’approche néo-institutionnaliste vise plus d’efficacité. L’approche urbaine vise l’externalisation des coûts et une meilleure participation des citoyens. L’approche multi-niveaux vise dans les régions, dans les Etats nations, dans l’UE à inclure des intervenants externes concernés dans les processus de prise de décision. L’approche européenne cherche à développer des concepts de pouvoir qui ne reproduisent pas les structures des Etats membres, une réflexion sur la gouvernance qui peut déboucher sur de nouvelles formes de gouvernement. L’approche globale vise l’intégration des activités économiques, l’accélération des techniques de communication et des transports, l’accès sur les marchés et l’influence dans des enceintes à impact global comme l’OMC, l’OCDE, le FMI, ceci dans une atmosphère de compétition entre les Etats.
Parallèlement, la théorie réaliste souligne le rôle central des Etats dans les relations internationales qui sont par définition anarchiques, de sorte qu’ils restent dans les systèmes de coopération les acteurs principaux et les sources de solutions. La théorie libérale souligne de son côté que les relations entre Etats créent des interdépendances, comme au sein de l’UE, de sorte que l’enchevêtrement des économies et des échanges débouche sur des relations de solidarité dans le cadre desquelles les relations d’hégémonie et de dépendance ne sont pas considérées comme fonctionnelles. Ces approches de la gouvernance suscitent de nouveau des contestations, comme les souverainismes ou l’alter-mondialisme.
Philippe Herzog : L’Europe, un laboratoire de démocratie et de gouvernance plurinationales
Philippe Herzog, ancien député européen et fondateur de Confrontations Europe, fut le deuxième orateur. Cet ancien communiste a réussi à réunir dans une association non partisane des dirigeants d’entreprises, des syndicalistes, des acteurs territoriaux, associatifs et politiques, des intellectuels et des étudiants de plusieurs pays d’Europe, autour d’un engagement en faveur de la participation active de la société civile à la construction de l’Europe. Avec la crise mondiale, l’association veut contribuer à ce que l’Union européenne se consolide et veut donc mobiliser les citoyens et les acteurs autour d’options de sortie de crise qui mènent aussi vers un nouveau modèle de croissance.
Pour Philippe Herzog, qui a commencé son exposé par une citation du Talmud – "Si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi d’où tu viens" - l’Europe est construite sur les valeurs de pardon et de promesse. Pour illustrer son propos, il a cité l’ancienne députée socialiste Irène Laure, résistante et déportée, qui a dit en 1947 à un public allemand : "J’ai souhaité la destruction de l’Allemagne et sa disparition de la carte du monde. De ma haine, je vous demande pardon." Ce sont des gens comme Robert Schuman et Jean Monnet qui ont trouvé les mots pour d’autres pour exprimer la nécessité de l’humanité réconciliée à travers un projet qui ne serait pas seulement basé sur le rejet des guerres, mais aussi sur des solidarités nouvelles.
Dans une Europe où les structures mentales sont encore inscrites dans l’Etat-nation et sont liées au territoire, à sa gestion par un "cercle d’amis", à la reconnaissance du monopole de la violence légitime au seul Etat qui est aussi source de protection sociale et exerce la solidarité par délégation, dans une Europe où ce ciment a tenu et a produit de bons résultats, où le principe de frontière aussi est fondamental, où la démocratie donne à l’Etat-nation sa légitimité, où la coopération internationale produit des politiques communes, mais sans délégation à un Etat fédéral, la mondialisation fait alors figure d’immense imprévu. Mais le facteur nouveau est que l’on est passé de l’internationalisation des échanges à l’internationalisation de la production, ce qui a pour conséquence que l’Etat-nation n’est plus le maître de son territoire et n’a plus le monopole des relations internationales. En même temps, la monnaie unique européenne est aujourd’hui menacée par des conflits entre capitaux nationaux, un phénomène qui n’est pas analysé. Au lieu de cela, c’est l’élargissement qui devient le bouc émissaire alors qu’il serait, selon Philippe Herzog, plus utile et nécessaire que les Européens repensent leurs solidarités. L’UE a voulu projeter dans le monde les idées de démocratie et de régulation. Maintenant, on voudrait qu’elle devienne une puissance. "Est-ce bon ?", se demande Philippe Herzog.
Pour le fondateur de Confrontations Europe, il faut franchir une nouvelle étape en envisageant une démocratie plurinationale en Europe. Il y a à cela des limites fonctionnelles. Il ne s’agit pas pour lui de fédérer seulement les Etats, mais de rassembler les peuples. Mais si l’Europe n’arrive ni à construire une politique économique ni une politique sociale, c’est qu’elle est minée par le déficit démocratique et le fait que les citoyens ne se sont pas appropriés le projet européen. Le traité constitutionnel était selon Philippe Herzog une idée de constitution sans projet, et l’arrêt de la cour de Karlsruhe, qui fait dépendre toute approche allemande de l’Europe de l’approbation parlementaire nationale exclut pour lui l’idée de société civile. Tout cela se fait dans un contexte où le syndicalisme européen organisé est sur le repli et que personne ne se sent vraiment responsable de l’euro. Et le pacte pour l’euro, par lequel les Etats membres s’engagent seulement à respecter certaines règles, est pour Philippe Herzog "potentiellement impotent". Car comment coordonner les politiques économiques nationales si une véritable monnaie commune s’avère impossible à réaliser ou maintenir ? Qu’est-ce aussi la méthode de l’Union préconisée par le directoire franco-allemand alors que le marché intérieur est menacé par l’intégration des marchés mondiaux et qu’il n’est pas assez défendu par la Commission Barroso II ? Le budget de l’Union est un autre sujet toujours éludé et pourtant fondamental.
Tout passe pour Philippe Herzog par le mariage de la compétitivité et de la solidarité ainsi que par la "réinvention des biens communs". Le travail, les transports, l’accès à la santé, à l’éducation, etc. sont des biens publics, insérés dans l’Etat national, et dont il faut faire des biens communautaires, ce qui est une gageure puisqu’on se fait des idées très différentes de ce qu’est le bien public dans les différents Etats de l’Union. Pour que cela puisse se faire, il est également nécessaire de s’accorder le temps qu’il faut pour que les citoyens s’approprient ces idées et ces biens. Il faut faire reculer les emplois subordonnées, ménager des transitions entre les emplois hautement et moins qualifiés. Le pivot de tout progrès est la mise en responsabilité. En Europe, pour éviter d’imposer ses normes sociales aux autres, il faut procéder par une mise en adéquation réaliste avec le mode de vie, afin que le coût des normes sociales soit supportable. Dans le choix des biens publics communs, les mandataires de la démocratie parlementaire ont d’ores et déjà des égards pour ce que la « démocratie d’opinion » leur dit. L’inclusion et la solidarité sont de mise, y compris l’inclusion de l’Europe dans le débat régional local, et ce pour éviter que l’ennemi ne soit perçu à l’intérieur des sociétés ou que l’indifférence à l’égard de l’UE n’éclose, car tout cela peut générer des violences. Au bout du chemin, l’ancien eurodéputé pense qu’il y aura une nouvelle ère de l’histoire européenne.
Nicolas Baverez : La crise et "le risque pour l’Europe de sortir de l’Histoire"
Pour le philosophe Nicolas Baverez, la mondialisation, c’est l’universalité du capital qui domine 98 % des activités économiques, c’est un système multipolaire et l’existence de valeurs hétérogènes. C’est aussi le temps du chaos, des guerres sans ennemi, des sociétés hyper-organisées contre le risque ébranlées par des catastrophes naturelles, le retour aux guerres et aux révolutions, le temps des crises économiques, le temps des risques sanitaires, de l’étiolement des sécurités traditionnelles. Tout cela échappe aux Etats nationaux. Mais toute crise est d’abord le stade suprême d’une maladie. C’est soit la guérison soit la mort. Jusqu’en 2008, les crises ont été sectorielles, puis elles se sont rapprochées, et maintenant, c’est la grande crise, comme à la fin du 19e siècle et au cours des années 1930. Cette crise va modifier la hiérarchie des puissances et les politiques de régulation. Le centre de gravité de la planète va basculer vers le Sud et l’Asie. Mais la régulation manque encore d’institutions communes, et la divergence des valeurs ne la favorise pas.
Nicolas Baverez distingue trois âges de la mondialisation.
Le premier a commencé avec les réformes de Deng Xiaoping en Chine, l’invasion russe en Afghanistan, le pape Jean-Paul II, la révolution khomeyniste en Iran et la fin du keynésianisme sous Margareth Thatcher. Cette période s’est accélérée avec la chute du Mur de Berlin. Le capital est devenu universel, mais cela ne veut pas dire qu’il y eut partout économie de marché, car là où il y a un marché, il y a des règles.
L’âge d’or de la mondialisation ne dure que très peu de temps, de 1999 aux crises de 2001, avec l’hyper-terrorisme, le début du cycle de guerres, des politiques monétaires débridées et les bulles économiques et la montée de la Chine.
Le troisième âge est celui de la crise, des chocs économiques limités, mais avec quatre grandes sources de soucis. D’abord le souci économique avec le chômage de masse, l’augmentation des dettes publiques et bancaires, l’inflation attisée par la réponse des Etats-Unis, le prix du pétrole et la demande des pays émergents. Les Allemands n’ont pas bien compris cette période selon Baverez, qui met en évidence la disparité des taux de croissance entre les BRIC, les Etats-Unis, l’UE et le Japon.
Le deuxième souci est la tension qui s’est instaurée entre les secteurs public et privé. Des villes, certains Etats américains tombent en faillite, mais aussi des départements français. Pourtant, difficile d’aller plus loin que ce qu’on a fait pour reprendre ces dettes. La FED compte déjà 17 % de papiers toxiques parmi ses avoirs.
Ensuite il y a la fin du monopole de l’Occident et de son hégémonie qui a duré 200 ans, la sortie du monde des Lumières, le passage des sociétés et Etats qui avaient policé les jungles nationales à une jungle d’Etats-nations, la montée en puissance des BRIC et des classes moyennes dans ces pays, qui sont passées de 30 millions à 300 millions en très peu de temps, et qui passeront à 3 milliards, sous la poussée d’une économie de la connaissance qui prend racine en Chine comme ailleurs.
Quatrième souci : Le modèle chinois s’est converti à la nouvelle situation de la mondialisation, en augmentant les salaires au-delà du simple rattrapage, en affichant des préoccupations environnementales et en acceptant progressivement l’internationalisation par et dans le Web. Les Etats-Unis mènent le désendettement et épargnent plus. Mais l’Europe est divisée en quatre. L’Allemagne connaît un nouveau miracle économique. Sa périphérie par contre implose. Les économies intermédiaires souffrent. La Russie fait cavalier seul. L’Europe n’a pas de modèle et hésite entre régulation et renationalisation.
Il n’y a dans ce contexte aucun leadership mondial. La situation est "dangereuse, volatile et instable". Des "surprises désagréables" guettent, si rien n’est fait. La tentation est grande d’émettre des monnaies, de relancer des bulles. Les efforts de normalisation doivent éviter de créer de la déflation.
D’un autre côté, les pays émergents refusent la régulation financière. L’UE se trouve "dans un innommable méli-mélo", dans la mesure où les petits Etats, pense Nicolas Baverez, ne voudraient pas d’une régulation, se sentant réassurés par les grands, et que les grands Etats nationaux essaient de reprendre le contrôle. "L’UE n’a pas une conscience de l’euro comme d’un bien commun", affirme le philosophe, "ni vraie responsabilité, ni vraie relation". Et l’Allemagne serait considérée comme le réassureur ultime de l’euro.
Une issue est d’obliger au niveau européen les pays « irresponsables » à accepter des règles budgétaires et d’améliorer leur productivité. Mais en même temps, il faut aborder selon Nicolas Baverez les choses au niveau d’une gouvernance mondiale, reconnaître des biens communs mondiaux, comme le commerce, les moyens de production, les réserves énergétiques, la régulation financière. Ces enjeux sont l’objet de négociations au sein de l’OMC, du G20. "Mais où sont les accords qui fonctionnent et qui sont efficaces ?", se demande Nicolas Baverez. Là aussi, le retour vers les Etats nationaux qui fonctionnent s’opère. L’UE est dans une situation difficile, de déclin, "elle peut sortir de l’Histoire" si elle ne renoue pas avec sa dynamique brisée par la renationalisation.
La mondialisation économique est pour Nicolas Baverez entrée dans une phase où il est entretemps question de guerre ou de paix dans laquelle il faut reconnaître les instruments de la société internationale comme des biens communs. La compétition bat son plein, ce qui est positif tant que ce processus ne porte pas atteinte aux libertés. La dissolution des structures n’est pas fatale, pense le philosophe français qui renvoie aux principes de la Révolution française, mais aussi aux récits de l’Iliade qui est selon lui le récit de la guerre des dieux, et de l’Odyssée, où Ulysse conclut cette guerre des dieux dans un monde d’hommes. Aux Européens de reconstruire ensuite Ithaque, "mais sans être obligés de massacrer les prétendants".