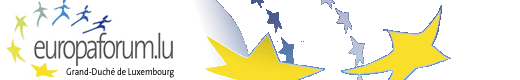Economie, finances et monnaie
Pour l'économiste Xavier Timbeau, il faut remettre les restrictions budgétaires à plus tard et relancer l'économie dans les pays de la zone euro les plus enfoncés dans la crise
13-11-2012
 Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le STATEC invitait le 13 novembre 2012 à une conférence de l'économiste Xavier Timbeau, directeur du Département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Son intervention intitulée "Austérité et temps de crise" s'est surtout concentrée à démontrer pourquoi les politiques d'austérité n'ont toujours pas produit les effets escomptés, à savoir la réduction des déficits dans les pays en crise de la zone euro. Avant de rentrer dans le détail des débats techniques mais néanmoins décisifs entre économistes, Xavier Timbeau est revenu sur les origines de la crise et sur la situation des économies développées quatre années de récession plus tard.
Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le STATEC invitait le 13 novembre 2012 à une conférence de l'économiste Xavier Timbeau, directeur du Département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Son intervention intitulée "Austérité et temps de crise" s'est surtout concentrée à démontrer pourquoi les politiques d'austérité n'ont toujours pas produit les effets escomptés, à savoir la réduction des déficits dans les pays en crise de la zone euro. Avant de rentrer dans le détail des débats techniques mais néanmoins décisifs entre économistes, Xavier Timbeau est revenu sur les origines de la crise et sur la situation des économies développées quatre années de récession plus tard.
"Ce n'est pas un problème de petits pays qui auraient mal géré leur intégration dans la zone euro"
"Nous ne sommes pas sortis de la crise", tenait à rappeler Xavier Timbeau, chiffres à l'appui. La preuve repose sur les trois problèmes récurrents auxquels font face la plupart des pays de la zone euro et, plus généralement, l'ensemble des pays développés : une dette publique élevée, les déséquilibres de balances courantes à l'intérieur de la zone euro et les effets de la permanence de la récession.
Abordant le premier de ces trois problèmes, la dette publique, laquelle affiche des niveaux bien plus élevés qu'avant la crise, Xavier Timbeau en profite pour recadrer le débat : "Certaines personnes parfois vous disent 'Cette crise est liée aux dettes publiques'. En fait, non, les dettes publiques sont les résultats de la crise. La crise était en fait un problème de dettes privées, qui n'étaient pas soutenables et ont conduit à un éclatement de la situation économique. Il y avait des actifs surévalués. Et quand on a révisé l'évaluation de ces actifs, on a remarqué qu'il y avait des situations financières d'agents, de ménages, d'entreprises financières et de banques, intenables et qu'ils étaient virtuellement en faillite." Pour interrompre cette "spirale récessive", il fallait laisser jouer les stabilisateurs économiques, réaliser des plans de soutien à l'économie et au secteur financier en socialisant les dettes privées et en acceptant "d'augmenter la dette publique à un moment où tous les autres acteurs économiques cherchaient à réduire leur endettement, leur bilan".
Le coût de cette crise sur l'endettement est, entre 2007 et 2012, une augmentation moyenne de 20 points de PIB pour les pays de la zone euro et 30 points dans les pays développés.
Les cas de l'Irlande et de l'Espagne, montrés en modèles avant la crise, sont aujourd'hui les exemples les plus parlants pour montrer les ravages de la récession économique qui s'en est suivie. L'Irlande avait une dette quasi nulle en 2007, qui a ensuite bondi pour atteindre 82 % de son PIB en 2012, en raison de la socialisation de l'ensemble de la dette privée bancaire. La crise y était le produit d'un "mélange de bulle immobilière et d'activité financière intense qui dépassait le territoire irlandais mais dont la responsabilité revenait, sans qu'ils s'en rendent trop compte, aux citoyens irlandais". L'Espagne avait un budget en excédent en 2007.
"La situation aujourd'hui est le résultat de cette crise qui s'est amorcée en 2008, pas d'une crise persistante de la gestion des finances publiques". Les autres pays développés, d'ailleurs, ne sont pas mieux lotis. Au contraire. Aux Etats-Unis, l'écart de production par rapport à l'avant crise n'a jamais été comblé même s'il "arrête de se dégrader". Pour sa part, "le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise de façon très profonde avec une nouvelle récession aujourd'hui et des perspectives déplorables". Tandis que le Japon, qui a encaissé les problèmes liés à Fukushima et les inondations en Thaïlande, poursuit sur un chemin assez proche.
Les déséquilibres de balances courantes
Xavier Timbeau considère que le second problème n'est pas assez pris en compte par la politique économique. Il en veut pour premier exemple la France dans lequel le débat politique se concentre d'abord sur le problème de la compétitivité. "Plus qu'un problème de compétitivité, il y a une question assez difficile à résoudre : la question du déséquilibre des balances courantes en Europe", déclare-t-il avant de se demander s'il n'y a pas sur ce point "la source pour une prochaine récession".
Certes, la crise a pu corriger les déséquilibres en certains endroits de la zone euro. La réduction des importations en Espagne lui a permis de réduire le déficit de sa balance commerciale. La France et l'Italie affichent au contraire un déséquilibre toujours important tandis que de l'autre côté de la balance, l'excédent "spectaculaire" de l'Allemagne est un "problème qu'on pourrait juger positif".
Or, si l'Italie et la France n'ont pas vu cet écart se réduire, "ce n'est pas seulement pour des raisons de compétitivité", explique Xavier Timbeau, mais aussi "en raison de leur soutien plus fort à l'activité " et "de leur nombre moins important de plans de restrictions". Néanmoins, "des balances courantes qui continuent à être négatives, ce sont des positions extérieures qui se dégradent, des dettes qui s'accumulent, et de l'autre côté des créances". Or, à terme, dans un environnement où il n'y a pas la possibilité de la modification du taux de change pour corriger le tir, cette situation représente soit une "charge qui persiste", soit elle porte le risque d'un "défaut aux effets redoutables".
"Si l'Europe du Sud fait défaut, l'Europe du Nord fait défaut et l'ensemble de l'Europe fait défaut. On ne peut pas impunément avoir une balance courante excédentaire pendant dix ans et avoir accumulé une position nette considérable pour pouvoir survivre à un défaut de ceux dont on est créancier", prévient l'économiste.
Les risques de la récession actuelle
Le troisième problème auxquels font face les Etats de la zone euro sont l'installation de la récession et la hausse progressive du chômage de longue durée, d'autant plus redoutable qu'il "a des effets de long terme". Cette crise n'est pas un "simple réajustement d'une situation qui n'était pas intenable, mais aussi pour tout un tas d'acteurs d'individus, c'est un environnement dans lequel tout est plus difficile et où le court terme a un impact très fort sur le long terme."
Cette récession a aussi pour conséquence la hausse considérable du chômage, qui porte le total de chômeurs à 14 millions en Allemagne, France, Italie et Espagne, qui représentent 90 % des chômeurs de la zone euro. L'Espagne a connu la plus forte hausse, à côté de laquelle les augmentations enregistrées en Italie et France paraissent dérisoires, tandis que seule l'Allemagne enregistre une décrue. Toutefois, les pronostics ne sont pas roses. Il existe une dynamique à l'augmentation du chômage. Et ce paramètre indique, tout comme lorsqu'on considère l'écart de production, "à quel point nous nous enfonçons dans la récession". "Notre problème n'est pas seulement les dettes publiques, le déficit public ou la compétitivité mais qu'on reste dans la dynamique de la récession."
Xavier Timbeau souligne que les niveaux de récession atteints dans les pays tels l'Espagne, le Portugal et la Grèce, ne laisse d'autre choix que d'envisager "les scénarios du pire, de rupture politique et sociale", puisque "la récession n'est plus acceptable par l'organisation sociale". "Il y a un certain nombre d'ingrédients qui nous rappelle les années 30. (…) Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont aussi derrière, des situations qui peuvent dégénérer."
Il rappelle qu'en 2008-09, fut observé le mouvement de "chute libre". Il n'y avait jamais eu de chute aussi importante dans le PIB par tête (considéré en parité de pouvoir d'achat) depuis la deuxième guerre mondiale. Mais pour les pays en crise comme le Portugal, l'Espagne et la Grèce, la situation s'est répétée sur plusieurs années, la Grèce ayant connu le plus grand choc, avec depuis 2009 quatre fois la plus grande chute de PIB depuis 1945. "Les niveaux de récession qui sont atteints sont considérables. Ce sont des choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer avant de les voir s'avérer", confie Xavier Timbeau. Pour 2012, le déficit de son PIB devrait atteindre 7,4 %, tandis que le résultat de l'Espagne devrait s'élever à un recul de 5,4 %, l'Irlande reculerait de 8,4 % et la France de 4,5. Toutefois, là aussi, la situation n'est pas homogène puisque les budgets de l'Allemagne et de l'Italie paraissent au contraire stabilisés.
En considérant le déficit moyen de la zone euro, "on pourrait envisager la zone euro de façon positive", en comparaison avec les résultats du Royaume-Uni ( – 7,7 % ) , du Japon (– 9,9 %) et des USA ( – 8,8 %), c’est-à-dire des "situations comparables aux pays qui connaissent les pires situations en Europe". Et si on regarde l'endettement financier net, celui de la Grèce a augmenté de 52 points de son PIB en cinq ans, celui de l'Irlande de 82, celui de la France de 31 points et celui de l'Allemagne de 9 points seulement.. Là aussi, les autres pays développés ne font pas mieux. L'endettement du Japon (+54 points à 134 % du PIB) a encore plus augmenté que celui de la Grèce, et ceux du Royaume-Uni (+ 46 points de PIB) et des USA (+37 points à 85 %) ne sont "pas loin d'une situation à la grecque".
C'est ainsi la preuve que nous sommes face à un problème mondial, et non pas face à un problème de pays, dans un monde donc où tous les pays sont interdépendants. Xavier Timbeau explique par exemple que "si demain les USA décident de résorber leur dette et de rattraper les 37 points de PIB qu'ils ont cumulés en cinq ans, cela aura un impact sur l'économie mondiale" et rappelle : "Ce n'est pas un problème de petit pays qui auraient mal géré leur intégration dans la zone euro ou de négligence de leurs pairs. C'est un problème global."
Soutenabilité de la dette publique : un problème complexe
Pour Xavier Timbeau, à une échelle macro-économique, "la stratégie budgétaire du père de famille n'a pas de sens". "Le père de famille peut considérer que s'il dépense moins, il ne va rien changer à l'économie mondiale. Mais quand l'ensemble des pays développés décident de dépenser moins, l'hypothèse n'est plus tenable. Car l'ensemble des pays développés, c'est aussi pratiquement l'ensemble de la demande de l'économie mondiale." Alors, "il ne peut pas se passer d'autre chose qu'une réduction de l'activité. "
A côté de la gestion de père de famille qui veut qu'on ne dépense pas plus que ce l'on gagne, le taux d'intérêt a aussi une conséquence importante sur l'activité et donc les recettes futures. "Avant la crise, on considérait que quand un Etat s'endettait trop, c'est-à-dire s'endettait pour des mauvaises raisons sans avoir dans son bilan des actifs physiques ou immatériels qui sont cohérents, cela conduit à une mauvaise allocation des ressources, fait augmenter le taux d'intérêt pour les Etats et les agents privés et a un effet négatif sur l'ensemble des agents de l'économie."
Cet élément a été renforcé par une observation nouvelle lors de la crise avec la panique qui s'est emparée des marchés quant à la soutenabilité des finances publiques. "L'histoire de la Grèce depuis 2009, c'est l'histoire de paniques et d'augmentations brutales de taux d'intérêt liées au fait que la dette publique paraît insoutenable." Des taux d'intérêt de 25 – 30 % et le fait que les créanciers ne sont pas tous grecs, mènent à un effondrement de l'économie, suite à quoi seul le défaut est possible. Cette situation va plus loin que ce que des économistes comme Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, spécialistes de l'analyse des crises, ont en tête dans leur analyse d'incidents de dettes.
"On avait oublié un élément qui avait été largement débattu pendant la grande dépression et après et qui avait été remis au goût du jour par Krugman à propos du Japon, c'est la notion de trappe à liquidités", explique Xavier Timbeau. Quand une économie est dans une situation terriblement dégradée, tous ceux qui ont de l'épargne, un bilan positif, veulent le placer. Ils refusent de le placer dans les banques et les entreprises productives qui risquent la faillite ou de voir leurs marchés s'effondrer. Dans ce cas, ils recourent à un "agent économique particulier", l'Etat, qui au pire fera faillite en dernier mais ne fera sans doute pas faillite du tout, puisqu'il a à côté de lui la banque centrale qui agit en prêteur en dernier ressort et qui peut toujours donner de la valeur à la dette publique. "Ce sera le dernier actif qui aura de la valeur."
Dans ce cas, les taux d'intérêt souverains sont censés s'effondrer et devenir négatifs en termes réels. Dans ce cas-là, "l'impératif de gestion de bon père de famille commence à se discuter". "L'impératif est plutôt de dépenser plus que vous ne gagnez. A conduire un déficit, vous gagnez de l'argent." Quand l'Allemagne emprunte à 1,2 %, elle emprunte à un taux d'intérêt réel négatif, elle est payée pour emprunter sur dix ans. C'est ce que Keynes appelait l'euthanasie des rentiers. "Il y a des gens qui paient un impôt volontaire en échange de cette certitude qu'ils ne vont pas tout perdre. C'est un pouvoir phénoménal, moyen de résoudre les problèmes de finance publique", commente l'économiste. Toutefois, pour en tirer parti, "il faut avoir l'intelligence quand on est l'Etat, pour faire jouer ce mécanisme-là, de continuer à emprunter un petit peu". Ainsi, pour ce qui est des taux d'intérêt, l'écart de comportement est grand entre l'effet de panique et les situations où les prêteurs sont prêts à payer n'importe quoi pour ne pas tout perdre.
Les multiplicateurs
L'effet multiplicateur négatif des dépenses publiques : "une fable qui était très commode pour faire passer les plans d'ajustement budgétaire"
Après avoir démontré que la restriction budgétaire est une occasion manquée, Xavier Timbeau a abordé la question des effets multiplicateurs, qui servent de justification à la politique budgétaire nommée. Les multiplicateurs mesurent à quel point la variation d'une grandeur économique entraîne la variation d'une autre grandeur économique. L'économiste Keynes a justifié l'intérêt de la relance de l'économie par l'investissement public par le "multiplicateur d'investissement" qui soutient que toute hausse de l'investissement public entraîne une hausse plus que proportionnelle de la production.
En amont de la conférence, le directeur du Statec, Serge Alleggrezza a fait remarquer que le débat sur les multiplicateurs commençait à prendre pied également au Luxembourg, à la faveur d'un article publié par le ministre du Travail, Nicolas Schmit, d'ailleurs présent dans l'assistance. "On dit souvent que pour un petit pays, le rôle des multiplicateurs n'est pas très important puisqu'ils sont censés être très faibles", a ainsi dit Serge Allegrezza. "Un petit pays est plus dominé par des questions de compétitivité. Mais il n'y a pas de petits pays sans grands pays à côté. Même si ces questions concernent surtout les grands pays, le Luxembourg a son destin lié à ces grands pays et doit intégrer ces éléments-là", considérait de son côté Xavier Timbeau.
Pour aborder la question, l'économiste de l'OFCE explique que Keynes avait jadis donné à considérer que "les idées en économie peuvent continuer à avoir une influence sur les pratiques bien au-delà du moment où elles ont été émises, et bien peut être aussi bien au-delà de l'espace de validité où elles ont été pensées." Or, de telles idées ont présidé aux recherches sur les effets multiplicateurs qui ont guidé les institutions internationales. L'économiste néo-classique Robert Barro est à l'origine du débat relancé sur les multiplicateurs keynésiens. Travaillant sur l'équivalence ricardienne, il affirmait que les multiplicateurs ne fonctionnent pas "car les gens ne sont pas idiots et savent que, ce que l'Etat dépense aujourd'hui, il le lèvera en impôts demain". Ainsi, l'argent dépensée pour la stimulation de l'économie, partirait dans l'épargne par anticipation des hausses futures d'impôts. "Barro a marqué des points, à une époque où l'anticipation joue un grand rôle, où la conception qu'on avait de l'inflation a été complètement modifiée", explique Xavier Timbeau.
A sa suite, Alberto Alesina a pensé apporter la preuve empirique de la théorie ricardienne de Robert Barro. En étudiant les expériences du passé, il a conclu qu'une politique fiscale, qu'elle soit d'expansion ou de contraction, n'a pas d'impact sur l'activité. "On pouvait même démontrer qu'il y avait des effets négatifs de la politique budgétaire expansive sur l'économie", ajoute Xavier Timbeau. Alors que l'équivalence ricardienne aboutissait à la neutralité budgétaire, cette dernière idée appartenait aux analyses anti-keynésiennes, qui démontrent un effet contraire à l'analyse keynésienne. Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, par une analyse empirique historique, a également avancé que "les multiplicateurs sont au mieux positifs à court terme et très souvent négatifs à moyen terme".
Le modèle macro-économique dit DSGE considère que les multiplicateurs "étaient positifs mais faibles à court terme mais n'avaient pas d'effet à long terme", respectant ainsi la neutralité ricardienne. Dans ce modèle, les impôts avaient des multiplicateurs plus forts, les dépenses publiques des multiplicateurs plus faibles, sauf en cas d'investissements profitables. Les dépenses de transfert avaient des effets multiplicateurs très faibles voire négatifs. Ainsi, une augmentation d'impôt augmenterait les distorsions produites par ces impôts et aurait un effet négatif. Les dispenses de transfert sont supposées être "désincitiatives à l'activité". Par contre, en réduisant les postes de transfert, on augmente les incitations, donc on produirait effet positif malgré la neutralité ricardienne. Voilà ce qui " constituait le consensus."
"Les 'ultras' disaient que les multiplicateurs sont négatifs, et il suffisait d'aller à quelques conférences grand public organisés par la Commission européenne pour voir quelques-uns de ces 'ultras.' La Commission européenne adorait le concept de multiplicateur négatif, c'est ce qu'avait popularisé Alesina. Vous décidez de faire une politique fiscale courageuse, vous réduisez les dépenses publiques, vous augmentez les impôts, vous allez avoir comme objectif de réduire le déficit public et ça va provoquer un retour de la croissance dans votre pays. (…) Pour la Commission, c'était une fable qui était très commode pour faire passer les plans d'ajustement budgétaire."
Un aggiornamento qui change tout
Ces idées dominantes dans les institutions telles que la Commission européenne, l'OCDE et le Fonds monétaire international pour ce qui concerne les effets multiplicateurs ont toutefois ces deux dernières années fait l'objet d'"un aggiornamento".
Cette mise à jour a commencé par la remise en cause des conclusions d'Alberto Alesina, en recourant non pas à l'analyse historique privilégiée par ce dernier mais à une analyse "narrative". Les économistes, Christina Romer (ancienne conseillère du président américain Barack Obama, lequel a retenu un effet multiplicateur de 1,5 de la dépense publique) et David Romer, ont ouvert la voie. Ils ont justement contesté l'approche historique qui affecte les variations d'élasticité – soit la variation relative d'une variable par rapport à la variation relative d'une autre variable (l'élasticité des recettes fiscales au PIB par exemple) – au structurel et non pas au conjoncturel, constituant "un biais d'endogénéité" dans la mesure de l'impulsion budgétaire. La progressivité de l'impôt peut ainsi expliquer les écarts entre les recettes fiscales et le PIB.
En phase d'expansion, il y a plus de recettes fiscales et donc une réduction du déficit structurel. De là était fait dans le modèle précédent le lien entre la consolidation fiscale et la croissance. "Sauf qu'il y avait une erreur de causalité, rétorque l'économiste. Le mouvement va de la croissance vers le déficit et non pas du déficit vers la croissance. "
En cas de bulle immobilière ou financière, le budget engrange des gains en capital taxés (par la taxe sur les transactions ou les plus-values). "Comme il n'y a pas d'élément conjoncturel identifié, qu'il n'y a pas de mesure nouvelle qui vient expliquer ce changement, vous supposez que c'est une variation des déficits structurels." Les bulles sont souvent associées à des phases de croissance positive : on fait alors le lien entre la réduction du déficit structurel et la croissance positive. L'approche narrative au contraire ne veut pas estimer la politique budgétaire par l'évolution des déficits structurels mais en reprenant ligne à ligne toutes l'impact de toutes les décisions de politique économiques sur l'activité économique, afin de mesurer "l'impulsion budgétaire".
"Le Fonds monétaire international s'est inspiré de la méthode des Romer et cela a conduit au résultat que les épisodes à la Alesina, les multiplicateurs qui deviennent négatifs à moyen terme, n'existent pas", fait savoir Xavier Timbeau. Par leur méthode, les Romer ont démontré que les multiplicateurs sont plutôt faibles à court terme. "L'introduction de cette précaution méthodologique a radicalement changé tout ce qui était considéré comme acquis auparavant."
Des multiplicateurs de 2,5 voire 3 : c’est "entrer dans un monde nouveau"
Les derniers développements datent des années 2009 à 2012, et l'OFCE elle-même, le duo d'économistes J. Bradford De Long et Lawrence Summers, ou encore Peter Howitt. Ils expliquent que "les multiplicateurs n'ont pas la même valeur en temps normal et en temps de crise". "C'est quasiment un retour à Keynes et peut-être même que Keynes n’a parlé de multiplicateurs qu'en temps de crise", imagine l'économiste de l'OFCE.
Ce dernier courant considère que l'effet multiplicateur est très élevé "car les arguments de Barro ne valent pas : les agents ne sont plus capables d'anticiper le futur, notamment parce qu'ils sont soumis à une contrainte de liquidité dans le court terme. Les anticipations deviennent inutiles. A cause de cela, le multiplicateur devient mécanisme opérant, alors qu’en "temps normal il est soit faible, ou bien ce n'est pas la question. "
Au dessus de 1, le PIB réel croit davantage que l'augmentation des dépenses gouvernementales. "Il y a cinq ans, vous écriviez dans un papier qu'un multiplicateur était de 2,5, même avec des éléments empiriques, ça ne passait pas, c'était hérétique." Les économistes qui représentent ces courants peuvent désormais évoquer des multiplicateurs de 2,5 – 3. Ce qui change tout. Dans ce cas, "quand vous faites de la récession budgétaire, le déficit augmente, la dette publique augmente. Pour la réduire, il faut dépenser plus et le déficit baisse. C'est entrer dans un monde nouveau."
Le problème fondamental est qu'en tant de crise on n'a pas d'observation. Sur les trente dernières années, il n’y a pas eu beaucoup de crises comparables sauf quelques cas exotiques. Donc, on est obligé de faire des compromis.
Conclusion : en temps de crise, ce qu'on racontait sur la hiérarchie impôt / transferts est inversé. En fait, les transferts en temps de crise sont très efficaces, ont un impact très fort sur l'activité. Les transferts s'adressent aux gens soumis à des contraintes de liquidités. L'effet distorsif des impôts passe par l'heure de travail. Dans une situation de chômage involontaire, cet effet est de second ordre."
Les projections de Xavier Timbeau
Xavier Timbeau, dans ses projections, prend en compte "le retour spontané d'une économie", soit "la tendance spontanée à retourner vers le plein emploi". C'est une hypothèse de retour à la moyenne, considérant que le système capitaliste est à peu près capable d'utiliser les ressources inutilisées." Il prend également en compte l'influence de la situation des autres pays.
Or, de ses calculs et simulations, il constate que "plus les pays sont enfoncés dans la crise, plus les multiplicateurs sont élevés", ce qui est cohérent avec son "intuition théorique". Dans ces pays, " la politique monétaire peut faire plus que compenser la consolidation fiscale". Le multiplicateur pour l'Autriche et l'Allemagne est par contre négatif. La trappe à liquidités y rend inefficace la politique monétaire expansive.
Xavier Timbeau en conclut que "ceux qui disent que pour relancer l'économie européenne, il faut relancer l'Allemagne, se trompent complètement." "Là où il faut relancer l'économie, c'est là où les multiplicateurs sont les plus élevés. Or, c'est là qu'on fait le plus de restrictions fiscales. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait une récession qui pointe le bout de son nez."
Or, la quasi-totalité des pays européens disposent d'un multiplicateur supérieur à 0,6, à partir duquel une restriction budgétaire a un effet négatif. L''Espagne disposerait d'un multiplicateur égal à deux. "Quand on est dans cette situation de multiplicateurs élevés, on peut être dans une configuration où on a intérêt à reporter l'ajustement budgétaire. Si les multiplicateurs changent en fonction du cycle, il faut sortir de la situation où les multiplicateurs sont élevés puis faire de la restriction quand ils sont moins élevés", recommande Xavier Timbeau.
"C'est juste une histoire d'intelligence. La stratégie de père de famille conduit à faire n'importe quoi. Ca aggrave le problème en pensant qu'on le résout. Ce n'est pas 'il faudrait être gentil et leur donner une année de plus', tout ça ce sont des pleurnicheries de technocrates qui n’acceptent pas d’avoir eu tort. Mais le véritable message est : 'La chose à faire est de ne pas faire de restriction, quand les multiplicateurs sont élevés, voire faire de l'expansion."
Les effets positifs d'une "austérité bien tempérée" basée sur le six pack et le TSCG et la nécessité d'un transfert de souveraineté
Xavier Timbeau développe, à la lumière de ces développements, les effets qu'auraient une "austérité bien tempérée". Il qualifie le scénario actuel d'ultra-austérité. Les prévisions estiment qu'il y aurait une récession de - 0,1 % en 2013 dans la zone euro et un chômage passant à 12 % en moyenne dans la zone euro. Le scénario d'"austérité bien tempérée" qu'il propose repose sur l'application du six pack et du TSCG qui prévoit le retour à un endettement public égal à 60 % dans vingt ans et un déficit structurel égal à 0,5 % (au rythme d'une réduction d'un demi-point par année. L'impulsion budgétaire en sortirait plus importante que dans le scénario de l'ultra-austérité. Au lieu de – 2,4 %, l'impulsion budgétaire serait de – 0,4 % pour l'Espagne. Au lieu de grimper à 12 %, le taux de chômage réduirait de 0,3 % pour atteindre 11 %. Le déficit public serait réduit de 0,1 %. "On ne serait pas sorti de la crise mais on passerait un tout petit signal d'espoir que c'est possible éventuellement un jour d'en sortir. Là, aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer aux Grecs, aux Portugais, aux Espagnols, c'est qu'ils ne vont pas s'en sortir."
Par ailleurs, Xavier Timbeau est favorable à la mutualisation des dettes. Il faut pour cela un transfert de souveraineté budgétaire. " Il faut accepter d'abandonner une partie de cette soi-disant souveraineté pour la reconstruire à un niveau où elle sera opérante. On peut transmettre ces pouvoirs à des institutions démocratiques légitimes de l'Europe, comme le Parlement européen ou un Sénat européen à créer. On pourra alors rendre crédible l'engagement de garantir la soutenabilité des finances publiques à vingt ans." En conséquence, il sera possible d'"emprunter à des taux réellement réduits, accepter cet impôt volontaire et reporter l'ajustement parce qu'on aura des démocraties suffisamment fortes pour tenir leur engagement."