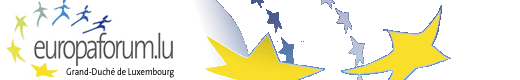Citoyenneté, jumelages, mémoire - Élargissement
Mémoires, héritages et défis d’avenir : l’unification de l’Europe 20 ans après (3) – Aspects politiques et économiques de la transition en Europe centrale et orientale
Les intervenants du Forum de l’IPW ont tiré un bilan sombre de processus dont l’aboutissement paraît incertain
19-09-2009
 Pendant toute l’année 2009, l’Institut Pierre Werner a consacré sa programmation aux événements de l’année 1989 qui ont eu comme conséquence immédiate la fin du clivage de l’Europe en deux camps ennemis. Cette césure que l’année 1989 a constituée dans l’histoire et les conséquences des événements de cette année cruciale ont fait l’objet des réflexions et des débats du VIe Forum de l’Institut Pierre Werner qui s’est tenu à Luxembourg les 18 et 19 septembre 2009.
Pendant toute l’année 2009, l’Institut Pierre Werner a consacré sa programmation aux événements de l’année 1989 qui ont eu comme conséquence immédiate la fin du clivage de l’Europe en deux camps ennemis. Cette césure que l’année 1989 a constituée dans l’histoire et les conséquences des événements de cette année cruciale ont fait l’objet des réflexions et des débats du VIe Forum de l’Institut Pierre Werner qui s’est tenu à Luxembourg les 18 et 19 septembre 2009.
Témoins et acteurs de l’époque, hommes politiques, écrivains et universitaires de toute l’Europe avaient été invités au dialogue afin de tenter d’appréhender ce qui s’est passé dans chaque pays de l’Est, tout en prenant en compte des points communs et des conséquences pour tous les pays européens.
Le Forum voulait avant tout revenir sur les dynamiques fondamentales qui ont conduit à la chute du Rideau de fer et à la dissolution de l’Union soviétique. Tout au long de ces deux journées, il a donc été question de savoir ce qui est resté de cette ambiance de renouveau et pourquoi quelques espérances attendaient encore leur réalisation 20 ans après.
Le Forum s’est aussi consacré au processus de transformation sociopolitique qui n’a pas bien réussi partout, qui s’est déroulé la plupart du temps pacifiquement, même si l’on n’a pas oublié la violence qui a caractérisé la fin du régime communiste en Roumanie, ni les guerres balkaniques. Force est de constater que le processus de ce grand changement de système n’est nullement terminé et renvoie toujours l’UE à ses grands défis.
L’après-midi du samedi 19 septembre, une deuxième session s’est attachée à analyser la recomposition du paysage politique en Europe centrale et orientale mais aussi les dimensions économiques de la transformation.
Peter Schlotter – Du rôle de l’OSCE hier et aujourd’hui, et de l’UE en tant que "soft power"
Peter Schlotter, professeur en sciences politiques à la Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg, s’est attaché à 
Revenant au processus d’Helsinki, lancé dans les années 70 avec l’ouverture de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) (qui a donné naissance à l’actuelle OSCE), Peter Schlotter a expliqué que son rôle avait été minime jusqu’en 1985. Il avait permis la création des groupes d’Helsinki, qui ont été ensuite démantelés sous Brejnev, et il avait aussi, en tant que seul espace de dialogue, contribué à la détente de la fin des années 1970.
Mais c’est avec l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev que son effet s’est nettement fait sentir. La libéralisation de la politique soviétique, son ouverture, ont permis aux idées occidentales de transparence et de détente de faire leur chemin jusqu’au niveau de la direction de l’URSS, ce qui a beaucoup changé les choses, y compris au niveau de la direction des armées. Il en a résulté aussi une diminution de la pression que Moscou exerçait sur les pays satellites et les relations entre personnes de l’Est et de l’Ouest – et l’exemple des relations interallemandes en est particulièrement révélateur – s’en sont trouvées grandement facilitées, ce qui n’a pas manqué de contribuer à l’émergence des groupes d’opposition dans les démocraties populaires.
Enfin, l’OSCE a eu un rôle dans toutes les négociations qui ont suivi, l’URSS ayant dû accepter à Helsinki des règles communes en matière de droits de l’homme et de droit des peuples à faire partie ou non d’une alliance. De plus, grâce à son influence en matière de démocratisation au temps de la Perestroïka gorbatchévienne, le processus d’Helsinki a eu un effet en matière de coopération.
Et tant que le processus de démocratisation était en cours, tant que la Russie n’avait pas entamé son retour en arrière autoritaire, l’OSCE a joué un grand rôle selon Peter Schlotter.
Aujourd’hui, l’influence de l’OSCE s’est réduite malgré son rôle important en matière de prévention des conflits, de tentatives visant à désamorcer des tensions. En effet, en matière de démocratisation, la politique de l’OSCE a été soutenue par l’UE pour tous les pays qui avaient des perspectives d’adhésion. Mais dans les pays d’Asie centrale, du pourtour méditerranéen ou du Caucase, son influence est de ce simple fait bien moindre.
Quant à l’Union européenne justement, son concept à l’égard des pays voisins se base, en gros, sur l’idée que la libéralisation de l’économie aboutit à la démocratisation, même si c’est loin de fonctionner partout, comme le souligne le professeur allemand. Et dans ce contexte, la politique européenne de voisinage de l’UE a ceci de positif qu’elle essaie de ne pas mener une politique hégémonique mais au contraire de mettre en œuvre une politique de soutien et d’aide au processus de démocratisation avec le consensus des pays concernés. En exerçant en bref une forme de "soft power".
Kai-Olaf Lang – Les mouvements populistes dans les nouveaux Etats membres de l’UE : un phénomène hétérogène qui peut être vu comme un appel au retour du politique

Le chercheur berlinois a tout d’abord insisté sur l’hétérogénéité d’un phénomène qui se distingue nettement des formes de populisme nationaliste connues en France ou aux Pays-Bas. Les mouvements populistes sont dans les nouveaux Etats membres soit des mouvements populistes agraires, sociaux ou de gauche, voire, pour certains, des populistes du centre, qui se caractérisent par leur vision simplifiée du monde.
Kai-Olaf Lang opère aussi une distinction entre un populisme "dur" - qui ne représente pas 10 % des mouvements populistes et qui se distingue par une volonté de changer les règles démocratiques - et un populisme "doux", un populisme "à visage humain" dont le personnel politique montre sa capacité à constituer des majorités et à arriver, pour certains, au pouvoir, comme c’est le cas par exemple en Pologne ou en Slovaquie.
Parmi ces mouvements, nombreux sont ceux qui tentent de se positionner plutôt à gauche en termes de politiques sociales – ce fut le cas par exemple en Pologne en 2004 quand l’enjeu des élections s’est résumé en quelque sorte au choix entre une Pologne libérale ou une Pologne solidaire, et qui a vu la victoire des frères Kaczynski. Mais une de leur caractéristique est aussi de défendre une position euro-critique, car ces "nouveaux plébéiens", comme le Hongrois Viktor Orban du FIDESZ s’est caractérisé lui-même, ont tendance à baser leur discours sur la défense des intérêts nationaux face à la globalisation.
Le succès que ces mouvements rencontrent, Kai-Olaf Lang les explique tant par la situation sociale et économique que par le fonctionnement de la démocratie ou encore une certaine frustration à l’égard du déficit du système politique et administratif.
En effet, l’adhésion à l’Union européenne signifiait symboliquement la fin d’un processus de transition qui a été long et pour certains douloureux. Or, il n’en a rien été dans les faits, ce qui a suscité une certaine frustration. Ce désenchantement fait suite à celui que beaucoup ont ressenti dans les années 90 face à l’arrogance des nouveaux puissants et qui s’est soldé par un certain dégoût pour la politique et une baisse de la participation électorale. De plus le processus de transition a pu être perçu comme une forme de "nihilisme technocratique" car s’il était question de réforme, il n’y avait pourtant pas d’alternative politique à ce discours de modernisation.
Finalement, la montée du populisme va de pair avec une certaine remobilisation politique et peut être considérée comme un appel à un retour du politique.
En conclusion, Kai-Olaf Lang a évoqué pour ce phénomène une "instabilité stable" qui ne l’inquiète pas outre mesure, et ce pour plusieurs raisons. D’une part parce que les populistes qui sont arrivés au pouvoir font preuve de pragmatisme, et ce notamment en termes d’économie ou de politique étrangère. Ils ne mettent non plus la démocratie en danger car ils en respectent les règles même si, pour prendre l’exemple des frères Kaczynski, ils privilégient une forme de démocratie antagoniste. De plus, les forces démocratiques sont assez fortes aux yeux du chercheur et l’adhésion à l’Union européenne a eu tendance, et ce notamment en Slovaquie, à freiner certains mouvements autoritaires.
S’ils veulent freiner cette montée des populistes, les partis établis doivent donc travailler sur leur programme et se soucier d’un renouvellement de génération. Quant à la société civile, Kai-Olaf Lang estime que son rôle à jouer contre le populisme est assez faible contrairement à ce que beaucoup affirment.
Janos Terényi - L’échec de la classe politique hongroise
Janos Terényi, ambassadeur honoraire et actuel directeur de l’Hungarian Institute of International Affairs de Budapest était invité à plancher sur la question de savoir si l’expérience hongroise du changement de système avait échoué ou non. Pour Janos Terényi, les politistes hongrois n’ont pas encore de réponse à cette question. D’où sa manière plutôt analytique que narrative d’aborder la question.
"La Hongrie a un problème d’image. Son image était positive avant et est devenue négative maintenant. Et cela bien que la réalité soit meilleure que son image." Tel est le point de départ de l’analyse de Janos Terényi. Son image était positive quand elle a fondé le "communisme goulasch". Elle l’était lorsqu’elle a coupé dans le rideau de fer. Elle l’a aussi été quand elle était en tête des pays voulant intégrer l’UE. Mais maintenant, pense Janos Terényi, elle n’utilise plus le potentiel qui est le sien dans le cadre de l’élargissement. Et de toute façon, si elle fut évaluée positivement, ce ne fut pas à cause de ses performances économiques, mais à partir de considérations politiques.
A la base du développement de la Hongrie depuis 1956, on trouve l’idée de Janos Kadar et du régime qu’il instaura selon laquelle le parti communiste ne pourrait rester au pouvoir que s’il passait avec la société un contrat social. Ce contrat prévoyait la dépolitisation de la société et une garantie d’un bon niveau de vie en échange du maintien au pouvoir du Parti communiste. Le problème fut qu’à terme, la Hongrie ne put pas financer ce contrat social, sinon au prix d’un endettement extérieur qui absorba dans les années 70 plus de 15 % de ses ressources.
La Hongrie ne put donc que négocier la transition à la fin des années 80. Il n’y eut de ce fait pas de catharsis pour la population, ce qui fit que, de manière répétée, le parti communiste devenu parti socialiste est revenu au pouvoir et a gardé sa légitimité. En même temps, les grandes institutions sociales – sécurité sociale, régime des pensions, fiscalité – n’ont pas été réformés au cours des 20 dernières années. L’impasse financière existe toujours. Les cycles de crise économique et financière se suivent en Hongrie, comme en 1980, 1985, 1995, 2006 et maintenant. L’économie croule sous le poids de l’absence de réformes. Mais il n’y a pas en Hongrie d’oligarchie comme dans d’autres pays pour amener des solutions d’en haut. Les problèmes sociaux s’accumulent pendant que les ressources pour aborder des réformes sociales s’amenuisent. La crise financière globale a donc atteint le pays de plein fouet, alors qu’il se débat déjà depuis des années dans des problèmes qui lui sont propres.
Conclusion de Terényi : la classe politique hongroise n’a pas répondu de manière responsable aux problèmes qui se posent au pays. Au contraire, ses membres s’accusent mutuellement d’être à l’origine du chaos, alors que "le pays est de nouveau le dos au mur" et qu’elle doit affronter le problème du renforcement de l’extrême-droite. Pour Janos Terényi, la priorité des priorités serait de mettre de l’ordre dans les budgets publics.
Alfred Steinherr - Un bilan économique négatif de l’élargissement
Alfred Steinherr, qui est actuellement professeur de sciences économiques à la Freie Universität Bozen et qui fut 
"Les attentes n’ont pas été satisfaites dans leur forme extrême", est une des thèses initiales d’Alfred Steinherr. Son explication : Personne, ni du côté occidental ni du côté oriental de l’Europe, n’avait l’expérience de ce que pourrait être une transition économique, de sorte que sur des questions clés, il n’y eut pas d’accord. On s’est demandé ainsi s’il fallait procéder à des réformes immédiates, et qui s’étaleraient sur 10 à 15 ans, ou graduelles, à l’exemple de la Chine, qui s’étaleraient sur une génération. Le passage de la propriété collective ou étatique à la propriété privée, notamment les tentatives de partage de la propriété, engendra beaucoup de corruption. Une autre approche était de dire que les usines devaient toujours avoir une certaine valeur et qu’il serait donc sage de les donner à des investisseurs. Dans ce domaine, les reprises se firent dans un cercle restreint d’initiés. Une autre difficulté fut d’ordre institutionnel. Comme tout ce qui était fédéral avait éclaté pendant les grands changements politiques, il était difficile de savoir comment répartir les avoirs. Tout était à refaire : la monnaie, les taux de change, les taux d’intérêt, les politiques fiscales, les réseaux de protection sociale, etc.
La transition a-t-elle donc fonctionné ? Elle a d’abord suscité de grandes frustrations. Le vieux système a été remisé, mais le nouveau ne s’est pas mis pour autant à exister. Ce qui a engendré le chaos. Les productions nationales se sont infléchies parfois de plus de 40 %, l’inflation a enflé. Néanmoins les attentes demeuraient grandes.
Mais pouvait-on consommer avant de rebâtir ? Mais rebâtir avec quels fonds dans un contexte de croissance en régression ? On a misé sur l’épargne intérieure et les fonds venant de l’extérieur. On s’est conformé aussi aux règles et aux exigences de l’UE. Cela ne s’est pas fait sans problèmes, puisque l’UE des 15 était un club d’économies prospères et matures et que c’étaient les règles de ces économies qu’il a fallu appliquer aux économies de transition.
L’UE a soutenu ses exigences en pourvoyant les nouvelles économies ouvertes de fonds considérables. Alors que le plan Marshall de la fin des années 40 avait duré quatre ans, le soutien de l’UE continue, ce qu’Alfred Steinherr juge "trop généreux", d’autant plus que la perplexité marque toujours les décisions sur la manière d’investir l’argent.
Alfred Steinherr, qui a constaté que l’UE continuait à admettre en son sein un pays pauvre et qu’il n’avait pas envie, quant à lui, de faire partie d’un club de pays pauvres, a insisté sur le fait qu’en termes purement économiques, le rapport entre transferts de fonds vers les nouvelles économies européennes et la performance commerciale de ces économies était négatif. Thèse qui fut fortement contredite par la consule de la Pologne, Ewa Sufin-Jacquemart.
Mihai Geamanu : La société roumaine ne se reconnaît pas dans le modèle de société qui a été imposé à la Roumanie après 1989
Mihai Geamanu, un jeune analyste politique issu de la National School for Political and Administrative Studies de Bucarest a évoqué les obstacles et les résistances à un réel changement de système en Roumanie.
Sa thèse : la Roumanie s’est appliquée un modèle de synchronisation politique et économique en "simulant" les formes politiques et économiques en vigueur à l’Ouest de l’Europe. Mais le débat sur la modernisation en Roumanie a révélé selon Mihai Geamanu que l’on ne peut pas reprendre des formes de l’Ouest sans en assimiler et adapter les valeurs essentielles. Développer des formes pures ne peut fonctionner durablement, et il en est de même tant pour une forme sans substance que pour une substance sans forme. Néanmoins, même la méthode de synchronisation a conduit à des changements irréversibles, même si jusque-là, l’intégration de la Roumanie dans l’Europe a, selon Mihai Geamanu, échoué. Le peuple se méfie des élites, qui, quant à elles, n’ont pu lui fournir une société roumaine dans lequel se reconnaître. Les appels à une main forte qui viendrait diriger le pays avec autorité s’amplifient.
Le modèle de synchronisation n’a pas contribué à l’émergence d’un capital social qui permettrait une autre voie. La solution dans un sens européen viendrait, telle est la thèse très théorique de Mihai Geamanu, du développement d’une stratégie par les élites roumaines qui confère un sens à l’évolution de la société roumaine et qui pourrait de ce fait être reprise par cette même société roumaine. Mais aucune allusion à un possible pilier, à une éventuelle pierre angulaire d’une telle stratégie n’a été faite.
Silvo Devetak - Les paradoxes de la politique européenne en ex-Yougoslavie

Silvo Devetak a salué la politique de l’UE qui, depuis le Conseil européen de Thessalonique de 2000, a ouvert une perspective européenne aux Balkans occidentaux. Mais pour arriver ne serait-ce qu’à 75 % de la moyenne du PIB de l’UE dans un temps raisonnable, les pays de la région devraient afficher une croissance économique trois fois supérieure à celle de l’UE. Or, si des aides parviennent à la région, si des accords de libre commerce ont été signés avec l’UE, et si de nombreux outils de coopération régionale ont été mis en œuvre, les pays de la région s’opposent l’un à l’autre des clauses protectionnistes, comme par exemple la Bosnie-Herzégovine ou l’Albanie. En même temps, le processus d’intégration est bloqué. La Macédoine attend une réponse à sa candidature. Le Monténégro adresse des demandes. L’accord de stabilisation et d’association avec la Serbie est bloqué.
Silvo Devetak craint que les objectifs de toutes ces démarches ne soient pas très clairs et qu’ils ne soient pas soutenus par les populations. Est-ce bien, est-ce mal de devenir un jour un Etat membre de l’UE ? Ce que Silvo Devetak pense, c’est que les ressources financières qui ont été prévues par l’UE pour la période 2007-2011 ne correspondent pas à la demande ni aux besoins des intéressés. Quelques pays de la région ne bénéficient pas de leur pleine souveraineté, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie notamment, cette dernière étant par ailleurs dépassée économiquement par la Bulgarie, qu’elle supplantait souverainement du temps de la Fédération yougoslave, et de surcroît, ses citoyens sont soumis à une obligation de visa. Même en Slovénie, après 20 ans d’indépendance, après l’adhésion à l’UE et l’introduction de l’euro, un sondage a révélé selon Silvo Devetak que 75 % de la population estime que la situation était meilleure avant.