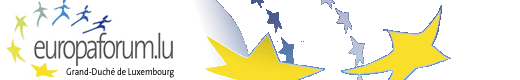Citoyenneté, jumelages, mémoire
VIIe Forum de l’IPW - Comment écrire une histoire européenne ? (3) Pour mieux exister, l’Europe a-t-elle besoin de symboles et d’objectifs ?
30-09-2010 / 01-10-2010
Le point du départ de la réflexion qu’a tenu à engager l’Institut Pierre Werner (IPW) en organisant, les 30 septembre et 1er octobre 2010, son 7e Forum européen de la culture et de la société, se situe, à en croire Sandrine Devaux, en 2007, lorsque l’UE fêtait en grande pompe ses 50 ans. 
Le slogan "Ensemble depuis 1957" était décliné dans toutes les langues de l’UE, y compris dans les langues des nombreux Etats membres qui ont rejoint le club européen bien après 57… N’était-ce pas là une façon d’imposer une vision de l’histoire de l’intégration européenne ? C’est de là qu’a surgi la question qui a donné son titre à la septième édition du Forum de l’IPW : Comment écrire une histoire européenne ?
La dernière table ronde du Forum a fait écho aux débats soulevés lors de la toute première. La question soulevée était en effet celle de la nécessité pour l’Europe - ou non - de symboles pour pouvoir mieux exister.
Comment susciter l’adhésion ou la contestation par rapport au projet européen ? Certes il est difficile de définir des critères pour mesurer cet intérêt, mais la faible participation aux élections européennes reste un indice significatif. La question reste donc pleinement ouverte. Une dimension sacrée est-elle nécessaire, a-t-on besoin de symboles, ou bien faut-il susciter l’intérêt des citoyens par plus d’efficacité, par plus de bien-être ? Comment présenter le projet européen, par quelles narrations, par quel récit ?
Les politologues François Foret et Robert Harmsen ont éclairé de leurs analyses ces questions fondamentales.
Le symbolique est un révélateur de l’ordre politique européen aux yeux de François Foret
Le politologue François Foret s’est ainsi penché sur le symbolique, qu’il voit comme un révélateur des différentes strates du politique.
Bien conscient que tout ne se résume pas au symbolique et que la sphère de représentation ne détermine pas le réel, le jeune politologue revendique la pertinence de cet outil qui fait office de prisme grossissant des ressources politiques et des rapports de pouvoir. Il permet d’en analyser la dimension institutionnelle, et François Foret cite pour exemple le protocole comme lieu de la théâtralisation de l’ordre politique. Les difficultés pour trouver un  consensus sur la place à donner à Herman Van Rompuy et à José Manuel Barroso ne révèle pas qu’une question d’ego mais traduit bien plus les relations interinstitutionnelles, les relations extérieures, les rapports de force et l’image donnée au citoyen. Le symbolique révèle aussi la dimension sociologique du pouvoir, les différents rôles, à la fois politiques et profanes, laissant d’ailleurs apparaître des inégalités. Le symbole, lieu où se noue l’articulation entre la culture et le politique, laisse aussi entrevoir les dimensions culturelle et normative du politique.
consensus sur la place à donner à Herman Van Rompuy et à José Manuel Barroso ne révèle pas qu’une question d’ego mais traduit bien plus les relations interinstitutionnelles, les relations extérieures, les rapports de force et l’image donnée au citoyen. Le symbolique révèle aussi la dimension sociologique du pouvoir, les différents rôles, à la fois politiques et profanes, laissant d’ailleurs apparaître des inégalités. Le symbole, lieu où se noue l’articulation entre la culture et le politique, laisse aussi entrevoir les dimensions culturelle et normative du politique.
Pour François Foret, le symbolique est donc un outil qui permet de comprendre un système politique comme celui de l’UE, qui est caractérisé par un environnement transnational, multiculturel, où les codes se renouvellent en permanence et où les processus d’apprentissage sont permanents. Et il estime bel et bien que l’on peut parler de symbolique pour l’UE.
On retrouve en effet le symbolique dans des rituels comme les sommets européens ou bien le rituel du jeu démocratique qu’est le vote, on le retrouve dans des rôles qui peuvent aussi être ceux du quotidien, à l’image des étudiants Erasmus, dans des événements comme la Fête de l’Europe, dans des discours ou encore dans des symboles matériels comme des monuments, des drapeaux ou encore la monnaie unique. Les pistes sont nombreuses et pourtant, relève François Foret, le sujet est peu évoqué. Le symbolique est soupçonné d’être anodin, et pourtant il est, dès qu’on veut en préciser le sens, source de conflits qui peuvent du coup sembler disproportionnés.
La justification fonctionnaliste d’une Europe fondée en raison apparaît en filigrane dans le grand récit qui se construit
Et c’est particulièrement vrai pour l’UE ou le symbolique fait dissensus, comme en témoignent le silence des traités sur ces aspects, ou encore le fait que la question de l’héritage et de toute référence au passé européen est un sujet qui fâche. C’est bien la preuve pour François Foret que la question du symbolique mérite l’attention. Car elle met l’UE mal à l’aise. Pourquoi ? Essentiellement parce que l’UE se veut fondée sur un ordre rationnel : elle est fondée en raison sur ses objectifs, légitimée par ses résultats, son efficacité et ses modes d’actions. Cette "démocratie délibérative" au sens d’Habermas a donc quelques difficultés à faire face au symbolique qui mobilise aussi l’irrationnel.
Pourtant, selon le politologue, l’UE oscille entre deux pôles. D’une part un discours fondé en raison qui donne au projet européen une justification fonctionnaliste et d’autre part un autre discours qui relève plus du symbolique, de la logique du grand récit. Il y a là derrière une sorte de texte caché qui donne du sens et une finalité au projet européen, qui est souvent accompagné d’un certain messianisme. Le politologue observe cependant que le grand récit apparaît aussi dans des doctrines a priori fonctionnalistes, et il en conclut qu’il n’y a pas de choix possible entre ces deux tendances, qui fondent tous les ordres politiques, y compris l’ordre politique européen.
Pour François Foret, l’Euro illustre cette thèse. A priori, l’euro relève en effet du fonctionnalisme pur, c’est un succès historique des politiques publiques européennes, et il a fait office de test, démontrant la capacité de l’UE à conduire un processus de changement social. Pourtant, les Européens étaient censés se sentir plus Européens grâce à l’Euro, l’idée était que l’Europe serait dans nos poches. Mais sur ce plan là, l’Euro n’est pas une réussite. Certes, il est pratique pour ceux qui voyagent, mais il laisse entrevoir aussi des lignes de clivage sociologique dans la mesure où tout le monde n’en a pas tiré bénéfice. L’Euro, c’était aussi un symbole en gestation, mais il est mort dans l’œuf, précise le politologue. L’idée de mobiliser le panthéon des grands Européens pour les billets n’a en effet pas abouti. En fin de compte il n’y a pas la moindre correspondance avec un lieu réel, tout risque d’enracinement et donc d’arbitrage ayant été soigneusement écarté...
Pour Robert Harmsen, la crise de légitimité du projet européen est le fruit d’un déficit narratif qui se situe pour l’essentiel au niveau national
Pour le politologue Robert Harmsen, qui dirige le Master en gouvernance européenne de l’Université de Luxembourg, s’il y a une explication à la crise de légitimité que traverse l’Europe, elle est à chercher dans un déficit narratif qui, pour l’essentiel, se situe au niveau national.
Les référendums qui ont vu le rejet du traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas ont révélé l’absence de discours nationaux convaincants sur l’Europe, explique Robert Harmsen. Il se souvient par exemple que le Premier ministre néerlandais de l’époque, Jan Peter Balkenende, avait tenté d’expliquer le rejet du traité par un manque de symboles européens. Il s’était fait ensuite accueillir au Parlement européen par une marée de drapeaux. Car quelqu’un a-t-il vraiment voté "non" à cause des symboles ? Selon le politologue, la question n’a pas même été discutée dans les campagnes, et elle n’apparaît pas non plus dans les sondages réalisés à la sortie des urnes.
L’explication centrale des "non" français et néerlandais de 2005 et du "non" irlandais de 2008 réside pour Robert Harmsen dans le clivage entre démarcationnistes et intégrationnistes. Les premiers, qui cherchent à protéger la démarcation du national, se montrent sceptiques face à l’UE, à la mondialisation et à l’immigration, et sur le plan socio-économique, ce sont aussi ceux qui se sentent menacés par la mondialisation. Les seconds, qui se montrent plus ouverts sur le monde extérieur, sont aussi plus favorables à l’UE, à la mondialisation qu’à l’immigration, et ils sont, sur le plan socio-économique, les "gagnants" polyglottes, bien formés et bien payés.
démarcation du national, se montrent sceptiques face à l’UE, à la mondialisation et à l’immigration, et sur le plan socio-économique, ce sont aussi ceux qui se sentent menacés par la mondialisation. Les seconds, qui se montrent plus ouverts sur le monde extérieur, sont aussi plus favorables à l’UE, à la mondialisation qu’à l’immigration, et ils sont, sur le plan socio-économique, les "gagnants" polyglottes, bien formés et bien payés.
Quand il analyse les arguments donnés dans ces pays pour le "oui", Robert Harmsen observe un discours pro-européen assez générique et faisant peu de référence précise au texte. Les arguments du "non" en revanche se démarquent très nettement selon lui. En France, il s’agissait notamment de protéger le modèle social contre le libéralisme du traité européen, un argument totalement absent aux Pays-Bas où les tenants du "non" faisaient preuve d’une certaine crispation identitaire, craignant pour l’autonomie de leur petit pays dans une Europe élargie. En Irlande, le discours des partisans du "non" en appelait à la neutralité ou à l’interdiction de l’avortement, des questions fortement liées à une image traditionnelle de l’identité nationale. Ce sont donc les particularismes qui se sont exprimés contre des arguments européens génériques.
Le politologue invite à un recalibrage d’un discours européen fondé sur le concept de "demoi-cratie" et qui devrait être constitué de "méso-narrations"
Or, observe Robert Harmsen, la seule réponse proposée par les institutions à été de réaffirmer ce discours générique pourtant rejeté. Il est nécessaire de trouver une réponse efficace à ces différentes craintes, à l’émergence de ces particularismes nationaux, et il faut pour cela recalibrer le discours européen, estime le politologue.
Un projet de recherche qu’il mené avec l’Université de Trèves a permis, en prenant le prétexte des élections européennes, d’inciter à observer les discours européens dans les différents Etats membres et à analyser l’évolution des discours nationaux sur l’Europe. Les quatorze études de cas réalisées révèlent la diversité des discours. Mais elles montrent aussi un épuisement du récit traditionnel de la réconciliation, à l’exception peut-être de la Belgique et du Luxembourg. Ce vide a cependant suscité dans les pays fondateurs l’émergence de discours plus critiques sur certains aspects de l’intégration européenne. Dans les pays post-communistes, Robert Harmsen a noté l’absence d’une intériorisation du discours européen. Les représentants politiques de ces pays semblent ne pas se sentir comme des acteurs à part entière dans les institutions européennes. L’UE apparaît pour eux comme une ressource, un modèle, mais ils ont un discours qui approche plus de celui que pourrait tenir un pays candidat. Bien sûr, cela peut évoluer, précise le politologue. Au Royaume-Uni, le discours n’a absolument pas évolué en revanche, tandis qu’au Danemark, le discours n’est pas devenu plus europhile, mais a évolué vers les formes de discours critiques observées dans les pays fondateurs.
Cette diversité des discours rend difficile d’imaginer un récit qui pourrait les réunir, une sorte de méta-narration. Mais, pour Robert Harmsen, il est en revanche possible d’inventer des méso-narrations, des discours intermédiaires mettant l’accent sur la relation entre ce qui relève du national et ce qui découle de l’européen. Si les élites nationales ne l’ont pas fait jusqu’ici, il convient cependant de jouer un rôle de médiateurs entre ces deux niveaux et de donner du sens à ces différents prismes nationaux. Le modèle que défend Robert Harmsen est celui d’une "demoi-cratie" européenne, entité fondamentale constituée de différents peuples et offrant un espace public pluriel, un concept inventé par la politologue Kalypso Nicolaïdis . L’UE y est définie comme une "communauté des autres" nécessitant de la part de chacun un effort de reconnaissance mutuelle des spécificités culturelles, politiques ou sociales.