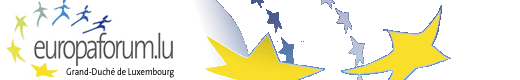Economie, finances et monnaie
L’économiste français et cofondateur du Parti de gauche, Jacques Généreux, plaide pour le "coup de force" d’un Etat membre afin de remettre l’Europe sur la voie de la coopération
24-05-2013

Cette période se serait ouverte, à la charnière des années 70-80, avec la victoire politique des néolibéraux et des individualistes, aux USA, en Grande-Bretagne d’abord, puis progressivement en Europe. On a alors donné "la pleine liberté et les pleins pouvoirs" au capital, "non seulement dans l’entreprise mais aussi dans la société". Or, un tel développement "ne s’était jamais produit dans l’histoire", pense l’économiste, qui se considère désormais comme un anthropologue. "Quand se sont invités dans l’histoire de l’humanité la propriété, l’argent, la marchandise et les grandes sociétés d’échanges et commerciales, la réaction de toutes les sagesses humaines, laïques, philosophiques et religieuses, et de toutes les sociétés humaines, a été de cantonner le plus possible le règne de la marchandise, de la compétition, de l’accumulation et de la passion de l’argent", explique-t-il. La "grande régression" a opéré un "bouleversement radical qui a consisté à libérer totalement et à pousser jusqu’au bout cette passion pour la rivalité d’acquisition et la compétition".
Le capitalisme se construit contre les sociétés et leur culture. Dans ses premières phases, au XVIIIe et au XIXe siècle, il a ainsi rencontré une solide opposition sur son chemin. Les différents courants de pensée, libéraux, socialistes, Marx et les penseurs communistes, mais la société également, ont réagi par un mouvement de résistance "qui va se traduire assez vite par des entraves mises à l’expansion du capitalisme", dont les premières lois sociales à la fin du XIXe siècle. Pour cause, "ce capitalisme se développe dans des sociétés traditionnelles encore gouvernées par des conventions sociales, par des traditions locales, par des pensées religieuses, dans lesquelles l’idée que les hommes se font de la vie en société n’est pas que la vie normale est d’être tous en compétition effrénée les uns contre les autres."
Il y a eu un premier grand effondrement dans les années 30, après l’introduction au début du XXe siècle de la libre circulation du capital, la libération de la poursuite des profits, les spéculations boursières. Des gens venus de tous horizons politiques ont forgé, au lendemain de la 2e guerre mondiale, des compromis permettant de renouer avec le progrès. "Ainsi, dans les années 50-60, les sociétés occidentales ne sont pas capitalistes", poursuit l’économiste. Les prix, les salaires et les loyers sont administrés par l’Etat. Il existe une très forte redistribution sociale du revenu à travers la protection sociale. Les détenteurs de capital ont certes un pouvoir de gestion dans l’entreprise mais il est restreint. Le pouvoir est aux managers, souvent salariés, qui peuvent avoir des stratégies économiques, et aux capitaines d’industrie. Les actionnaires devaient se contenter d’un taux de rendement maximal, de 3-4 % par an, à peine plus élevé celui des livrets de caisse d’épargne.
Une crise financière, mais aussi écologique, politique et morale
Jacques Généreux considère que ce détour par le temps long est indispensable pour aborder la crise actuelle, car il s’agit de "comprendre toute la dimension politique du blocage de société dans lequel nous sommes". Chausser les seules "lunettes de l’économiste" est insuffisant pour y parvenir. "Trouver des solutions économiques aux problèmes que nous connaissons, est très facile. La question est de savoir pourquoi, alors que les solutions existent et assez faciles à mettre en œuvre, que nous sommes dans des pays riches qui ont tous les moyens, financiers, techniques, administratifs, pour régler ce petit problème en six mois, elles ne sont pas appliquées", dit-il.
La grande régression qu’il décrit se décline dans de nombreux domaines. Elle est ainsi une "régression écologique". C’est également une "régression politique", "régression même de l’esprit démocratique dans la tête des élites et des gouvernants", comme "le mépris du suffrage universel" qui s’est exprimé sur le traité constitutionnel européen, finalement adopté sous la forme du traité de Lisbonne, en serait l’exemple. "Pour le dixième de cela, il y a cinquante, cent ans, il y aurait eu des émeutes, des révolutions", poursuit l’économiste, qui pointe à ce sujet, l’apathie "des grands médias, qui jouent le jeu du conformisme, et défend les intérêts de ceux qui ont le pouvoir et de ceux qui ont l’argent". "Le cadre économique de production des médias fait que les médias ne peuvent plus jouer leur rôle de contre-pouvoir démocratique", dit-il. Enfin, la régression est aussi "morale", dans cette société où les médias transmettent "le culte de soi, de son plaisir, de sa consommation, de la compétition et dénigrent en permanence tout ce qui viendrait de lois sociales, de normes supérieures qui devraient s’imposer aux individus".
Le grand revirement provoque ainsi "une grande angoisse", "un grand désarroi, un manque de repères total, de bornes et de normes". Il y avait jadis "un idéal politique, une morale civique, une éducation religieuse, expliquant qu’au-delà des passions individuelles, il y a quelque chose qui s’appelle l’Autre, qui est important, et l’intérêt général qui s’impose", poursuit Jacques Généreux. La religion était "anthropologiquement, ce qui reliait les gens entre eux, une norme supérieure à l’intérêt individuel". Elle participait à l’unité de la société. Or, les êtres humains étant des êtres sociaux qui ont besoin de règles sociales, les individus, pour en retrouver, pourraient se tourner vers des fanatismes, vers le religieux qui détache les gens de leur famille, de leur société, de leurs traditions, et non plus vers la religion qui unit.
Depuis trente ans, les gouvernements européens auraient participé à "mettre la puissance de l’Etat, au service des intérêts privés"
Depuis une vingtaine d’années, la droite et la gauche, indifféremment, auraient participé à la mise en œuvre du projet néolibéral consistant en "la réduction du périmètre des biens publics, des services collectifs, de l’Etat pour rendre au marché davantage d’activités (éducation, santé, transport)". Ainsi, "on étend la marchandisation du monde avec l’idée que l’Etat sert plutôt à enfermer les méchants, à assurer l’ordre et la sécurité", souligne Jacques Généreux. Or, l’essentiel de la gauche européenne se serait convertie "à la quasi-totalité des dogmes néolibéraux", dont le libre-échange, la flexibilité, la compétitivité. Ainsi, Blair, Schroeder mais aussi Hollande, ont admis que "c’est quand on gagne dans la compétition contre les autres qu’on dégage des marges de manœuvre pour faire du progrès social". Ce qui est, dit Jacques Généreux, une "ânerie économique monumentale" : "Si tout le monde est compétitif, personne ne l’est. Momentanément, un pays peut arranger sa situation en étant compétitif, à condition qu’il soit le seul, comme l’Allemagne actuellement."
La crise de l’euro "n’est pas une crise des finances publiques, de la compétitivité de certains Etats, mais de la liberté donnée à la finance privée de faire tout et n’importe quoi", pense Jacques Généreux. "La rémunération du travail n’a cessé d’être comprimée au profit de revenus du capital, qui sont simplement allés dans l’accumulation de patrimoines financier et immobilier, qui non seulement n’ont aucune utilité sociale" mais comportent aussi des effets nocifs à travers les bulles spéculatives, "provenant de la surabondance de liquidités et de profits", explique l’économiste.
La crise des finances publiques provient du fait que les Etats ne cessent de rendre l’argent aux contribuables les plus riches. Sur les années 1980-2000, dans tous les pays industrialisés, le poids de l’impôt a augmenté. C’est la structure des dépenses et des recettes fiscales qui aurait changé. Il y aurait eu de moins en moins d’imposition sur le capital, sur les revenus financiers, sur les successions, couplée à la création de nouveaux moyens légaux tels les placements privilégiés, les exonérations et les niches fiscales, pour permettre aux entreprises et aux riches de payer des taux d’imposition ridicules. D’autre part, il y aurait de plus en plus de taxes indirectes sur la consommation ou de taxes sociales directes, de telle sorte qu’en France par exemple, le système fiscal jadis progressif est devenu régressif. Ainsi, explique Jacques Généreux, "les politiques néolibérales ne consistent pas à réduire le poids de l’Etat mais à mettre la puissance de l’Etat, au service des intérêts privés."
Un projet dissimulé derrière la crise
Pour l’économiste, si les Etats n’ont pas cherché à remédier à cet assèchement de leurs caisses, c’est parce que cela les autorisait à "mettre en scène la situation qui permettrait, vis-à-vis des populations, de faire passer leur projet". "Depuis trente ans, à force de dire qu’il y a trop de déficit, on met dans la tête des gens que nous vivons au-dessus de nos moyens, que nous n’avons plus les moyens de nous payer un Etat-providence et devons passer à des solutions privées", détaille-t-il. Cette obstination, à poursuivre les politiques de rigueur et la réduction des périmètres de dépenses publiques serait le résultat d’"une forme de projet politique". Puisque ce projet voulu par "les Merkel, Schröder, Blair, Hollande, etc. ne peut pas passer en force, compte tenu de la culture des pays concernés, la crise a été instrumentalisée". On l’a transformée en crise des finances publiques, "en sauvant les banques sans rien demander en échange".
Jacques Généreux est d’avis que les gouvernants savent actuellement très bien qu’on arrive au bout du mouvement de "grande régression", au bout du capitalisme, de notre modèle de production en termes écologiques, et de notre fonctionnement politique. "Ils ont eu trente ans dédiés à la gloire de la concurrence, de l’individu et ils savent très bien que la nouvelle culture qui va monter va [dénoncer] la marchandise et la production car les peuples sont avides de retrouver des sociétés humaines où on vit ensemble."
Jacques Généreux explique que la sortie de l’euro voire de l’UE sera un débat omniprésent durant les élections européennes de 2014. Il y aura des "nationalistes de tout poil favorables à la destruction du projet européen, à un repli national". Et, regrette-t-il, ce mouvement croît beaucoup plus vite que la gauche européenne à laquelle il appartient, une gauche qui a des solutions mais devrait passer au "coup de force" pour pouvoir les appliquer. Ce coup de force serait aussi la seule solution de sauver le projet européen, alors que "l’Europe, telle qu’elle fonctionne là, est condamnée".
Racheter les dettes illégitimes et faire du déficit utile
Pour Jacques Généreux, les arguments sur l’impossibilité d’agir sur les politiques fiscale, budgétaire et monétaire, sont fallacieux. "Les financiers n’ont le pouvoir que parce que des hommes politiques exercent le pouvoir au service du capitalisme financier", dit-il. Or, "le politique est là pour rappeler de temps en temps que le seul véritable pouvoir en réalité, c’est le politique qui l’a, car il est le seul qui a le pouvoir de police et l’armée pour faire exécuter la loi", dit l’auteur du livre-programme "Nous, on peut", publié pendant la campagne présidentielle française en 2012. Dans le rapport de force, ni les capitalistes, ni l’Union européenne, ne disposent des moyens de coercition à même de "raisonner" un Etat membre qui entamerait le bras de fer, aura répété à plusieurs reprises l’économiste.
"Il n’y aura pas une armée de capitalistes qui vont venir déboulonner un gouvernement", a-t-il notamment dit pour expliquer l’efficacité de la "meilleure solution" au surendettement qu’il préconise, à savoir "une annulation pure et simple de leur dette". Les Etats surendettés ont ainsi le pouvoir d’arrêter de payer, de discuter avec les créanciers, et de n’offrir un remboursement partiel qu’à ceux qui voudront bien continuer à les financer. Le reste de la dette serait pour sa part monétisée. La banque centrale rachèterait la dette et la transformerait en monnaie, ce qui consiste à "faire un peu d’inflation monétaire". Or, cette monnaie à nouveau disponible dans les banques, serait disponible pour l’économie dans un cadre où les activités spéculatives seraient interdites.
Il faut aussi relancer massivement l’activité, et ne prendre garde, à court terme, du niveau de déficit public. Car, par les effets multiplicateurs, cette politique de relance permettrait de retrouver une croissance normale, à engendrer également de nouvelles recettes fiscales qui compensent l’investissement et permettent à terme de rembourser les dettes. Ce serait faire du "déficit utile" et rompre avec la création d’un déficit public inutile réalisé depuis vingt ans, par la baisse des impôts sur les plus riches. Ainsi la France, perd chaque année 50 milliards d’euros d’intérêts, en raison des deux cents milliards d’euros de recettes partis dans l’accumulation des revenus et des patrimoines.
Le "coup force" par la désobéissance aux traités
Néanmoins, mener une telle politique dans un Etat membre nécessiterait le bras de fer avec les autres Etats membres de l’UE. Mais, "faire le coup de force" doit permettre de "sauver le projet européen en train d’être détruit". Cette "voie maligne, complexe, intelligente" permettrait d’ "enclencher une dynamique de coopération entre les peuples européens". Jacques Généreux, en présentant ce programme, pense qu’il s’agit d’un rôle que pourrait endosser la France.
"Un pays peut toujours faire ce qu’il veut, face aux banques, au marché…", affirme-t-il. "Ce n’est pas les traités européens ni l’euro qui imposent aux gouvernements de mener des politiques d’austérité." Pour retrouver des marges de manœuvre budgétaire, la France pourrait dénoncer le TSCG, dans le plus pur respect des traités européens, puisqu’il n’est encore qu’un traité international et que la politique budgétaire et fiscale est du ressort de la souveraineté nationale. La France serait en mesure de récupérer deux cents milliards, en supprimant les niches fiscales qui ne servent à rien, en combattant la fraude fiscale partie à l’étranger.
Pour se mettre à l’abri des spéculations financières, la France aurait besoin de mettre un terme à la libre circulation des capitaux, qui seraient désormais contrôlés administrativement, et interdire la création d’instruments financiers à visée spéculative. Or, les traités européens interdisent cela, ce qui rendrait nécessaire un "coup de force". "Il faut désobéir", pense Jacques Généreux, sans qu’il ne soit question de quitter ni l’UE ni la zone euro. "Le traité de l’Union européenne prévoit les conditions pour rentrer mais pas celles pour rester", fait-il remarquer. Certes, des plaintes pourraient être déposées auprès de la CJUE. Mais, même condamnée, la France pourrait soit refuser de payer, soit s’acquitter de "broutilles" par rapport à ce que ses choix rapporteraient à son économie. D’ailleurs, face à ce succès, "la pression des peuples dans les autres pays pour faire pareil deviendra extrêmement forte".
Il faut que la banque centrale puisse créer de la monnaie et financer directement les besoins publics. Si la BCE ne veut pas le faire, s’il n’est pas possible d’ouvrir des négociations, alors la solution passerait par la désobéissance et une réforme unilatérale de la Banque centrale nationale française à qui serait donnée légalement l’autorisation de créer de l’euro pour acheter de la dette publique. Bien que légal nationalement, cela resterait, dit Jacques Généreux, illégal sur le plan européen. Si "les gouvernements européens ne peuvent pas exclure la France de la zone euro car ils n’ont aucun moyen pour le faire", la BCE aurait le loisir d’exclure la Banque nationale de France du système européen des changes inter-banques centrales. Il y aurait deux euros, un de la BCE et un de la Banque de France, qui s’échangerait de manière négociée, avec un euro européen fort et un euro français forcément plus faible. Un euro français dévalué de 40 % constituerait "une bonne nouvelle pour les industriels français et une catastrophe monumentale pour l’économie allemande", historiquement terrorisée par l’hyperinflation que pourrait entraîner un enchaînement de décisions semblables dans l’UE. "Si un seul pays a le courage et la crédibilité nécessaires pour dire "on va le faire", l’Allemagne négociera sur les statuts de la BCE et sur le contrôle des capitaux, parie Jacques Généreux qui ajoute : "C’est une option crédible et nous n’en avons pas d’autre. C’est la seule que nous avons pour éviter que l’Europe soit foutue."
"Renouer avec la logique coopérative"
Pessimiste sur les chances d’un parti comme le sien d’arriver au pouvoir en Europe et de tenter un tel "coup de force", Jacques Généreux considère néanmoins que la réflexion sur la reconstruction de l’Europe est incontournable, puisque d’ici quelques années, des Etats membres quitteront l’UE et la zone euro, de "manière désordonnée", sous l’impulsion de mouvements nationalistes et de peuples qui seront en rupture avec l’UE.
Jacques Généreux considère qu’au transfert de nombreuses compétences à l’UE doit correspondre un renforcement de la démocratie européenne, avec de "vrais moyens de coordination monétaire et économique, et un vrai pouvoir politique et non technocratique responsable devant les citoyens". Ce serait le seul moyen de revenir vers "une Europe de la coopération", celle qui "était perçue comme quelque chose de positif, qui allait dans le sens de l’intérêt des peuples, disposés ainsi à un abandon progressif de parts de souveraineté". "On pouvait à l’époque rêver d’une démocratie européenne, de créer peu à peu le sentiment d’un destin, d’un intérêt commun, de tout ce qui forme à long terme un peuple européen, condition préalable à l’existence d’une démocratie européenne". Pour revenir sur cette voie et mettre fin à la "grande régression", Jacques Généreux considère qu’il faut "repartir en arrière, renouer avec la logique coopérative pour reconstruire ce qui a été déconstruit ces quinze dernières années".