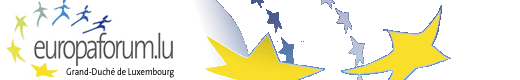Economie, finances et monnaie
Table-ronde sur la crise de la zone euro et le processus d’intégration européenne à l’Université de Luxembourg
03-06-2013
 Le 3 juin 2013, la Faculté de Droit, d'Economie et de Finance de l'Université du Luxembourg a organisé à l’initiative de la professeure Eleftheria Neframi une table-ronde consacrée à la crise de la zone euro et au processus d'intégration européenne qui s’est déroulée en trois phases. La première était consacrée au contexte de la crise, la deuxième aux méthodes pour y répondre, et la troisième aux perspectives de l’UE avec une question : évolue-t-elle vers plus d’intégration ? L’occasion d’entendre des approches inédites de la crise par des historiens, des juristes et des économistes. Avec des propos parfois très forts et prêtant à la controverse.
Le 3 juin 2013, la Faculté de Droit, d'Economie et de Finance de l'Université du Luxembourg a organisé à l’initiative de la professeure Eleftheria Neframi une table-ronde consacrée à la crise de la zone euro et au processus d'intégration européenne qui s’est déroulée en trois phases. La première était consacrée au contexte de la crise, la deuxième aux méthodes pour y répondre, et la troisième aux perspectives de l’UE avec une question : évolue-t-elle vers plus d’intégration ? L’occasion d’entendre des approches inédites de la crise par des historiens, des juristes et des économistes. Avec des propos parfois très forts et prêtant à la controverse.
Le contexte : L’Union monétaire face à la crise financière : repères et quête de légitimité
Matthias Morys, historien de l’économie enseignant à l’Université of York a évoqué la désintégration de l’étalon-or au cours de la Grande Dépression des années 30 et a posé la question de savoir si la crise de la zone euro n’avait pas un air de "déjà vu". Pour l’historien, nombreuses sont les unions monétaires qui dans l’histoire se sont écroulées. Même le Système monétaire européen (SME) qui a existé entre 1979 et 1992-93 en a été. Pourquoi une autre monnaie commune pourrait-elle donc ne pas s’écrouler ? Et de poser l’autre question : serait-ce un mal ?
L’étalon-or était ce système où toute émission de monnaie se faisait avec une contrepartie et une garantie d'échange en or. Les parités de deux monnaies différentes étaient donc fixées par rapport à l'or, et les taux de change étaient censés être stables entre pays participants. L'or constituait une monnaie internationale, qui servait au règlement des échanges et comme instrument de réserve pour les banques centrales des pays ayant adopté le système.
L’étalon-or s’est écroulé pendant la Grande Dépression, constate l’historien. Les pays qui l’ont quitté l’ont fait parce qu’ils n’avaient pas le choix et que cela ne correspondait plus à leurs intérêts, soit parce qu’ils étaient poussés plus ou moins rapidement vers la sortie par les marchés, soit parce que la confiance publique dans l’étalon-or s’était érodée, et alors la sortie du système était plus lente. Cette sortie de l’étalon-or a permis aux pays concernés la reprise économique, car ils ont pu pratiquer des dévaluations compétitives de leur monnaie nationale et pratiquer des politiques de taux d’intérêts plus bas. Les pays qui sont restés plus que de raison dans l’étalon-or ont été les perdants.
A parti de cette trame historique, Matthias Morys a abordé quatre questions : Quels sont les parallèles que l’on peut constater entre l’étalon-or et l’euro ? Comment l’écroulement de l’étalon-or s’est-il passé entre 1931 et 1936 ? La sortie de l’étalon-or a-t-elle été utile aux pays concernés ? Quelles implications ce processus peut-il avoir pour l’analyse de la crise de la zone euro ?
L’étalon-or et l’euro ne sont pas la même chose, a tenu à préciser l’historien. L’étalon-or ne générait pas par lui-même une politique monétaire, de sorte que c’étaient les prix, les salaires et les budgets des pays qui étaient d’emblée touchés par des politiques d’austérité. Sa formule : "L’UEM, ce sont les mêmes billets et pièces de monnaie plus la BCE." Le système monétaire est donc si blindé que "la spéculation a dû se chercher d’autres cibles, et ce furent les dettes publiques". C’est pourquoi sortir de l’euro risque de coûter très cher. Mais d’un autre côté, Matthias Morys n’est pas convaincu que la BCE travaille dans l’intérêt commun de tous les membres de l’UEM. La preuve en est que les banques centrales nationales continuent de s’exprimer, comme la Bundesbank, qui est fortement opposée aux actions dites "Outright monetary transactions" ou OMT de rachat de rachats d’obligations publiques à volume illimité.
L’étalon-or a été selon Matthias Morys un grand succès entre 1870 et 1914. Mais après la guerre de 14-18, « ce n’était plus le même esprit qui régnait ». Les facteurs de politique intérieure étaient devenus plus forts : il fallait reconstruire les économies après la guerre et les chômeurs avaient le droit de vote, ce qui n’était pas le cas partout avant 1914. Avec la Grande Dépression, Etats et banques s’avèrent faibles et « se noient ensemble ». L’étalon-or est à ce moment sous pression. Les perdants de la guerre, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, sont les premiers touchés. Or, avec l’Allemagne, c’est un acteur systémique qui est touché. « Pourtant, dans de nombreux pays », explique l’historien, « l’étalon-or est considéré comme quelque chose d’important, comme l’est aujourd’hui l’euro. » L’on introduit le contrôle des capitaux, comme on l’a fait pour Chypre en mars 2013 (LIEN), affirme Matthias Morys. « Et il s‘avère qu’il devient difficile de se priver de ce qui devait être provisoire », ajoute-t-il. En 1931, l’Allemagne pousse le Royaume Uni, qui est son créditeur, vers la sortie de l’étalon-or. Cela cause du désarroi au début, mais n’entraîne pas de crise majeure. L’étalon-or se dissout donc petit à petit.
La sortie de l’étalon-or a aidé les pays sortants à se reprendre économiquement parlant. Les dévaluations compétitives ont pris la place de mesures protectionnistes. Les crédits ont été plus accessibles. Les pays qui sont restés plus longtemps dans le système, comme la France, les Pays-Bas ou la Belgique, en ont pâti en termes de production. Leurs arguments étaient de quatre ordres : ils voulaient respecter l’orthodoxie financière ; ils incriminaient l’instabilité économique et financière et non pas le système de l’étalon-or ; ils estimaient que rester dans ce système leur causerait moins de frais ; ils considéraient l’étalon-or comme une partie de la solution, et non pas comme une partie du problème.
La crise des années 30 et la crise de la zone euro ont ceci en commun qu’elles se situent dans le cadre d’une récession globale. Les mécanismes d’ajustement ne fonctionnent pas très bien et induisent une "self-defeating austerity policy". Comme du temps de l’étalon-or, l’euro est traité "comme un dogme", selon Matthias Morys. Les parallèles sont selon lui frappants, voire "décourageants". L’UE ne peut plus éviter de répondre à la question de savoir vers où elle veut aller avec l’euro. L’historien n’exclut pas une dissolution partielle de la zone euro, et ce serait selon lui "peut-être une bonne chose pour la reprise économique globale".
David Howarth, professeur à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education, Université du Luxembourg, a lui évoqué les mécanismes de soutien à la monnaie européenne envisagés à diverses époques et la légitimité de l’intégration monétaire. Pour David Howarth, on assiste en Europe, du rapport Werner jusqu’à la création du MES, au développement d’un "libéralisme encadré et curieusement limité".
Le libéralisme encadré se développe avec le système de Bretton-Woods qui connaît mécanismes de soutien à la balance des paiements, contrôles des capitaux et dévaluations monétaires, ainsi que politiques d’ajustement pour les pays débiteurs. Ce système est dominé par un "hegemon", les Etats-Unis, avec tout ce que cela implique comme charges mais aussi privilèges. Le système de Bretton-Woods, en déclin à partir des années 70, est relayé par le « compromis de Washington » et son agenda néolibéral. Mais qu’en est-il depuis 2008, quand la crise a commencé, se demande l’historien.
L’UE est entrée depuis les années 80 dans l’ère d’un libéralisme encadré. Celui-ci se traduit par une ouverture graduelle des marchés, les politiques régionales, la PAC, les fonds structurels. Mais l’UE semble avoir peur de passer à des mécanismes de soutien macro-économiques, peut-être parce qu’elle n’est pas dominée par un "hegemon". Pourtant, tout au long de son évolution, il y a eu des propositions pour créer par exemple un fonds pour les comptes courants, financés par des emprunts sur les marchés et pas avec des fonds des Etats membres. Une directive a vu le jour en 1969 et a été revue en 2002, mais jamais utilisée avant 2008, lorsqu’elle a permis d’aider la Hongrie et la Lettonie en graves difficultés économiques. L’idée d’un fonds de réserve européen a aussi émergé, mais a échoué dans une UE qui n’a jamais tranché le conflit entre "économistes" (Allemagne) et "monétaristes" (France). L’accord de Brême de juillet 1978 qui a conduit à la création du Système monétaire européen prévoyait aussi un mécanisme de soutien aux monnaies faibles qui a été immédiatement contrecarré par une lettre d’Otmar Emminger, à l’époque président de la Bundesbank, qui exigeait des limites à ce mécanisme afin de prévenir pour son pays et le SME tout risque d’inflation. Le Comité Delors a lui traité la question de la balance des paiements qui ne disparaîtrait pas avec une monnaie commune.
Depuis 2010, cependant, l’UE s’est dotée de mécanismes de soutien pour parer à l’urgence, avec l’EFSM, l’EFSF et l’intervention du FMI. Mais l’Allemagne s’est imposée. Il s’agit de mécanismes intergouvernementaux et temporaires qui empruntent sur les marchés, qui n’accordent leur soutien que quand les problèmes avec les marchés financiers sont particulièrement graves, secondaires, mais s’interdisent le rachat direct des dettes bancaires. Ces mécanismes ne peuvent satisfaire les marchés. Même en tant que communauté, souligne David Howarth, l’UE n’arrive pas à s’imposer comme "hegemon" chez soi. S’y ajoutent la "menace juridique" qui émane de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe et la culture ordo-libérale qui domine idéologiquement le champ des opérations. L’EFSF conduit à encore plus d’austérité. En mars 2011, un accord sur la création du MES est trouvé, et l’Irlande demande de pouvoir bénéficier de taux plus bas. Un seul bail-out est accordé pour les banques, celles de l’Espagne. En décembre 2012, tout soutien à des banques qui ont des problèmes structurels hérités est abandonné. Bref, l’UEM se maintient, malgré l’absence de "hegemon", mais, selon David Howarth, elle se maintient surtout grâce aux "mouvements extraordinaires" de la BCE.
Lors de la discussion, Matthias Morys a mis en exergue l’érosion de la confiance du public dans l’UE et l’euro. Par ailleurs, il estime que l’Allemagne "montre poliment à certains pays la porte de sortie de l’euro afin de pouvoir dire qu’ils sont sortis de leur propre gré". L’Allemagne poursuit selon lui de manière constante "la politique d’un pays créditeur épris de stabilité". Mais il ne s’agit pas à ses yeux d’une opposition entre l’Allemagne et le reste de la zone euro, mais entre les pays dits "Club Med" et les pays misant sur la stabilité "qui se cachent derrière l’Allemagne".
Pour David Howarth, il faut suivre la position de la France qui est "importante aussi dans les échecs de la zone euro". La France n’est pas d’accord avec la politique budgétaire prônée par l’Allemagne. Pourtant, si la France entre dans la logique de la gouvernance économique proposée par l’Allemagne, l’Allemagne pourrait être d’accord avec un mandat élargi du MES qui pourrait conduire à un meilleur équilibre entre politiques budgétaires et fonds de soutien. Reste que les questions de souveraineté continuent de se poser.
La méthode : Réponses à la crise de la zone euro et droit de l’Union européenne
Angelos Dimopoulos, assistant-professeur à l’Université de Tilburg (NL) a lui évoqué le recours au droit international dans le cadre de la lutte contre la crise dans la zone euro et les implications de ce recours pour l’intégrité de la législation européenne, l’équilibre entre les institutions européennes et le fonctionnement de l’UE, et ce à partir du traité sur le MES (TESM) et du pacte budgétaire ou TSCG. Pour l’expert grec, TESM et TSCG se situent à l’intersection entre droit européen et droit international, dans la mesure où ils se réfèrent à la coordination économique et à la solidarité qui sont cités dans les traités européens (art. 21 et 26 TUE) et que les deux traités citent les institutions européennes comme étant responsables de leur mise en œuvre et de leur contrôle juridique.
La question pour Angelos Dimopoulos est d’arriver à jauger le danger de contamination émanant de tâches qui ne relèvent pas de l’UE liées à l’UE sur les tâches qui lui sont propres. TESM et TSCG ne prévoient pas de mécanismes d’initiative législative, ne sont soumis à aucun contrôle parlementaire.
La BCE pourrait-elle aussi être contrainte à changer de nature, n’étant plus seulement chargée de politique monétaire, mais aussi d’autres tâches avec les pouvoirs qui lui reviendront dans le cadre de l’union bancaire et de l’UEM renforcée ? La CJUE, de son côté, ne risque-t-elle pas, avec le contrôle juridique du TSCG qui est intergouvernemental, de devenir l’arbitre de disputes entre Etats membres, alors qu’elle n’a eu que très peu de cas de ce genre à trancher dans le cadre du droit communautaire ?
La CJUE ne risque-t-elle pas de devenir de ce fait une cour internationale, soumise derechef au droit international ? Et qu’en est-il des autres règles d’application des jugements qui en résultent et du genre de sanctions ?
Le Parlement européen de son côté n’est pas impliqué, ce qui est négatif en termes de légitimité et de responsabilité au sein de l’UE. Les parlements nationaux sont certes impliqués à travers la ratification du TESM et du TSCG. Mais ils n’ont jamais été impliqués dans la rédaction des projets de ces traités. Seul le Bundestag est maintenant impliqué de manière plus forte. Mais de fait, il y a inégalité entre les parlements nationaux et les droits qu’ils ont par rapport à ces deux traités.
Dans le cadre du TESM, les Etats membres sont également traités de manière différente que dans les institutions européennes. La majorité qualifiée est de 80 %, et les Etats membres pèsent dans le vote selon leur part au capital du MES. L’équilibre entre grands et petits Etats membres est donc directement touché.
Pour Angelos Dimopoulos, il n’est pas sûr qu’il eût été nécessaire de recourir au droit international. Une construction juridique basée exclusivement sur l’article 136 TFUE, qui permet le renforcement de la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des Etats membres de la zone euro, aurait été plus facile en invoquant par ailleurs l’article 48.6. sur une révision simplifiée des traités.
Le juriste grec estime que le recours au droit international est néanmoins possible s’il y a compatibilité avec le droit européen. La question est de savoir si l’on se focalise sur les compétences ou les objectifs de l’UE. La coordination des politiques économiques peut se baser sur les critères de subsidiarité et fonctionner sur base d’une coopération renforcée. La question est de savoir aussi si l’on mise sur les ressorts de l’article 4.3. ("En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.") ou si l’on invente de nouvelles règles pour la coopération intergouvernementale comme cela a été le cas avec le TESM et le TSCG.
Herwig Hofmann, professeur titulaire de la chaire Jean Monnet à la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance de l’Université du Luxembourg a quant à lui examiné le cas Pringle, par lequel la CJUE a statué le 27 novembre 2012 que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la conclusion et à la ratification du TESM par les États membres dont la monnaie est l’euro. L’arrêt faisait suite à la plainte d’un député irlandais, Thomas Pringle.
Pour la CJUE, ni le TESM ni la modification du TFUE n’ont donné de nouvelles compétences à l’UE, un constat par lequel elle a "apaisé le débat". La modification du TFUE et le TESM n’empiètent pas non plus sur la compétence exclusive reconnue à l’Union dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro, car selon la CJUE, le MES ne fait pas de politique monétaire. La compétence reconnue à l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres n’est pas non plus affectée. L’article 125 du TFUE qui interdit le bail-out d’un Etat membre par les autres Etats membres n’est pas violé non plus, puisque le soutien accordé par le MES à un pays est soumis à des conditions de politique budgétaire.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe du 12 septembre 2012 a une interprétation différente des choses, observe Herwig Hofmann. Elle a une interprétation plus restrictive de l’interdiction du bail-out (art. 125 TFUE) et souligne ce qui oppose cet article au contenu de l’art. 143 qui permet l’octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord, à un Etat membre en difficultés. Pour Herwig Hofmann, la CJUE "est plus convaincante" dans la mesure où elle juge le cas à partir de la perspective de l’UEM et de l’intégration européenne. Et par ce biais, le recours à la CJUE pour le contrôle juridique du MES limite les problèmes créés par ce traité intergouvernemental qu’est le TESM.
Pour Herwig Hofmann, le rapport des quatre présidents de fin 2012 sur le renforcement de l’UEM va de nouveau au-delà du champ d’action esquissé par le TESM et le TSCG, dans la mesure où il suggère des arrangements contractuels depuis repris en mars 2013 par la Commission. Bref, "ce champ d’action politique change tout le temps", comme lorsque les accords de Schengen, eux aussi intergouvernementaux, ont amené des domaines politiques dans le giron de l’UE. Mais, souligne Herwig Hofmann, "zone euro et zone non-euro se différencient de plus en plus". Et puis, qu’en est-il dans ces démarches du respect de l’article 11 TUE qui prévoit que la démocratie représentative, les parlements nationaux et les sociétés civiles soient consultées ? Bref, l’arrêt de la CJUE n’a pas résolu tous les problèmes soulevés par le TESM.
Les perspectives : Le processus d’intégration renforcé ?
Pour François Lafarge, chercheur à l’Ecole nationale d’administration, maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg (CEIE) le chemin vers une union bancaire qui régulerait les secteurs bancaire, financier et des assurances est un "laboratoire de la gouvernance européenne". Les trois agences de surveillance créées pour ces secteurs ont été dotées de pouvoirs plus puissants que les autres agences exécutives européennes. L’approche choisie est "fédéralisante" et a pour objectif d’empêcher le retour des crises et de créer un vrai marché intérieur bancaire, car l’UE est selon lui encore loin de ce type de marché. Le travail a avancé rapidement selon François Lafarge avec le rapport des quatre présidents validé dès juin 2012 par le Conseil européen, la feuille de route sur la surveillance bancaire de la Commission de septembre 2012 et sa proposition de novembre 2012, et finalement le travail législatif qui a abouti en mars 2013 à un accord au sein du trilogue Parlement européen-Conseil-Commission sur le mécanisme de surveillance unique, qui est un aspect de l’union bancaire.
Le projet en cours de discussion peut construire sur des efforts de régulation préalables basés sur les articles 290 et 291 TFUE, avec ses normes techniques et d’exécution, des recommandations et des interprétations communes rassemblées dans un European Single Rulebook, avec l’Agence bancaire européenne qui élabore des normes, avec le droit bancaire et le paquet CRD IV-CDR et la directive sur la garantie des dépôts de 1994. Mais François Lafarge observe aussi des lacunes. Par exemple il n’y a pas encore de prescription d’une séparation des activités de dépôt et de trading, sinon que ce dernier pourrait être filialisé, comme le suggère le rapport Likkanen. La Commission demande depuis 2010 la création d’un mécanisme européen de gestion et de résolution qui permettrait des bail-in avec des fonds nationaux, et qui agirait en complémentarité avec le MES, un projet qui n’a pas encore abouti, vu les controverses qu’il suscite ( voir l'Eurogroupe du 13 mai et l'ECOFIN du 14 mai 2013). Pas plus qu’une garantie des dépôts renforcée, comme l’avait demandé la Commission en 2010.
François Lafarge n’est pas non plus convaincu que le système de surveillance européen composé des autorités de surveillance nationales, des agences européennes et du comité sur le risque systémique fonctionne bien. La surveillance revient d’abord aux autorités nationales, et les agences européennes n’ont qu’un rôle subsidiaire, par exemple si les autorités nationales n’interviennent pas alors qu’il y a un risque. S’il y a urgence ou différends entre autorités nationales, elles peuvent aussi intervenir, mais seulement avec l’accord de la Commission. En Espagne, où les autorités nationales n’ont rien dit sur les risques qui couvaient dans "Bankia", cela n’a pas fonctionné. Dans un tel contexte, le MES existe aussi comme un embryon de gestion du risque.
Le projet d’un mécanisme de surveillance unique dont la BCE serait l’autorité déterminante est donc un pas vers une européisation du système. Mais le désaccord subsiste dans les faits sur le type de banques qui tomberaient sous le contrôle de la BCE et celles qui resteraient sous le contrôle des autorités nationales.
L’avantage de confier ces tâches à la BCE est pour François Lafarge qu’il n’y a pas besoin d’amender le traité européen, que l’indépendance et l’expertise sont garanties. Mais il pense aussi que dans un tel contexte, l’Agence bancaire européenne devrait être plus qu’une simple agence. Par ailleurs, l’article 126.7 TFUE limite le champ de cette surveillance par la BCE aux banques, de sorte que les assurances restent en dehors.
Se posent aussi d’autres problèmes de gouvernance. Il y a toujours la question de la légitimité démocratique. Ensuite il y a l’étendue du pouvoir normatif de la BCE qui reste à déterminer. Puis, les différences entre zone euro et non-zone euro posent problème. Le MES est un mécanisme intergouvernemental, et il ne peut donc être le lieu d’une activité de résolution et de gestion. Il n’est pas non plus une agence exécutive européenne. Cette tâche pourrait donc être confiée à la BCE. Mais après ?, conclut François Lafarge avec un grand point d’interrogation.
Le propos de Frédéric Allemand, du Centre Virtuel des Connaissances Européennes (CVCE) et qui est aussi maître de conférences à Sciences Po, à l’HEC et à l'EN, sur une gouvernance de sortie de crise qui miserait sur une intégration "par exception" et sur une gouvernance européenne qui serait de fait une "gouvernance de discipline" a été autrement plus musclé.
Frédéric Allemand s’est référé au terme de "fédéralisme d’exception" que l’ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, avait pour la première fois utilisé le 17 mai 2012 dans un discours prononcé devant l'institut Peterson d'économie internationale à Washington. Il avait proposé que l'Union européenne soit habilitée à prendre en charge le budget d'un Etat membre s'il constate son incapacité à mettre de l'ordre dans ses finances, dans le cadre de mesures pour préserver l'euro des conséquences de la crise grecque. Il avait préconisé, en l'absence d'une union fédérale politiquement difficile à appliquer, l'activation d'un mécanisme fédéral exceptionnel, quand la politique budgétaire d'un pays menace l'ensemble de l'union monétaire. "Le fédéralisme d'exception me semble non seulement nécessaire pour garantir une solide union économique et monétaire, mais il pourrait aussi s'adapter à la véritable nature de l'Europe sur le long terme. Je ne crois pas que nous aurons un grand budget (centralisé) de l'UE", avait-t-il déclaré. Jean-Claude Trichet avait ensuite noté que les éléments de ce mécanisme étaient déjà en place, les pays membres ayant accepté, dans le pacte budgétaire européen, de surveiller leurs budgets respectifs et de sanctionner les déficits excessifs.
Dans un contexte où le Conseil européen de juin 2013 va réfléchir sur une "UEM véritable" tout comme sur la relance économique, la compétitivité, l’introduction d’une TTF ou d’une assiette commune d’imposition des entreprises, les parlements nationaux se sentent, notamment avec le pacte budgétaire ou TSCG et la gouvernance économique qui se met en place, "poussés vers des strapontins", comme l’ont formulé les parlements danois et finlandais cités par l’intervenant. La même chose est ressentie chez les partenaires sociaux qui supportent mal ce fédéralisme d’exception. Il n’en reste pas moins que le Conseil a eu la compétence matérielle d’imposer à des pays sous programme d’assistance des choix budgétaires pour mettre fin à des dérives qui mettaient en danger le tout, à l’instar de ce que Jean-Claude Trichet avait préconisé, et ce à titre exceptionnel et par une décision centrale. Pour Frédéric Allemand, cette approche à "un côté novateur et raisonnable".
Mais avant d’en venir à ce type de décisions, mieux vaut faire le point sur les régimes de coordination existants et les exploiter au maximum : le six-pack, le two-pack, le TSCG, formellement contraignants, et de manière moins formelle, le pacte pour l'euro plus et le pacte pour la croissance et l’emploi sont autant d’outils. Ils aident à orienter les stratégies budgétaires des Etats membres, notamment en fixant le taux de dépenses. Ils ont un caractère intrusif, mais "l’intrusion est la condition de l’inclusion", selon Frédéric Allemand. Mais, admet-il, cela ne plaît pas aux parlements nationaux qui renâclent à n’être "que des chambres d’enregistrement".
Cette coordination économique revêt un caractère progressif, explique l’intervenant, dans le sens où la gouvernance économique s’est traduite par "une multiplication des surveillances et des encadrements" proportionnels aux risques que les uns font courir aux autres, ajoute-t-il. "La progressivité de ces régimes de surveillance et les obligations qu’ils impliquent réduisent les marges de manœuvre des Etats", dit-il clairement. Les recommandations du Conseil, et cela est leur avantage, sont suivies. Même un pays comme l’Italie, qui "n’a pas été sous perfusion", est passé à des réformes. Le Conseil prend selon les régimes des mesures directement applicables dans le sens juridique du terme, "comme le veulent les bailleurs de fonds qui exigent que leur argent soit bien dépensé". Mais, admet Frédéric Allemand, tout cela échappe à une vérification sous le signe des droits fondamentaux.
Pour le chercheur auprès du CVCE, la gouvernance européenne est de fait "une gouvernance de discipline", l’UE joue "un rôle de gendarme". Et elle n’est pas récompensée pour cela. Au contraire, la Commission devient le bouc émissaire par excellence. Par ailleurs, les parlements nationaux ne peuvent pas accepter la mise sous tutelle de leur pays en termes de droit. Mais dans les faits, elle existe pour Frédéric Allemand. Le chercheur n’a pas manqué de préciser que dès le rapport Werner, l’idée de prendre de l’influence sur le budget des Etats membres d’une union monétaire avait prévalu. Une coordination est faite non pour discuter, mais pour prendre des décisions. Invoquer la question de la légitimité démocratique, c’est un peu oublier selon lui que l’UE a surtout été de tout temps une union de type budgétaire.
Dans ses conclusions, Jean-Victor Louis, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles dira qu’il trouve curieux que l’on ne puisse réaliser une fédération que par le budget en recourant à des mesures de type "fédéralisme d’exception". Si l’on devait appliquer ce type de contraintes à l’Allemagne, qu’en serait-il de son identité constitutionnelle, qui se manifeste toujours de manière forte ? Et si on devait l’appliquer à la France, accepterait-elle des modifications de son orientation budgétaire ? Il a aussi rappelé la nécessité de veiller au social, qui "est aussi important que l’économie", en se référant à une déclaration du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, qui a dit le 29 mai 2013 qu’il fallait préserver le modèle social européen et que si les normes sociales américaines étaient introduites en Europe, "nous aurions une révolution, pas demain, mais le jour même".